Marie-Claude Volfin

Entretien avec Raquel Levy
Revue L'Humidité N° 24 - 1977
Marie-Claude Volfin — En abordant ta peinture, on est tenté de l’associer à certaines démarches américaines, notamment celle de Rothko ou de Newman. Cette association te semble-t-elle fondée ?
Raquel — J'aime profondément la peinture de Rothko. Mais je ne vois pas bien où se situeraient une filiation ou une ressemblance. Il y a chez lui une « physique ›› de la toile à laquelle mon travail s`oppose presque point par point : formats plus grands, proportions plus massives avec en plus l’épaisseur peinte des châssis, diffusion de la forme par ce traitement si spécifique de la lumière et de la profondeur, etc. Je ne suis pas insensible à la mystique mais dans ma peinture elle est systématiquement évacuée. Mes toiles sont plates, minces; les lignes précises, nerveuses ; les formats à la mesure de mon corps ; les couleurs uniformes, souvent dures ; la matière généralement lisse. Je n’ai découvert Newman qu`en 1972, à l’exposition du Grand Palais. Mais là aussi il y a une conception de l`espace tellement différente. Mon rapport à la peinture américaine passerait plutôt par Frantz Kline. J’ai découvert ses toiles à New York, en 1960. Ça a été alors un grand choc. Dans une certaine mesure tout mon travail est parti de là. Et de Soulages.
M.C.V. — Pourtant, lorsqu’on voit tes toiles actuelles — ces grandes plages monochromes presque rectangulaires bordées d`étroites zones blanches — on a peine à croire qu’il puisse s’agir d’une peinture de geste.
R. — Au départ, le geste était une façon de libérer la charge d`intensité que je portais en moi. Très brutalement. Très directement. Puis il est venu un moment où je me suis rendu compte que la violence du geste ne suffisait plus à opérer le débordement dont je ressentais, physiquement et intellectuellement, le besoin.
Cela finissait même, à l’inverse, par engendrer un nouvel enfermement. Pas seulement à cause d’une certaine facilité, mais parce que la trace du geste sur la toile a quelque chose de statique et de figé en contradiction avec l’idée même de geste. Et aussi parce que ça n’implique finalement qu’une partie du corps : les bras, et même un seul bras avec la main qui tient la brosse ou le couteau. Je voulais que tout le corps, le corps entier participe au geste. C’est d’ailleurs, littéralement, comme ça que je peins : la toile à plat et moi penchée au-dessus, de tout mon corps ; depuis la pointe des pieds jusqu’à l’extrémité des bras. Quand je dresse la toile, chaque fois, c’est la même verticalité que quand je me relève. Les lignes de la toile et du corps. Une verticalité physique, et non mentale comme chez Newman.
Même aujourd`hui c'est toujours le geste qui est là, mais amplifié. Ralenti. Contrôlé. Mes formats se sont agrandis. Le geste n’est plus inscrit dans l’espace du tableau, mais c’est le tableau tout entier qui devient geste. C’est quelque chose entre le geste et pas de geste.
Presque immobile mais pas à l’arrêt. Cela a pris du temps. Ça a commencé par un mouvement centrifuge, une tendance à expulser tout ce qui faisait obstacle, ce qui fragmentait le corps : signes, épaisseurs, couleurs. Je travaille toujours avec la couleur, mais même la couleur est devenue comme sans couleur. Ce qui reste quand ça va disparaître. Quand on gomme. On efface. On enfonce dans la mémoire. Prends ce triptyque rouge, par exemple. Je ne vois pas là trois surfaces rouges, mais l’annulation de la couleur dans le blanc, dans le blanc des marges. Je parle de surfaces mais ce n’est pas cela qui compte. Tout se passe aux bords. Où la couleur vient à faire défaut. Où ça défaille. Où ça s’appauvrit pour de bon. Comme si je travaillais à la bordure de l’absence de geste. Là où aucun geste ne pourrait plus être accompli. Ça peut durer des jours, des semaines. Cela ne compte pas... Creuser le « silence ›› — autour et dedans. Pour moi ces toiles sont comme des murs de silence dans mon propre atelier.
M.C.V. — Il n`y a pas seulement les toiles. Il y a les séries de collages qui reproduisent une superposition de bandes verticales bleu sombre et blanches. La répétition joue-t-elle un rôle important ?
R. — D’une manière ou d’une autre toute peinture est répétitive. Ce qui peut varier, dans un travail à l’autre, c’est le point de vue à partir duquel se fait la répétition. Ou bien l’accent porte sur le retour du même, ce qui suppose que l’on s’est donné un modèle extérieur préalablement (re) connu. Dans ce cas, c’est la répétition qui compte (le moulin à prières), les différences n’intervenant que pour mieux souligner la permanence du modèle répété.
Ou bien l’accent est mis sur la différence qui apparaît à la faveur de la répétition. Ainsi dans ces collages, comme d’ailleurs dans les toiles, une deuxième peinture ne répète pas une première, mais chaque peinture de la série se donne à la fois comme le répété et l’original puisque, en l’absence de modèle, ce qui est répété, la différence, m’est inconnu, restant chaque fois à inventer.
M.C.V. — Dans ce cas ne faudrait-il pas pouvoir disposer de la série complète, et une peinture isolée ne perd-elle pas une partie de son sens ?
R. — L`aspect sériel est indissociable de mon travail au sens où la série me fournit le « cadre » grâce auquel je peux jouer avec les différences. Non seulement une peinture peut être abstraite de sa série, puisqu’elle manifeste une singularité unique à l’intérieur du champ sériel, elle fait voler en éclats la série comme « dedans », comme origine. Même si, en même temps, elle atteste ou récapitule à elle seule toute la série.
M.C.V. — Parlons un peu des livres (1). Le travail du livre est-il très différent de la peinture proprement dite ?
R. — Non, c’est la même chose. J’ai toujours beaucoup lu. Bien sûr le passage de la toile au livre soulève des problèmes concrets, d’accommodation. Surtout au niveau des formats. Ce qui m`a le plus gêné, au début, était de revenir à de petits formats.
En revanche, ce qu’il y a d’irremplaçable avec le livre, c’est le volume. Le travail du volume. Là c’est très différent. Je ne savais pas. Je ne suis pas sculpteur. Jusqu’à ce que je commence à faire des livres, pour moi la toile c’était plat. Alors que la page, dès le départ, c’est le recto et le verso. Une simple page (regarde celle de Lars Fredrikson dans Llanfair) avec son envers et son endroit c’est déjà le livre. Ensuite, avec la succession et la combinaison des autres pages, tu imagines la richesse des possibilités.
Évidemment le travail du livre a eu ses répercussions dans ma peinture. La série des collages avec les bandes verticales est sortie tout droit de « 3 LETTRE » où j’avais joué le volume par la transparence du papier — ces pré-échos sourds qui venaient scander le texte.
Chaque livre exige bien sûr une nouvelle manière de traiter le volume en fonction du texte. Avec Anne-Marie Albiach, le travail a porté sur les tranches et l’envers de la page, pour ne pas entamer l’espace du texte. Simplement en marquant l’articulation des pages par une saignée à la pliure extérieure. Avec Pierre Rottenberg le problème a été de déborder le texte par la peinture. Ce qui est peint est hors livre, sur ce papier presque transparent dont le format dépasse celui de la page imprimée. Avec Edmond Jabès, au contraire, le premier livre a été un enveloppement du texte dans un jeu de pliages noirs et blancs alors que pour le second j’ai introduit à l’intérieur même du texte des séquences presque vides où le livre est désert. Avec Mathieu Bénézet, la couleur tend à annuler le texte, à blanchir le livre…
M.C.V. — Selon quels critères choisis-tu les écrivains avec lesquels tu travailles ?
R. — Je travaille avec des textes qui me questionnent, qui interrogent ma propre peinture. Qui font le vide aussi. Qui ont cette violence. Qui t’enlèvent le sol. Comme le sol de l’atelier que j’ai voulu blanc. Il se dérobe. Tu perds pied. Tu ne sais plus où est le haut et le bas. Ce qu’il me faut c’est un texte comme ça, qui me fait perdre pied. Un texte de Quignard, par exemple. Tu te trouves avec la peur, la terreur initiale.
(1) Avec un écrivain, Emmanuel Hocquard, Raquel a fondé et dirige les éditions Orange Export Ltd. Elle y a fait des livres avec Emmanuel Hocquard, Anne-Marie Albiach, Edmond Jabès. Pierre Rottenberg, Mathieu Bénézet, Homero Aridjis. Ces livres ont été exposés, en octobre 1976, au Centre National d’Art et de Culture G. Pompidou. Actuellement, Raquel travaille avec des textes de Roger Giroux, Alain Veinstein, Philippe Lacoue-Labarthe, Michel Butor, Pascal Quignard.
Franck Venaille
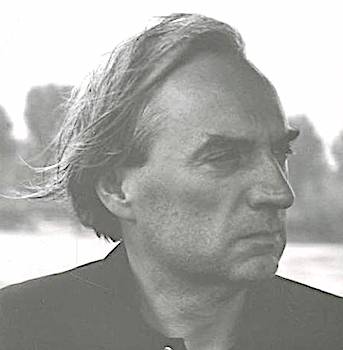
De Panne, ce jour-là, dans la lumière blanche
Franck Venaille. Raquel, tes toiles, ces grands pans monochromes évoquent pour moi les plages du Nord. Je veux dire que j’y retrouve le sable et le jeu de la marée qui, d’abord, ramène inlassablement puis, toujours de la même manière, arrache. Donc ces toiles je les vois à la fois fortes et en même temps menacées. Elles vivent entre le mouvement et à cause de ce mouvement. Est-ce que tu en as conscience ?
Raquel. C’est vrai qu’i| y a quelque chose qui a un rapport avec la mer, mais, pour moi, c’est plutôt avec le désert. Mais le désert et la mer c’est pareil, c’est cela, c’est comme si j’étais constamment en train d’arracher quelque chose. Dans mes toiles, au début, tout était rempli de signes, de drames, de mouvements, et tout mon travail ensuite a consisté à arracher tout cela. C’est à la fois serein et en même temps. Il y a une angoisse qui grandit très fort parce que l’arrachement qui se fait, l’arrachement dont tu parles, c’est des lambeaux de moi, comme si l’intérieur de mon cerveau et tout ce qu’il y a en moi s’effritaient. La mémoire disparaît, tu vois je ne peux même pas parler ! Tout se défait. Je n’y arrive pas…
F.V. Et en même temps tu as conscience que cela s’en va, cela balaie le sable, disparaît...
R. Comme si ce balayage devait tout enlever, mais, en fait ça revient. C’est un éternel recommencement.
F.V. Et pourquoi le désert ?
R. Eh bien parce que pour moi ça a été la révélation. C’est un des moments ou j’ai été le plus en accord avec moi-même. Il n’y avait plus d’enfermement, plus de barrière. Plus rien à enlever tu vois ! C’était le moment le plus intense de ma vie.
F.V. Donc c’est lié à ta vie, à de l’autobiographie ?
R. Oui. Oui absolument. C’est comme ces collages que j’ai faits, en papier ordinaire, eh bien, après coup, j’y ai retrouvé les grandes plages d’Ostende qui m’avaient tellement impressionnée, les grandes plages du Nord sans soleil, alors que je croyais que je n’aimais que le soleil. Tout cela correspondait à quelque chose de très profond en moi. Cette brume. Et je me suis aperçue après, en regardant les collages, que c’était ce que j’avais, comment dire, pressenti !
F.V. Maintenant, je vais te reposer la même question, mais formulée autrement, c’est-à-dire que l’on a affaire à une peinture soi-disant figée, dont la tension est interne et toujours antérieure à l’acte de peindre. Ce que l’on voit sur la toile c’est toujours un résultat, un point de chute, jamais du « départ », toujours du « fini ». Tu es d’accord ?
R. Je suis d’accord, oui, mais pas sur l’idée de « fini ». C’est comme si tu prenais un mouvement dans son action, tu ne peux pas le séparer de moi. Il n’y a pas de séparation entre la toile et mon corps. Il n’y a pas un geste qui commence et un geste qui finit. Les toiles. Quand je les regarde, peut-être que ce qu’il y a de plus important, c’est ce qu’ii y a à l’extérieur ! Comme si le mouvement se continuait, de mon corps à la toile. De moi aux choses, des choses à la toile. C’est quand je faisais de la peinture gestuelle que le geste était figé parce qu’il était dans la toile alors que là le geste commence à l’extérieur, va à la toile, continue. Ça passe ! C’est vraiment comme une intensité qui passe. Qui reste, qui continue, qui est là ? Quand je reste dans la pièce toute seule avec mes toiles j’ai l’impression que ça court d’une toile à l’autre...
F.V. Donc à la notion de « fini » tu préfères celle de « passage »...
R. Oui.
F.V. D’où te vient ta méfiance par rapport au réel ? Pourtant tes toiles ramènent à ton histoire, à ton vécu, à ton propre mouvement. On dirait que tu ne crois pas à la représentation, mais au vide, au soubassement.
R. Je ne sais pas. C’est un langage que je ne comprends pas. Dès qu’on me dit « réel », je ne comprends pas, vraiment pas ce mot. Pour moi ce qu’on appelle le réel ça ne me paraît pas plus réel que la fiction. J’ai beau essayer d’appréhender quelque chose je ne le vois jamais. C’est un mot qui ne me dit absolument rien...
F.V. En fait je pensais à la méfiance par rapport à, disons, la nouvelle figuration...
R. Je ne sais plus quelle année c’était. J’ai fait des collages ; « pop », mais c’était un jeu, ça ne correspond à rien de profond chez moi, en fait je ne pense pas une minute que je vais trouver quelque chose à l’extérieur de moi-même, voilà, c’est ça ! Le mystère est en moi, c’est là où tout se passe... C’est tellement difficile à saisir, à appréhender quelque chose ! En peinture, ce que tu appelles la représentation du réel, la réalité, pour moi c’est de la fiction à partir de la fiction. Rien ne me semble plus étrange au monde qu’une feuille d’arbre. Je la regarde. Je suis complètement angoissée. Je n’y comprends rien. Je ne sais pas ce que c’est ! Dans le fond si je me laissais aller à ce que je suis vraiment je vivrais toujours dans la terreur la plus absolue devant tout... Alors comme ce n’est pas vivable je conjure cela par le rire... Je suis toujours en train de me moquer de moi-même...
F.V. Mais comment juges-tu cette peinture ? Est-ce qu’elle te choque ? J’ai plutôt l’impression que tu ne veux pas la voir...
R. Non, le fait même qu’elle m’ait intéressée à un moment donné montre que je la regarde, parce qu’en dehors de moi je regarde ce que j’aime bien : les cafés, l’extérieur, j’essaie de m’ouvrir à tout ce qui existe autour de moi c’est certain. Mais ça ne me concerne pas vraiment, c’est tout. Je ne dis pas que ça ne me plaît pas...
F.V. Mais tu comprends qu’il y ait des gens qui soient fascinés par ce désir d’interpréter et de restituer le réel ?
R. Absolument, mais pour moi c’est un mirage.
F.V. Mais, toi, si tu avais quelque chose, disons, à restituer, ce serait toi-même...
R. Oui... Au fond il n’y a qu’une question qui compte c’est : qu’est-ce qui me fait vivre ! Tout ce côté que je ne dis pas, c’est la mort, la question angoissante, le centre de moi-même. C’est toujours ça. Ce que je suis.
F.V. Justement dans tes toiles il n’y a pas « d’histoires », pas de fiction, mais des masses. Pas de lignes. Pas de courbes. Pas de signes non plus. Tour cela est muet. On croirait marcher dans le silence. Ça te choque si je te dis que c’est une peinture de la mort et, si je pense à tes triptyques, de la répétition de la mort !
R. C’est sûrement une peinture de la mort, mais c’est aussi une peinture où les marges sont très importantes et cela si tu veux c’est un peu la respiration, la respiration dans la terreur. Au fond on peut le prendre de deux façons, dans la terreur et aussi dans la dérision, le rire. C’est toujours l’agonie. C’est un rythme aussi et dans la mort il n’y a plus de rythme, plus rien. C’est toujours une bagarre !
F.V. Est-ce que tu peux me donner la raison des triptyques, dire pourquoi tu peins assez souvent trois ou quatre toiles pratiquement semblables ?
R. Ce qui se passe et qui est à l’extérieur, ce qui est expulsé, ce rythme, c’est comme un accord de musique, c’est le moment dans un diptyque ou dans un triptyque où il se produit un accord singulier entre les couleurs. Ce que je cherche c’est arriver à la moindre différence, à quelque chose que j’entends presque, comme un son...
F.V. Oui il y a la toile, mais aussi ce qui se passe autour, donc si tu en peins plusieurs c’est peut-être ce qu’il y avait autour d’une toile qui devient l’autre toile…
R. Et ce qui restitue le mieux cela c’est peut-être la musique, l’accord...
F.V. La répétition ?
R. La répétition qui fait surgir la différence, toujours !
F.V. On pourrait donc imaginer que tu puisses peindre, je ne sais pas, trente toiles !
R. Oui j’aimerais, d’ailleurs j’ai toujours l’impression que je n’ai pas encore commencé à peindre. Toujours. Même quand je viens de travailler pendant dix heures. Mon rêve ce serait devoir un espace immense, de faire des grandes toiles, des séries, pour exploiter vraiment la différence.
F.V. Et la couleur pour toi c’est un substrat du blanc ? Une manière de « charger » la toile ? Un élément de ta recherche picturale ? Du marron sur du marron on dirait des trous sur de l’absence, ou dans du sable.
R. Je crois que je suis vraiment coloriste. La couleur ça ne me pose pas de problème, quand je l’emploie. Mais ce qui m’intéresse surtout c’est l’effacement de la couleur là où elle défaille, comme dans les marges. Ce n’est pas un problème la couleur ! D’ailleurs je dis toujours qu’il n’y a pas de couleurs dans mes toiles. J’aime bien la tirer à son maximum. Au début j’étais très impressionniste, ensuite j’ai commencé à me limiter. En 1964 je me suis donné trois couleurs : rouge, noir, blanc, et avec cela j’ai fait des séries entières de tableaux. Et puis peu à peu ça aussi je l’ai supprimé. Maintenant j’ai l’impression qu’il n’y a plus rien et je cherche à voir ce que cela donne.
F.V. Quand on te dit que tu es un peintre abstrait tu réagis comment ? Qu’est-ce que cela sous-entend ?
R. Ça ne veut rien dire non plus. Ce n’est pas plus abstrait que la réalité...
F.V. Alors qu’est-ce qui te semblerait juste comme définition, comme approche ?
R. Rien... rien... une peinture de rien ; je crois qu’il n’y a rien dans ma peinture, pas de signes. Pas de signifiants, pas de couleur, il n’y a rien. C’est vide. Un vide sur lequel je travaille depuis tant d’années !
F.V. Sur des photos où l’on te voit peindre tu sembles totalement engagée, en mouvement. Tu peux dire comment ça se passe?
R. Oui le corps est très important pour moi. Ce qui compte c’est la danse par exemple ou l’existence de mon corps. Ce qui me fait vivre c’est de le sentir. Quand je peins je le sens, ça colle à la toile. En faisant du gestuel seul mon bras était en mouvement tout le reste mourait. Maintenant que je peins des peintures qui peuvent paraître sans mouvement c’est là que je m’implique le plus. Tout mon corps, tout mon être, tout mon souffle ! Comme dans la danse ! Je vis mes toiles totalement. Quand j’ai fini de peindre d’ailleurs je suis exténuée, vidée. Mais sereine I
Monsieur Bloom n°2 — 1978
Emmanuel Hocquard

La cinquième partie d'une ligne ne peut nous échapper
Cette exposition (Caracas, 1990) rassemble, dans un lieu éloigné de tous les autres, des peintures qui ont été réalisées dans différents lieux, sous différentes lumières, au cours d’une période de vingt ans. Cette conjonction montre, de façon elliptique, le produit d'un travail de vingt années, mais ne montre ni le travail ni le temps de ce travail. C’est cette double part invisible, sans mesure, que je voudrais évoquer ici : « un désir de toucher à distance, comme si le nom (Raquel) était hors du signe physique de la visibilité » (Jacques Sojcher).
Qu’il me soit permis de parler en tant qu'écrivain qui, toutes ces années, a quotidiennement partagé avec le peintre le même travail et les mêmes passions intellectuelles. Et je ne parle pas seulement d'Orange Export Ltd., la maison d'édition que nous avons fondée et dirigée ensemble pendant quinze ans.
Je vais commencer par une photographie, très abstraite, en noir et blanc, extraite d'un album que Raquel avait justement intitulé : « sans ornement sans interruption » (titre qui ne comporte ni majuscule initiale, ni ponctuation finale). La photographie, contemporaine des triptyques et diptyques exposés ici, représente l'atelier de Raquel vu en contrejour, sans personnages, et montre seulement les lignes droites, verticales et horizontales des fenêtres et des murs, et les surfaces rectangulaires des tableaux et des tables. Elle est accompagnée de la légende suivante : « dans chaque chambre il y a une certaine quantité de volumes et de surfaces qui peuvent être perçus… La cinquième partie d'une ligne ne peut nous échapper ». Cette photographie (que vous ne voyez pas) avec cette légende qui se termine (?) sous une forme plutôt énigmatique, est à mon avis une bonne introduction au travail invisible dont je parle. Il y faut associer deux autres photographies publiées dans le même album, que commente Marcelin Pleynet dans sa très belle étude sur Raquel : une d'elles montre l'artiste dans son enfance, à Gibraltar où elle est née, devant la porte du cimetière ; l'autre représente sa grand-mère dans les dernières années de sa vie, un livre ouvert dans les mains. (Le livre est blanc, dans la photographie, comme la Lettre de Vermeer.) « Dans chacune de ces photographies et dans ses commentaires, écrit Marcelin Pleynet, il est impossible de ne pas voir un ordre d'interprétation où la fonction du corps joue de façon généalogique, sur fond de cimetière, son apparition et sa disparition dans le livre de l'aïeule. Ces jeux provoquent un effet de mémoire et, plus tard, bien au-delà, l'écoute généalogique de la mémoire : le livre ».
Il y a quelques semaines, en cette fin d'été 1990, de ce même atelier figurant sur la photographie, j'ai vu sortir les peintures, après les avoir vues enroulées en vue de leur transport à travers l'Atlantique. Imaginez aujourd'hui, à distance, ces rouleaux de toile déroulés et reconvertis, sur les murs de la galerie qui les reçoit, en une certaine quantité de surfaces susceptibles d'être perçues : une ellipse développée devant vos yeux, comme le livre antique (volumen) ou, aussi bien, comme le livre blanc que tient dans les mains la grand-mère à la fin de sa vie. Vous qui entrez maintenant dans ces salles où vous pouvez percevoir une certaine quantité de volumes et de surfaces, vous entrez dans un livre. Ce n'est pas une métaphore. Marcelin Pleynet ne se trompait pas quand, très justement, il a intitulé son étude sur le peintre : « Le livre de Raquel ». Il est impossible de décrire un livre, car sa description exacte serait le livre lui-même. La peinture de Raquel, plus que toute autre, réalise cette tautologie, ce qui décourage les commentaires artistiques. « Les tableaux de Raquel ne sont pas faciles à voir, écrit Marcelin Pleynet. Sa peinture est comme aucune autre et elle est, si je puis dire, plus difficile qu'aucune autre ».
Mais il ne nous est pas interdit de recourir aux mots du peintre. Et de noter que ces mots sont, littéralement (pas métaphoriquement), ceux que nous utilisons pour parler du livre : la cinquième partie d'une ligne ne peut nous échapper.
Je ne m’attarderai pas sur les mots : marge, volume, pliure… ni sur la prédilection pour le diptyque (la double page du livre ouvert).
Et je ne m'étendrai pas non plus sur les livres réalisés avec les écrivains ; ni sur l'importance de l'œuvre sur papier ; ni même sur l'aller-retour, absolument essentiel, entre le livre et la toile, échange qui ne cesse de nourrir et d'enrichir la recherche du peintre. Et de ceux qui ont travaillé avec elle.
Je veux cependant souligner que, de tous ceux qui ont parlé de ses peintures, ce sont les écrivains qui l'ont fait avec le plus de pertinence.
Mais tout cela est assez évident. Ce qui l'est moins, c'est cette la dimension non visible, dont Claude Royet-Journoud écrit : « En effet il y a narration... et comme toute narration, celle-là a à voir avec le temps et la mémoire ».
C'est ainsi que Raquel écrit : « Le moment de la fabrication fait partie du temps de la peinture. La peinture apporte aussi avec elle l'histoire de ce temps. Ce qui se montre est ce travail, cette lente (dé)construction. La mémoire au travail ».
Un paradoxe ? Ce qui caractérise précisément l'aspect radical de cette position « à l'envers », c'est qu'ici la mémoire au travail ne procède pas par découvertes successives (mise au jour des objets identifiables et donc répertoriables esthétiquement ou repérables historiquement), mais plutôt au contraire par des recouvrements. De tels recouvrements ont pour effet d'évacuer (de masquer, dit Marcelin Pleynet) toute trace de représentation. Celle-ci, réduite à ces champs monochromes ou presque, neutralise à la fin la couleur même comme référent ultime, car il y a effectivement disparition, blanchiment (du livre de la grand-mère), même si les couleurs avoisinent souvent le noir. Mais il ne s'agit pas de couleur. Pour limiter le vocabulaire du livre, je dirais que le travail est (dé)construit en palimpseste.
« Elle est déposée en couches », écrit Raquel. « Dans cette superposition de couches, ajoute-t-elle, se trouve un résumé de toute mon histoire, l'histoire de ma peinture ». Et de mettre l'accent, à ce propos, sur la lenteur, comme Wittgenstein : « Je voudrais ralentir le tempo de la lecture. Parce que j'aimerais lire lentement… Il arrive qu'une phrase ne puisse être comprise que si elle est lue selon le tempo requis. Toutes mes phrases doivent être lues lentement ».
De cette lenteur, Raquel parle ainsi : « Je pense à ce photographe qui prend des photos du métro de New York à dix-huit heures. Personne ne figure sur les photographies. Comme si les quais du métro étaient déserts. Simplement parce que le temps d'exposition est tellement long que les personnes présentes, en mouvement, passent trop vite devant l'objectif pour impressionner la pellicule. Dans ma peinture, un ralentissement similaire consume tout le superficiel, tout le superflu ».
Dans les triptyques, par exemple, Raquel réitère un espace de vide (comme pour accentuer son amplitude) ; elle peint la retenue du geste jusqu'à se disloquer la main.
" Cette peinture : note finale, post-scriptum sans fin d'une histoire dont nous ignorons jusqu'au premier mot. " (Alain Veinstein).
Paris, 22 septembre 1990
Emmanuel Hocquard

COMMENT DES PEINTURES DE LIVRE
ou le troisième paysage
Voyez p. ex. lorsqu’on s’étonne de l’existence de quelque chose. Cet étonnement ne peut pas s’exprimer sous la forme d’une question et il n’y a pas davantage de réponse. Tout ce que nous sommes en état de dire ne peut être a priori que non-sens. Malgré cela nous donnons du front contre les bornes du langage.
Notes sur des conversations avec Wîttgensteín. Lundi 30 décembre 1929 (chez Shlick).
Où vient la peinture ? « La peinture me sert de question. » La question est un pli. Elle n’appelle pas d’autre réponse que le dépli des questions qu’elle enveloppe, que la description des questions sous-jacentes.
Les peintures de jardin sont fondées sur un rapport d’alliance entre le jardin et le mur intérieur du viridarium ouvert sur le jardin. Le jardin qui, comme la lumière, entre dans la maison par une ouverture, se déplie en peinture sur les murs de la pièce. L’agencement jardin-mur-peinture constitue le troisième paysage.
À son tour la peinture décrit le jardin comme viridarium. En décrivant sur le mur [intérieur] les questions que contient le jardin [extérieur], les peintures de jardin neutralisent l’opposition dedans/dehors.
Le paradigme diptyque. « Une surface. À côté, une autre qui lui ressemble. Entre les deux une fente d’air. La différence de lumière sur chacune des surfaces fait la différence. » Comment as-tu vu la lumière ? Un angle plat. On ne voit pas l’angle que forment deux murs, deux pages, on voit seulement l’un des deux murs plus sombre que l’autre, ou d’un bleu différent.
Si on regarde les diptyques R comme des tableaux, l’électricien demande :
« Où sont les tableaux ? » Si on envisage le diptyque comme question (chant), on se met en quête des questions incluses (sous-chant). Le sous-chant décrit le troisième paysage.
Diptyque est un volume plat. Multiplicité qui tend à l’unité par effacement des questions sous-jacentes : superposition des couches (polychromie) et juxtaposition des surfaces (polyptyque). Mouvement qui tend à l’équilibre mais y tend seulement (funambule sur la corde d’ombre tendue au-dessus du vide).
Le diptyque R se caractérise ainsi par une double intention : ralentissement chromatique (tendant au sombre, au cendré, au terreux) et reflux spatial (masse non extensive) vers l’entre.
Le rapport d’alliance entre les deux surfaces s’articule à la fente d"air sans lumière, entre elles. Entre, qui par définition est neutre, ne sépare ni ne réunit. Simple suspens entre inspiration et expiration, droite et gauche, etc. Le neutre ouvre le passage discret d’une surface à une autre. Ce discontinu fait du diptyque le paradigme du récit (défini comme suite d’à-côtés où le langage s’emploie au déchaînage des causes).
Entre ne définit pas une dimension. La mesure de l’angle reste la même, quelle que soit la taille des murs, des toiles ou des pages. L’angle [plat] est sans échelle. À la question du centre, la fente d’air sans lumière qui fait tenir ensemble les deux surfaces substitue la question de l’entre-deux.
L’affect diptyque. Rien de moins monochrome, de moins abstrait. Chacune des deux surfaces, un condensé d’affects, stratifiés, ralentis, incorporés. Lent balayage des surfaces. Longs passages manuels. Lentes étendues. Volume plat consolidé par superposition-effacement des sous-faces (sous-chant).
Comment deux ? Deux surfaces ralenties s’augmentent par contagion. Deux volumes plats partagent une fente d’ombre. S’échangent là. Là valant pour ainsi. Une et une. Polyvalence de et. Par et s’échangent les affects, d’un volume plat à un autre. Sous la main et sous les yeux. Des surfaces glissent sous d’autres par contagion.
Le diptyque livre. Je pose l’hypothèse qu’un livre est la description des questions qu’enveloppe le diptyque nom & titre. Comment la peinture et le livre. La peinture entre dans le livre. Césure : le corps. La peinture questionne l’écrit. Elle souligne la question de l’écrit. Ou les diptyques bleus d’Un jour, le détroit. [La question des peintures de livre de Raquel est le paradigme de plusieurs de mes livres, p. ex. Une journée dans le détroit.]
Retournement du paysage. Un mur de jardin. Jardin et mur. Le mur est peint. Le jardin est devant. Le mur est blanc. Ou ocre. Les arbres sont devant. Nouvelle alliance entre mur et jardin : ce n’est plus la peinture qui déplie le paysage sur les murs intérieurs des viridaria, mais les végétaux (leurs agitations, leurs couleurs, leurs ombres mouvantes) qui s’incorporent à distance, dans la lumière du jour qui les sépare, au mur extérieur. Ainsi le livre ouvert. Un dehors.
In « Le cahier du Refuge 115 » Centre international de poésie. Marseille
-
Hubert Lucot

LE DEVENIR DE RAQUEL
La peinture de Raquel est spontanée ; elle n’obéit à aucun dogme. Mais chacune des grandes périodes de son oeuvre a été précédée par un silence correspondant à une intense réflexion.
La première grande période, celle des tableaux monochromes aux couleurs sombres, a couvert les années 1970-1983. L’originalité de cette pratique ascétique était la suivante : de grand format (3 m sur 6 m), les tableaux se groupaient en des diptyques ou des triptyques opposant deux ou trois couleurs voisines dont la jonction, qui marque une limite, constitue un travail de la différence.
Expositions notables :
1976. Galerie Arnaud. Paris
1982. ARC. Musée d’Art moderne de la ville de Paris
1983-1984. Vingt années de peinture en France :
Musée national de Berlin. Musée de Mayence, Musée de Tubingen
Très lentement, Raquel modula la monochromie, sans que de telles variations puissent assimiler sa manière à l’impressionnisme ou au nuagisme. En effet, la vibration exprimée et réalisée relevait de l’intériorité.
Expositions notables :
1984. Galerie Breteau. Paris
1990. Fondation Astrid Paredes. Caracas
Ensuite, Raquel fit évoluer cette modulation vers la polychromie, mais sa recherche de l’unicité, sa passion de l’Un, l’emportait, et l’univers de Raquel restait statique.
Exposition notable :
2000. Galerie d’art de l’Aéroport de Paris. Orly
À partir de 2000, l`univers de Raquel fut véritablement le Cosmos, en proie au devenir. L’irruption des couleurs matérialise un axe oblique qui traverse l’espace depuis le haut du tableau, à droite, jusqu’en bas, à gauche. Ce déferlement scriptural associa d’abord le bleu à sa déclinaison verte puis les deux couleurs au rouge, dont le jaillissement marque les œuvres actuelles avec crudité. Il est possible que dans les œuvres à venir la tension de l’oblique tende à se nuancer.
In « Le cahier du Refuge 115 » Centre international de poésie. Marseille