Édition
À propos des éditions de Flammarion
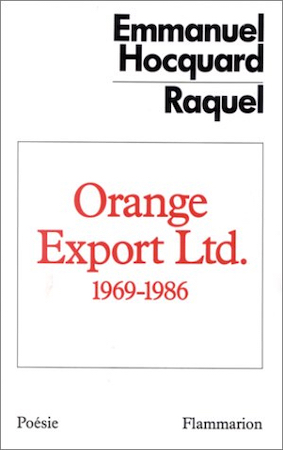
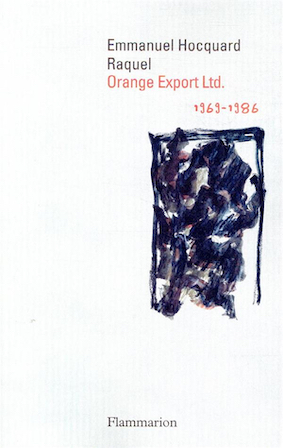
Pierre Vinclair : Orange Export Ltd. (1969-1986), Emmanuel Hocquard et Raquel
Le livre que publie aujourd’hui Flammarion est le fac-similé d’un ensemble important paru en 1986, qui permettait au grand public de découvrir une entreprise éditoriale confidentielle mais bouillonnante et déterminante pour une génération de poètes : la reprise en un seul volume de la multitude des publications (par Roger Laporte, Claude Royet-Journoud, Jean Daive, Franck Venaille, Hubert Lucot, Anne-Marie Albiach, Pascal Quignard, Alain Veinstein, Roger Giroux, etc.) de la maison Orange Export Ltd. Vingt-cinq ans plus tard et alors que ses deux instigateurs nous ont quittés (la peintre Raquel en 2014, Emmanuel Hocquard en 2019), la republication de cet ouvrage hors du commun n’a sans doute pas exactement le même sens qu’en 1986 : alors, la maison d’édition Orange Export Ltd. venait juste de cesser ses activités, et Hocquard n’avait pas encore la place cardinale qu’il a depuis acquise dans le champ poétique. La poésie objectiviste américaine, dont il fut l’un des introducteurs, était largement inconnue en France. Aujourd’hui, il s’agit d’un classique. Sa réédition a la vertu de remettre à la une, l’exigence salutaire et la radicalité qui manque à la poésie de notre époque. Lire la suite
---------------------------------- Publiées par Raquel Levy ----------------------------------
Avril 1994 . N°5 _____________________________________________________ 50 F
- Le 14 mai l993 a eu lieu à la fondation Royaumont une deuxième rencontre
- sur le thème « Le chiffre et la lettre ». Participaient à cette séance :
- Francis et Danièle Bailly, Claude et Chantal Birman, Régine Blaig, Gérard Calliet, Eliane Chemla, Gérard Cohen Solal, Serge et Anne Marie Gavronsky, Dominique Crèvecœur, Philippe Gumplowicz, Raquel Levy, Henri Meschonnic, Jean Yves Rondier, Anne Vernet et Manuel Zacklad.

LA POÉSIE, LA SCIENCE
par Henri Meschonnic
En agitant l'une contre l'autre ces deux notions de science et de poésie, je m'étais mis un peu en colère contre l'idée de ce heurt et cela m'a jeté dans celle de la poésie en tant que contre savoir.
Le point de départ fut donc pour moi ce heurt même des deux notions de science et de poésie. Il m'a semblé que l'on pouvait être entraîné dans toute une série de figures, figures de danse autant que de rhétorique puisque certaines figures vont vers l'opposition, d'autres vers la fusion et que l'on a affaire à un rituel déjà très abondamment illustré et critiqué.
Il me semblait avoir affaire à un débat à la fois scolastique et en même temps très vivant, ancien et constamment renouvelé, autrement dit dont on ne se débarrasse pas, parce qu'on y est personnellement situé. Ce que j'ai essayé de franchir et qui faisait la source de mon irritation, c'était cette impression, peut être fausse, de banalité que je rencontrais dans l'opposition de ces deux domaines, qui comportent certainement une frange commune, sinon on ne les opposerait même pas, évidemment. J'ai alors pensé à ce que fut, dans la tradition de la rhétorique arabe, la question agitée au Moyen Âge de savoir si la poésie était un art ou une science. Aux Xe et XIe siècles, les deux termes tendaient à se fondre. Ibn Rachik, par exemple, appelait la poésie « la plus grande des sciences arabes ». Ibn Khaldoun, dans ses Muqqadima, considérait la médecine et l’agriculture à la fois comme sciences et comme arts. Mais le terme arabe Sina'a semble avoir la valeur du terme aristotélicien tekhnè, c'est à dire savoir-faire plutôt qu'« art ».
Il est certain que la poésie et la science, dans ce qu'elles ont toutes deux d'exploratoire, peuvent être vues l'une et l'autre comme un rapport à l'inconnu autant qu'au savoir. Dans ces deux cas l'adversaire n'est pas l'ignorance, mais cette sorte spéciale d’ignorance qui est produite par le savoir, le savoir tout fait, le savoir de ce savoir. C'est à la frange de ce qui touche à l'inconnu, à l'impensé, que la science même devient un art et que les grands inventeurs sont des artistes du savoir, de même que les poètes sont des savants de l'imperceptible, du quotidien, de ce qui transforme les rapports que nous avons avec le langage, avec nous-mêmes et donc avec la poésie et la littérature.
Je crois que c'est justement cette transformation de l'imperceptible que j'appellerais « Poésie ».
De tous les clichés à affronter, le premier est sans doute celui qui place la science du côté de l'objectivité et la poésie du côté de la subjectivité. C'est une opposition spécieuse.
Je me réfère à un numéro de la revue Poésie 89 de décembre 89, qui contient toutes sortes d'interventions, dont certaines opposent la science en tant que rationalité à la poésie en tant qu’irrationalité, ce qui est en partie ce que je voudrais précisément critiquer. Dans ce numéro de Poésie 89, Jean-Marc Lévy-Leblond, par exemple, prend pour point de départ d'une pensée des rapports entre science et poésie l'éloge de la divergence. Son idée est que la science est du côté de l'ordre et la poésie, évidemment, du désordre. Je le cite : « Si la science s'efforce d'ordonner le monde et y réussit peut-être trop bien, ne doit-on pas attendre de la poésie qu'elle le dérange ? » À mon sens, pour éviter un cliché il tombe dans un autre.
Je crois que c'est encore là une vue dualiste et, du coup, conventionnelle, dans la mesure où j'identifie implicitement conventionnel à dualiste, ce qui implique que la réalité est infiniment plus compliquée que toute binarisation. Et l'opposition poésie science est une binarisation.
Il y aurait au contraire à les voir toutes deux comme une pluralisation sans fin. La poésie serait alors une historicisation de l'infini du sujet et la science une historicisation de l'infini de l'objet par un sujet. Car dans les deux cas il y a un sujet. Évidemment, ce n'est pas le même.
D'ailleurs déjà Jean-Marc Lévy-Leblond insistait lui aussi sur le pluriel de « les sciences » plutôt que « la science ». Sans doute faudrait-il dire « les poésies » comme on dit « les vers » et dire également « les proses »…
Quand il parlait des sciences, il pensait bien sûr aux sciences du vivant. Il y a « les arts et les sciences » et, bien sûr, « les sciences humaines ». Toute la question de leurs rapports serait fonction, d'une part, d’une poussée vers une essentialisation — et chaque fois qu'il y a essentialisation, je crois qu'il y a unification mythique de chacun des termes : on retrouve un singulier — et, d'autre part, de cette pluralisation interne et externe qui conditionne la finesse et le renouvellement des notions. Le cliché de l'opposition entre ordre et désordre se retrouve d'ailleurs dans l'opposition prose-poésie : c'est toute l'anthropologie du XIXe siècle et l'idéal de la prose dans la prose scientifique de Claude Bernard. La prose étant rationalité explicative, et la poésie émotion et suggestion.
Mais il n'y a sans doute pas de mesure commune entre les inventions scientifiques, l'accélération qui semble les accompagner et l'incapacité assez générale des non scientifiques à comprendre et imaginer, c'est à dire chez eux une très grande pauvreté par rapport ã l'imagination scientifique. Pourtant l'invention scientifique et l'invention poétique ou littéraire au sens large semblent parfois s’interpénétrer et même jouer à se devancer l'une l'autre, si l'on considère par exemple Léonard de Vinci, Cyrano de Bergerac ou Jules Vernes. Bien que je pense personnellement qu'il n'y a aucun rapport et que cela va peut-être choquer, rien ne m'apparaît plus réactionnaire sur le plan de l'invention que la science-fiction, plus pauvre en imagination, conventionnelle et antipoétique. On y trouvera presque toujours un archaïsme et une violence fondés sur des modèles médiévaux, ce qui est extrêmement drôle lorsque cela se confronte à un « matériel », lui, complètement futuriste.
Tournant ainsi entre ces deux pôles, science et poésie, il me semble que le problème actuel est que nous sommes contemporains d'un nouveau « scientisme », nouveau par rapport à celui, sûr de lui, de la fin du XIXe et du XXe siècle, scientisme qui était celui de la république universelle de Hugo, d'Anatole France, et qui vivait dans l'ordre du savoir ; c'était aussi l'Encyclopédie de Marcelin Berthelot, Plein ciel, vers 1880, etc. Le scientisme d'aujourd'hui est, à mon sens, celui des sciences cognitives. C'est ce mariage les yeux fermés du « dur » et du « mou » sachant aussi que le « dur » est en réalité ce qui ramasse le plus d'argent auprès des crédits officiels, et que le « mou » est ce qui a peu d'argent, et c'est mou parce qu'il y a peu d'argent et non parce que cela manque de concepts ou que ceux-ci seraient mous... Ce mariage les yeux fermés du dur et du mou est pour moi le mariage de la neurobiologie, de la psychologie et des sciences du langage avec la théorie de la littérature. C’est un vieux problème : il me semble qu’on retrouve, dans cette néo-pensée à la mode qui, d’ailleurs, recourt très souvent à la simplification atroce du langage des « sciences de l’information » des années 50, le mythe du XIXe siècle, né à la fin du XVIIIe siècle, de l’unité épistémologique des sciences de la nature, des sciences humaines et des lettres.
Ce mythe est récurrent dans les années 70 : Jakobson et je ne sais plus quel prix Nobel de biologie ou de chimie français s’émerveillaient du fait qu’ils partageaient un même langage, c’est-à-dire que des termes comme « code » génétique ou « message » donnaient l’impression que langage et biologie procédaient d’éléments communs entre eux. Alors qu’ici, en réalité, le problème est très précisément celui de la métaphore... Évidemment tout cela devient très vite polémique, ce qui est inévitable lorsqu’on débat de choses qui vont dans des directions très différentes. Mais il y a pour moi un exemple qui me semble emblématique de ce rêve d’unité : c’est Kenneth White et ses Cahiers de géopoétique. Ce qui est très curieux, c’est que le monde blanc métaphorise le nom même de White !
Là aussi je me réfère à ce numéro de Poésie 89 : sa fiction poétique voudrait englober les sciences et la poésie, qu’il oppose à l’histoire. Je cite : « Depuis Hegel, nous avons quitté le monde pour entrer dans l’histoire ». Toute l’ironie de cette position d’union et d’unité de la science et de la poésie s’exprime par un appel au futur qui se fait dans les termes du mythe hégélien de la fin de l’histoire. Or qu’est-ce, du point de vue poétique et du point de vue de la théorie du langage, que cette unité de la science et de la poésie ? Je crois que c’est l’union, unité, de l’homme et du monde, c’est-à-dire des mots et des choses. Et pour moi l’unité des mots et des choses, c’est la définition même du sacré. Je n’ai rien contre le sacré. Mais ce qui me semble très dangereux pour la poésie, c’est d’identifier la poésie et le sacré. La poésie peut tendre vers le sacré.
Il y a un exemple magnifique qui illustre tout cela, celui d’un vers de Hölderlin interprété par Heidegger. Hölderlin écrit : « Und was ich sah-das Heilige sei mein Wolt.› » (« Et, ce que j’ai vu : que le sacré soit ma parole. ») « Das Heilige sei » est un subjonctif. Heidegger interprétait ce vers, avec ce subjonctif, ce souhait, à l’indicatif, comme si Hölderlin avait écrit : « Et, ce que j’ai vu : le sacré est ma parole. » Voilà dite toute la différence entre la poésie et ce « décisionnisme » de Heidegger qui en vient à identifier poésie et sacré.
Je crois qu’il n’y a pas plus mortel pour la poésie que cette identification, justement parce qu’elle se met du côté du plus fort, du gagnant. C’est la reprise du rêve unitaire du XIXe siècle hégélien qui est, à mon sens, purement théologique : le bon infini, la conciliation et donc l’unité également de l’épistémologie, des sciences de la nature et des sciences de l’esprit, c’est-à-dire des sciences historiques.
À partir du moment où il y a cette identification entre poésie et sacré, la poétique précède forcément la poésie, ce qui est pour moi la définition même de la mauvaise poésie. Hugo dit quelque chose comme cela. Quand la poétique est avant, quand l’aventure poétique a le dos à la poésie, c’est-à-dire quand on sait ce qu’est la poésie, c’est foutu. Il faut que la poésie soit en avant du poème, que le poème ne sache pas ce qu’est la poésie, autrement dit l’aventure du poème est justement de ne plus savoir ce que c’est que la poésie.
Dès que le poème sait ce qu’est la poésie (et cette identification du sacré et de la poésie est un savoir, une certitude), l’effet immédiat est que le poème devient l’énoncé de son programme et donc forcément, à mon avis, un mauvais poème. C’est également immédiatement de la mauvaise philosophie, et c’est ce qu’on voit très abondamment chez Michel Serres. Ce qui est significatif est ce qu’il en avait dit il y a environ un an dans une page débat du Monde : « On s’est assez occupé du langage, revenons enfin aux choses sérieuses, aux choses mêmes. » Comme si l’on pouvait parler « des choses mêmes » sans le langage...
Je bute maintenant sur une autre figure de danse, de désir (parce qu’il y a manifestement un désir d’union entre science et poésie), c’est la Nouvelle Alliance, le fameux livre d’Ilya Prigogine et Isabelle Stengers. Cela m’avait longtemps énervé et c’est seulement maintenant, en réfléchissant sur ce sujet, que j’ai compris quel « coup » on voulait nous faire. Je dirais que c’est le coup du « Verus Israël » une fois de plus, « la nouvelle alliance ». Parce que « la nouvelle alliance » est bien quelque chose qui s’oppose à l’ancienne. Sous ce titre symbolique, il s’agit donc d’une métamorphose de la science qui évoque bien une religion nouvelle, l’Ancienne Alliance étant celle de Dieu avec son peuple, cette alliance-ci étant celle de Dieu-la nature-la science avec son peuple l’humanité.
L’animateur de Poésie 89, Pierre Dubronquez, en tête de ce numéro spécial qui était intitulé d’ailleurs « Vers une nouvelle alliance », le reconnaissait bien. Il parlait, je le cite, du « vœu, majeur, de l’homme de ce temps de se réconcilier avec le monde en se réconciliant avec lui même » et évoquait le rêve « d’un âge d’or de la conscience où les noces de l’esprit et de la matière » seraient célébrées « dans un spiritualisme cosmique ».
Dès lors mon hypothèse, qui est en même temps une situation que je n’ai pas la liberté de choisir, consiste à dire que tout en reconnaissant qu’il y a ce besoin d’unité qu’on ne peut nier, ce besoin d’unité qui rassemble tellement la poésie et qui ressemble tellement à la poésie est au fond ce qu’il y a de plus étranger et de plus hostile, non seulement à la poésie et au poète, mais aussi à l’homme ordinaire qui n’est pas poète, qui lit ou qui ne lit pas des poèmes, mais dont la poésie est inévitablement la parole sinon le porte-parole, ce qui donne à la poésie quelque chose d’emblématique du langage ordinaire.
La poésie pour moi ne vit donc que de désunité, de diversité et de radicale historicité, c’est-à-dire qu’il y a lieu chaque fois d’essayer de faire la différence entre la poésie et les idées qu’on a sur la poésie, sur le rôle qu’on lui fait jouer ou que lion croit qu’elle joue. Le sacré est l’un de ces rôles et la figure d’union entre science et poésie serait de ce côté-là.
Encore une fois, il n’est pas question de nier qu’une telle figure corresponde à un besoin, mais je mettrais ce besoin, tout comme celui de la spiritualité religieuse ou para religieuse, du côté par exemple de l’irrationalisme contemporain, du renouveau de l’astrologie. Cela correspond certainement à une angoisse, autrement dit à des remèdes magiques. L’union des mots et des choses est, du point de vue du langage, la magie même et cela induit toujours des pensées unionaires.
Alors, bien sûr, cela peut aller vers des choses très belles du point de vue éthique, par exemple le recours aux sagesses d’Extrême Orient. Elles sont belles, mais, du point de vue de la poésie, ce sont des réponses et dès qu’il y a réponse, à mon sens, il n’y a plus la poésie, mais une idée de la poésie : il y a la recherche d’un confort.
L’exemple le plus notoire de ce cadre archimillénaire de la « pensée de la poésie » est, dans son plus beau spécimen, l’anthropologie binaire du XIXe siècle, celle de Lévy Brühl qui partageait la rationalité toujours parfaitement en deux, le rationnel-l’irrationnel, la raison-l’émotion, la science,-la poésie, le logique-le prélogique. Et du côté logique, il y avait l’homme masculin « normal », blanc, adulte, le mâle blanc, de l’autre côté il y avait la femme, l’enfant, le sauvage, le poète et le fou. Ce n’est pas une interprétation, c’est littéralement dans Lévy Brühl, jusqu’à ses Carnets où il renonce à peu près à ce binarisme. Mais c’est enfin une anthropologie qui fonde la logique même du colonialisme du XIXe et de toute la première partie du XXe siècle. Je crois que cela a commencé à se défaire à la fin des années trente. Et ce qui est très remarquable, du point de vue de l’effet de l’art sur la pensée de la société, c’est que cela ne semble pas séparable du primitivisme, c’est à dire de la découverte par les peintres à partir de l904 de l’art africain et océanien en tant qu’art, alors que jusque-là, ce n’était que du matériel anthropologique et ethnologique.
En même temps et inversement, cette découverte de l’art « nègre » comme art a évidemment suscité à la fois l’art du XXe siècle et la perception de l’Afrique et de l'Océanie en tant qu’arts, donc un effet dans deux directions. Dans la mesure où la modernité poétique, depuis Baudelaire et Rimbaud, s’est souvent identifiée à l’évocation nostalgique d’un paradis perdu, il me semble que cet ensemble même de représentation de la poésie s’inscrit dans le schéma binaire et linguistique du signe. C’est-à-dire que plus on a une idée « poétique » de la poésie, celle justement qui va vers le sacré, plus on est amené à penser que la seule capable de retrouver ce paradis perdu, c’est la poésie : c’est le rôle de la poésie dans le signe. Autrement dit, plus on a une idée poétique de la poésie, plus on reste dans le monde le plus antipoétique qui soit, c’est-à-dire dans le monde du signe. Cela procède exactement comme le blasphème : plus celui-ci va à l’opposé de ce à quoi il croit s’opposer, plus il confirme évidemment ce cadre même, puisqu’il reste dans la foi et la religion sans lesquelles il n’aurait plus d’effet. Ce schéma linguistique contient tous les paradigmes du signe, ce qui me porte à croire que, du point de vue de la poésie, il y a aussi à penser la poésie autrement que selon la figure de « sortie du signe » qui vient d’Artaud et de Bataille, qui a marqué tout le modernisme et qui le marque encore maintenant sans doute, toute cette « nietzschéisation » du langage et de la société, qui fait le mime de la folie, mais qui n’est qu’un mime justement. Le très grand paradoxe de ce modernisme, c’est de n’engendrer que du mime, c’est à dire par définition même, à mon avis, de la mauvaise poésie parce qu’ici, de nouveau, la poésie a derrière elle une certitude de ce qu’est la poésie.
Ce rôle de rattrapage du paradis perdu, d’antiarbitraire du signe, de substitut du sacré, d’ersatz de l’union primitive des mots et des choses, c’est à quoi s’oppose l’historicité radicale de la poésie et ce que j’ai appelé, dans La rime et la vie, l’athéisme du rythme, athéisme d’un tout autre ordre que l’athéisme au sens religieux du mot, et à entendre dans celui où les artistes des époques religieuses mêmes, qui étaient certainement tout à fait des croyants, font de l’art dans la série propre de l’art. C’est le problème de la spécificité de l’art et donc celui, je crois, de la réhabilitation de cette notion très, très mal comprise de Baudelaire de « l’art pour l’art ». Elle a été comprise comme un esthétisme alors que je crois qu’il s’agit de l’intuition d’un rapport entre art et sujet, entre art et éthique, qui intériorise l’éthique et même le politique dans le poème. Avec ce problème, c’est celui tout entier de la modernité poétique qui est en jeu. Il est vrai qu’il y a eu toutes sortes de liens entre la forme poétique et la réflexion scientifique. Mais Aristote déjà faisait la différence, dans la Poétique, entre Homère et Empédocle, c’est à dire entre la poésie et les vers. Ce n’est pas parce qu’Empédocle écrit en vers que c’est de la poésie. Il n’y a peut-être que Lucrèce qui reste un exemple, à ma connaissance unique, non pas d’une science ou d’un savoir mis dans la poésie, mais de l’union même d’une vision « scientifique », au sens de connaissance du monde, et d’une vision poétique du monde. Ensuite, si on pense à d’autres exemples comme la Semaine de du Bartas au XVIe siècle, je crois que ce ne sont plus que des représentations du monde en forme poétique. Il y a peut-être l’exception de la poésie alchimique du XVIe siècle ou le cas assez particulier des Chimères de Nerval et de certains poèmes d’Yvan Goll. Mais par exemple tout Saint-John Perse, à mon sens, est une sorte d’identification énumérative du monde, une sorte d’encyclopédisme poétique et cela n’entre pas dans cette série. Alors qu’inversement, on peut voir une autre figure qui est assez rare : c’est la transformation de la poésie en fonction d’une vision supposée scientifique du monde, et c’est le cas de l’œuvre poétique de René Ghil, de ses poèmes proprement dits, alors que l’on n’édite plus de lui que le Traité du Verbe. Il y a donc des impressions de science sur la poésie. Il y a là, en chemin, des gens comme Valéry, comme Roger Caillois et, de nouveau, on rencontre deux sortes de mime : il y a un mime interne qui est celui du calcul, de la contrainte codée, et qui me semble fondé sur une idée mimétique de la science, et il y a le mime externe, fondé, lui, en fonction des savoirs. C’est par exemple le cas, mais très ironique, de l’Immaculée Conception d’Eluard et de Breton, qui est imitation volontaire. Il y a le problème du jeu, qui est très pervers, à mon sens, dans la mesure où, en passant de Queneau à l’OULlPO, on passe de quelque chose qui est assez mystérieux (car je ne sais pas exactement quelle est la « formule chimique » de la drôlerie de Queneau) à autre chose. Car le problème, ici, est que Queneau est drôle et l’OULIPO ne l’est pas. Je crois que cela tient à ce passage vers la notion fonctionnaliste de jeu, qui aboutit de nouveau à des programmations mimétiques. Autrement dit, il y a une mathématisation ludique ou post ludique qui cherche à réintroduire le calcul et qui est très ambivalente, puisqu’en même temps, dans les textes programmatiques de l’OULIPO, il y a la déclaration répétée qu’on ne fait pas de la littérature, mais en même temps les ateliers d’écriture jouent manifestement le sérieux et, tout en contrecarrant une idéologie spontanéiste, la contrainte devient quelque chose qui revient à ce qu’elle critique dans la mesure où le problème de la poésie est sans doute qu’elle ne passe ni par le calcul ni par l’absence de calcul.
Alors, sur le chemin du Petit Poucet qui traverse toute cette forêt de symboles, il y a encore toutes sortes d’autres clichés. Du côté « nature », il y a « l’enfant-poète » (ça c’est le plus délicieux, l’enfant-poète !). Le poète-enfant me semble faire partie des illustrations du spontanéisme reliées à une vieille comparaison -Nature. Derrière cela, il y a l’homologie entre l’individu et l’espèce, et le « jour ». Il est remarquable que, dans Beaufret, dans Heidegger, revient toujours cette comparaison entre le matin de la vie et le matin du jour, le midi de la vie, le soir de la vie, etc. Cette très, très anciemie comparaison entre l’humain et le cosmique, enfance maturité vieillesse, qui a même été appliquée aux langues et que déjà rejetait Humboldt, dit tout le problème de la spécificité et de l’historicité du langage. Il y avait donc bien une dénonciation de la confusion entre science et poésie dans ce numéro de Poésie 89 à travers plusieurs contributions, celle qui était fondée en science, comme celle de Jean-Marc Lévy-Leblond, d’autres qui se fondaient sur la philosophie de Bachelard. Sans faire la critique de cette autre identification chez Bachelard qui a, à mon sens, fourvoyé toute une génération — et quand j’étais jeune, j’étais évidemment fasciné par les livres de Bachelard sur la poésie, jusqu’au moment où j’ai compris que c’était complètement stérilisant parce que la poésie y était identifiée aux éléments, donc aux choses — et on retrouve là la poésie des choses. Mais c’est un clair de lune, ce que savait très bien Mallarmé, qui disait de la lune : « Elle est poétique, la garce... » On retrouve ici un autre aspect de la défense de la poésie, qui dit : « La poésie échappe à la poétique. » C’était une autre intervention, de Luis Mison, Espagnol, dans ce même numéro de Poésie 89. Je crois qu’on peut dire que la poésie échappe à la poétique, oui, quand la poétique procède de la poésie. Mais si la poétique n’est rien d’autre qu’une réflexion qui se forme à partir des transformations du poème, la poétique ne peut pas être ce à quoi la poésie échappe, au contraire, la poétique est ce qui s’échappe du poème, qui attaque les autres savoirs et qui les remet en cause. C’est donc en ce sens que je dirais qu’il y a un contre-savoir dans la poésie, dans la poétique qui s’en dégage et qui n’en est que l’accomplissement réflexif. C’est l’infini qu’il y a dans un poème et qui, en fait, n’a pas de nom. Il se trouve qu’il y a quelques mois j’ai relu la Poétique d’Aristote et je me suis rendu compte d’une chose qui ne m’avait jamais frappé auparavant. On dit toujours, à partir du titre du livre d’Aristote, qu’il s’agit d’un livre sur la poétique. Ce sont les deux premiers mots : « Peri Poiêtikês ››. Mais je me suis aperçu que ce n’est pas cela le titre du livre d’Aristote, mais plutôt « Sur la poétique même » : « Peri Poiêtikês autès », « autès » est le troisième mot. Et pourquoi » ? Parce qu’au tout début de son texte, Aristote dit que l’objet de la poétique n’est pas d’étudier la comédie, la tragédie, non plus que d’étudier ce qui est métrique par opposition à ce qui n’est pas métrique, mais ce qui est sans nom jusqu’à maintenant : « anonymos », ce qui est anonyme. Cela m’a frappé comme étant quelque chose qui est toujours vrai, c’est-à-dire que l’objet de la poétique est en effet ce qui n’a pas de nom, ce n’est pas simplement la connaissance de ce que c’est qu’un vers ou de ce que c’est que de la prose. Et du coup, c’est immédiatement un inconnu qui se dédouble parce que si l’objet de la poétique est l’inconnu dans le langage, c’est immédiatement le propre inconnu du langage, l’inconnu des concepts avec lesquels on pense le langage. C’est en ce sens, je crois, que la poétique se sépare de l’esthétique telle qu’on en trouve la définition chez Kant dans la Critique de la faculté de juger : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept. » Sans doute est-ce vers sa propre ignorance que va la poésie, et c’est par sa propre ignorance qu’elle acquiert une capacité critique et particulièrement de critique des savoirs d’époque. La poésie n’a pas à le savoir, elle n’a pas à être son propre savoir, et c’est précisément quand elle montre d’abord son savoir de la poésie qu’elle manque la poésie. C’est ici qu’intervient alors le plan du rythme, dans la mesure où je crois que seul le renouvellement de la notion de rythme peut faire la critique du signe, c’est-à-dire de la rationalité binaire. Je m’appuie évidemment sur mon propre travail de critique du rythme pour essayer de penser ce statut du langage dans les savoirs contemporains, ce à quoi me pousse cette mise en opposition de la science et de la poésie. On rencontre ici cette notion tellement rebattue aujourd’hui de « sujet », qui a été prise comme propriété de la psychanalyse, alors que dès Freud, on lit explicitement que la psychanalyse n’apprend rien de ce qu’est le sujet du poème. Il y a, sans doute, confusion entre plusieurs sujets, et le sujet du poème n’est pas le sujet dont parle la psychanalyse. C’est sans doute uniquement par ce que j’appelle emblématiquement « poème » (et qui peut être aussi bien n’importe quelle œuvre littéraire) qu’apparaît un élément instable, fragile, incertain, qui est constamment confondu avec l’individu ou avec le subjectivisme. Tous les sociologues qui nous parlent maintenant du retour du sujet parce que nous serions apparemment dans une ère post-structuraliste reconfondent, je crois, individu et sujet, c’est-à-dire que l’on retrouve les effets du signe, de la perversité du signe.
Et, pour mettre à nu ce que j’appellerais une éthique de l’historicité, une éthique du poème, il faut essayer de penser l’éthique et le politique à travers le poème comme mutuellement nécessaires l’un à l’autre, sinon on a l’éthique à part, le politique à part, c’est-à-dire Sodome, puis la poétique à part, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus lamentable au XXe siècle : le formalisme poétique, le formalisme des idées sur le langage. Ce qui fait la richesse du structuralisme, de l’analyse des « Chats » de Baudelaire par Jakobson et Lévi-Strauss par exemple, c’est que ce sont de petites merveilles techniques d’horlogerie, mais qui ne sont en aucun cas les premiers éléments de la question : « Qu’est-ce que c’est qu’un poème, et comment faire la différence entre un poème et ce qui ressemble à un poème ? » Je crois que c’est là le problème essentiel de la poésie qui, en se cognant entre les murs, avance à travers des séries d’oppositions binaires pour aboutir finalement à un rapport entre poésie et éthique propre à la poésie et qu’on retrouve, je dirais, comme absence, particulièrement dans le domaine français. J’ai été très frappé, au hasard des lectures, de voir combien les traditions « à la française », depuis le surréalisme, excluent un certain nombre de choses : par exemple, le surréalisme a fait barrage à l’expressionnisme dit « allemand » et à la postulation éthique dite « slave » chez des gens comme Alexandre Bloch et Tsvétaïeva, ainsi que chez des Polonais comme Gombrowicz : je pense à son essai La Haine des poètes, où il attaque ce qu'il appelle l’attitude religieuse, par quoi il ne désigne pas les mauvais poèmes, mais au contraire les plus beaux poèmes. Et l’attitude religieuse est exactement ce que je comprends par le sacré comme union des mots et des choses.
C’est donc un problème de la poésie elle-même, celui de sa propre éthique, qui me fait redécouvrir avec beaucoup d’admiration Baudelaire par exemple, lorsqu’il dit dans un de ses articles de l’Art romantique en l859, en des termes étonnamment modernes : « l’art moderne, c’est l’union du sujet et de l’objet. »
Il y a aussi au passage une mise ensemble du concept de modernité que réinvente Baudelaire avec celui de sujet et d’éthique. C’est assez étonnant, dans la mesure où, en même temps, cela s’inscrit dans la pensée de ce que Baudelaire appelle « la petite vie ». Tout cela donne ce que j’appellerai une absence du russe dans la poésie française. C’est un constat, celui du vide de l’éthique dans la poétique française, structuraliste et néostructuraliste. L’éthique est pour moi l’accompagnement d’un vide du sujet. C’est donc inévitablement de l’utopie puisque ce n’est pas un mode de pensée à quoi toutes les traditions du XXe siècle font la place, c’est une postulation de l’inséparabilité du poème, de l’éthique et du politique. En ce sens, la connaissance poétique réalise bien une sorte de coïncidence des contraires qui apparaît, se révèle, mais qui en même temps se théorise rarement à travers tout ce que l’écrit des poètes sur la poésie décrit dans sa démarche oraculaire. Le peintre, au moment de prendre son pinceau, doit à la fois tout savoir et tout oublier. De même pour la critique de la poésie. Je crois que c’est vital, non pas tant pour la connaissance de la poésie déjà faite (la poésie n’est pas l’histoire de la poésie, c’est chaque fois à la fois tout ce qu’on sait de la poésie et tout ce qu’on n’en sait pas), mais pour le poème à faire, beaucoup plus important que la masse des poèmes connus et déjà faits. Donc cet effet critique passe certainement par la méfiance de ce qui ressemble à la poésie. Du coup cela déplace la notion du facile et du difficile, la pensée du langage, de l’éthique du langage et, ma foi, même si c’est utopique, cela rejoint ce regard sur la théorie et sur les pratiques qui aboutit à une sorte de rire, qui n’est pas celui du ludique, car, paradoxalement, le ludique ne rit pas (et ne me fait pas rire : le ludique se prend au sérieux). Non, c’est forcément une sorte de rire du théâtre de Guignol. Tout le monde ne peut pas avoir le rire des dieux d’Homère […]
DÉBAT.
« Le chiffre et la lettre »
Gérard COHEN-SOLAL. L’art africain, quand on ne le connaissait pas, était quand même déjà de l’art africain. Il n’y avait pas d’élaboration très structurée de ce qu’est l’art, de ce qu’est l’œuvre créatrice, mais il y avait des contraintes réelles et c’est aussi l’expression d’un milieu, d’une religion, d’une philosophie, de règles de droit. Il y avait tout cela. Ce n’est pas parce qu’il était inconnu qu’il n’existait pas.
Ceci pour en revenir aux poèmes : ce n’est pas l’écriture ou la lecture qui fait le poème. Le poème est là. Dès lors qu’on le lit s’effectue un travail de re-création. Les sensations, les sentiments esthétiques, le bonheur profond qu’on éprouve trouvent leur origine maintenant, au moment où on lit, et non pas au moment où il crée. Et cela est différent d’un moment à un autre. Donc l’historicité que j’accepte parfaitement est le fait que, durant tout le temps des sociétés et des hommes, cette œuvre se revivifie, trouve des beautés qui n’y existaient pas, qui n’y étaient pas délibérément inscrites.
Ce qui me gênait un peu était l’affirmation que l’écriture, donc l’enseignement, était la condition d’accès à ces œuvres, à cette beauté, alors que je pense que c’est simplement un moyen technique comme un autre de fabriquer sa propre beauté sur le support qui lui est offert.
Henri MESCHONNIC. Oui, mais pour cela il faut tout de même qu’il y ait lecture !
Régine BLAIG. Cela dit, l’art africain n’existait pas tant qu’il n’a pas été découvert, tout comme le temps n’existe pas en dehors de l’être humain. Tant qu’on ne compte pas le temps, il n’existe pas... Mais ceci est une autre polémique.
L’art africain était une production locale, chaque fois différente, de gens qui en avaient besoin pour leur propre fonction. Plus c’était beau, plus cela devait fonctionner. Mais ce n’était pas de l’art au sens européen du mot. Ce n’est devenu « de l’art africain » — et d’une façon très uniformisée qu’à partir du moment où on en a eu connaissance et qu’on y a porté un certain intérêt. Mais pour les gens qui le produisaient, cela n’avait pas une fonction d’art.
Henri MESCHONNIC. Oui, ce n’est pas de l’art au sens où en Europe l’art s’est séparé de la religion. Je crois que d’après les textes des spécialistes de l’art africain, il y a une sorte d’indifférenciation entre le sentiment esthétique, car il est absurde d’imaginer que dans l’art cultuel africain les gens n’avaient pas de sentiment esthétique ; au contraire, comme tu le dis, ils avaient bien le sentiment que plus quelque chose était beau, plus c’était efficace. Une efficacité cultuelle n’était donc pas séparée de la valeur d’art.
Dans le fond, l’art des sculpteurs des églises du Moyen Âge était un peu cela aussi. Il n’y avait sans doute pas de séparation entre Part comme art et Part comme expression d’une foi.
Gérard COHEN SOLAL. Quand je dis « cet art existait », je dénonce le fait qu’à un moment donné nous avons dit : « Tiens, ça, c’est de l’art », comme si auparavant ça n’existait pas. Il a fallu qu’on reconnaisse et qu’on investisse les Africains d’un statut associé à notre regard et à notre critique pour dire : « Il y a un art africain. » Or je dis que ce n’est pas à partir du moment où l’on dit « il y a un art africain » que l’objet acquiert un statut d’œuvre d’art...
Henri MESCHONNIC. Ça dépend pour qui... Pour reprendre cet exemple de l’art africain qui est très intéressant, il y a déjà des cabinets de curiosités où des princes européens collectionnent des objets d’ivoire, par exemple des Portugais, dès la fin du XVIe siècle. Les voyages du XVIIIe et du XIXe siècle ramènent plein de choses, mais cela entre dans des collections privées ou des musées pêle-mêle. Quand on voit des photos des anciennes dispositions des vitrines des musées du XIXe siècle, on voit bien la façon dont les objets étaient exposés : cela montre pêle-mêle les objets d’artisanat, culinaires, etc. et les masques. C’est chez les peintres, par exemple, qu’apparaissent des masques africains aux murs. Ce sont donc les peintres qui commencent à voir cela comme de l’art, séparé des cuillères et des casseroles. Alors que les musées entassaient énormément de choses qui restaient, pour les muséographes et les ethnologues, matériels de la vie, anthropologie. C’est cela qui est beau dans cette histoire : ce sont les artistes européens qui « inventent » l’art africain comme art. Maintenant s’il est difficile de savoir ce que c’était pour les Africains eux-mêmes, ils ont tout de même inventé des formes d’art extraordinaires !
C’est tellement pas naturaliste, tellement « cubiste » parfois selon les arts, qu’ils savaient bien ce qu’ils faisaient, d’une certaine façon. Ils voyaient bien que cela ne ressemblait pas à un corps humain ordinaire ! Donc c’était de l’art, oui, mais pas séparé, pas différencié au sens du « marché de l’art » que nous connaissons aujourd’hui.
Régine BLAIG. Selon leurs convictions, c’étaient des objets destinés à être brûlés ou abandonnés aux termites, ou au contraire gardés le temps d’une vie, puisqu’ils représentaient par exemple le mari ou la femme de l’au-delà de chacun d’entre eux, ou bien des couples de jumeaux que l’on gardait jusqu’à l’extinction de l’un d’entre les vrais jumeaux. Ce n’était pas une forme d’art, mais une forme de fonction.
Henri MESCHONNIC. On joue sur le mot « art » ici, au fond.
Claude BIRMAN. Je reviens sur le rapport entre le colonialisme, que tu as évoqué, et l’art africain, par une anecdote, pour aller dans ton sens, sur ces spécialistes de la mythologie des Dogons qui élaboraient tout un tas d’interprétations et qui, un jour, alors qu’ils étaient en train de discuter, se font déranger par un Dogon qui leur tape sur l’épaule en disant : « Nous avons aussi notre interprétation de nos mythes », qu’on ne leur avait jamais demandée...
Alors, cette espèce de chosification — traiter les faits sociaux comme des choses — ça peut mener loin. Effectivement il ne faut jamais oublier, et notamment lorsqu’on parle d’art, que les gens qui produisent des œuvres ont aussi leur propre approche de ce qu’ils font. Ce sont des hommes.
Et je crois que ce respect de la culture de l’autre est le début d’une manière de se débarrasser des catégories toutes faites, que tu essayais de détruire.
Lorsque, dans notre tour de table des présentations, tu disais : « Je produis je ne sais quoi », on comprend maintenant que ce « je ne sais quoi » n’est absolument pas n’importe quoi, mais au contraire, par excellence, ce non-savoir dont tu parles dans la poésie, comme tu l’as montré avec Aristote : ce qu’il s'agit de dire, dans le poétique, c’est justement ce qui excède les catégories attestées. En cela, on peut supposer que l’Africain qui composait la statue de son épouse savait très bien lui aussi qu’il visait quelque chose au-delà de ce qui est attesté. Et, de ce point de vue, il y a une universalité de l’art, en ce sens que ce qui est produit résiste à toute réduction à une fonctionnalité, par exemple.
Et ce que j’ai trouvé le plus éclairant, sur le plan philosophique, c’est cette discussion sur ce thème « objet cultuel-objet fonctionnel », auquel je reviendrai plus tard. Mais tu opposais l’objet d’art à la petite cuillère (commencer à séparer les objets d’art des petites cuillères) : c’est un problème. Bien sûr, on peut dire que l’objet d’art est l’objet qui n’a pas de statut fonctionnel. Mais en un sens c’est dommage, parce que cela veut dire justement que l’objet fonctionnel cesse d’être signifié, cesse d’être plus que lui-même. Or, la signification, c’est de signifier justement le fonctionnel. Et par conséquent, s’il n’y a pas dans l’objet cultuel, masque africain, de différence entre ce qui est artistique et ce qui est fonctionnel, cela peut prendre alors deux sens, et ce qu’il y a peut-être à interroger n’est pas tant l’objet d’art mis à part du fonctionnel que l’articulation des deux : comment se fait-il qu’il y ait des objets qui puissent prendre un sens dénué de ce statut artistique, et comment se fait-il que, pour leur assurer un statut artistique, il faille les mettre à distance du fonctionnel ?
Philippe GUMPLOWICZ. Est-ce que ce n’est pas Baudelaire qui a justement enregistré cette espèce de divorce, daté historiquement, où tout se trouve réduit à la seule subjectivité du poète ? Il y a eu cette sorte de divorce, provoqué historiquement : on a exclu tout aspect fonctionnel éventuel de ce qu’on appelle « art » tel qu’on l’entend encore en ce moment. Et Baudelaire en parlait comme d’une espèce de déchéance : après tout, prenons acte d’être exclus, soyons magnifiques dans le fait d’être exclus... Mais cela correspond à un mouvement qui n’est pas un mouvement de nature, mais un mouvement culturel, cette division forcée, et qui n’est pas vécu du tout comme étant un bien par Baudelaire lui-même.
Henri MESCHONNIC. Effectivement, Baudelaire, dans « Le peintre de la vie moderne », critique les peintres contemporains qui représentaient des personnages en costume grec. Ce qu’il voulait, c’était qu’on les représente avec les vêtements du quotidien. Et c’est ce qui fait qu’en un sens il refuse la différence entre le « grand art » et le « petit art » : il valorise beaucoup les images de mode et ce qu’il appelle « la petite vie » (je trouve cette expression extraordinaire, la « petite vie »). C’est la réaction de Baudelaire contre un art complètement académique.
Francis BAILLY. Il y a des personnes qui posent la question de l’éthique des théories scientifiques, et pas seulement de l’éthique, mais de la théorie elle-même, et puis d’autres personnes qui se posent des questions relativement à l’esthétique des théories en ce domaine. Et on peut se dire qu’il y a effectivement, bien que ce soit toujours écrit dans le même langage, mathématique ou formel, des bonnes théories et des mauvaises théories, non pas au sens où l'une serait plus vraie ou plus fausse que l’autre, mais précisément en quel sens ? Et le sens qui apparaît, c’est qu’il y a des théories qui sont formulées comme elles le sont, plus fécondes que d’autres. Par exemple, une théorie du mouvement formulée d’après les lois de Newton et une théorie du mouvement qui conduit exactement au même résultat, mais exprimée dans la formulation d’Hamilton ou celle de Lagrange, comportent en elles une force séminale très différente. Dans un cas, celui de Newton, on a une théorie qui rend bien compte des phénomènes et s’en contente, alors que dans le cas d’Hamilton on se réfère à des principes, par exemple des principes de conservation de l’énergie qui produisent les mêmes équations, mais qui, néanmoins, sont beaucoup plus vastes dans leur portée. On ne dira pas que la théorie de Newton est « mauvaise », mais on dira qu’elle fait appel à une structure conceptuelle telle qu’elle est finalement adéquate à son objet. Alors que la théorie d’Hamilton est beaucoup plus générale, beaucoup plus principielle, s’applique à bien d’autres objets : il y a alors non seulement une capacité de généralisation, mais aussi une capacité de production d’autre chose. Du point de vue scientifique, je vois un peu ce qu’on peut faire comme distinction. Alors, est ce que tu pourrais dire si tu as des critères du même genre pour définir ce qu’est un bon et un mauvais poème ?
Henri MESCHONNIC. C’est une question qu’on ne peut pas éluder, bien qu’il y ait des théories qui éludent ce genre de choses. Par exemple, l’appli cation du structuralisme et de la linguistique à la littérature est pour moi l’exemple parfait d’une sorte de technicisme, de méthodologisme, qui fait comme s’il n’y avait que des problèmes de méthode vis-à-vis du langage et des objets de langage. Ce qui fait que, pour moi, l’échec des analyses structurales de la poésie n’est pas dans leur manque de concepts linguistiques, parce que c’est parfait chez Jakobson, mais ce qui leur manque, c’est de se poser même certaines questions, et au moins trois qui manquent alors là chez Jakobson (je repense là à l’analyse des « Chats » de Baudelaire par Jakobson et Lévi Strauss) : la première est celle de l’historicité, au sens où « Mémoire » de Rimbaud, c’est neuf en l872 et ça continue d’être neuf maintenant. La seconde est : « Qu’est-ce que c’est qu’un poème ? » Tout est fait comme si la poésie et le vers, c’était la même chose. Alors, c’est l’analyse du vers, mais pas de la poésie. Et troisièmement il manque la question énorme, qui est complètement effacée : « Qu’est-ce que c’est qu’un beau poème ? Qu’est-ce que c’est qu’un mauvais poème ? »
Alors, tant qu’on élude ces questions, qui pourtant se posent empiriquement, je crois qu’on a des théories qui sont, effectivement, en un sens, adéquates à leur objet, parce que le structuralisme, ça marche merveilleusement. Ça marche, mais dans ses propres limites, et en même temps ça donne l’impression qu’il n’y a pas de limites... Je crois que c’est cela, le critère de ce que j’appellerais peut-être une théorie non seulement adéquate à son objet, mais même trop adéquate à son objet, car c’est une théorie qui ne montre pas ses limites, qui fait comme si elle n’en avait pas. Et le structuralisme, pour ça, est parfait, c’est l’accomplissement le plus dogmatique du signe. Le signe, signifiant-signifié et toute la paradigmatique sont faits pour donner l’impression que c’est la nature du langage. Mais, pour moi, ce n’est pas la nature du langage, c’est un modèle historique.
C’est formidable parce qu’au fond tout est dit avec une formule comme celle-là. Mallarmé, dans une lettre autobiographique qu’il écrit à Verlaine, lui dit : « Vous tenez vraiment votre syntaxe. » Je trouve cela merveilleux, parce que la syntaxe est une notion de la langue. En tant que notion de la langue, c’est une division traditionnelle, une pensée du discontinu. La notion de syntaxe ne permet pas du tout de penser le langage, mais, telle que Mallarmé l’applique à Verlaine, ce n’est plus une notion de la langue, c’est la subjectivation des catégories de la langue : « Vous tenez vraiment votre syntaxe ». C’est une pensée du discours, c’est-à-dire une pensée du sujet. Montaigne dit : « Je veux pouvoir quelque chose du mien. » Tout est là-dedans aussi.
Autrement dit ce sont des pistes, nous n’avons pas autre chose que des pistes. Il n’y a pas de recette pour savoir ce que c’est qu’un bon ou un mauvais poème, un bon haïku ou un mauvais haïku.
Je ne sais pas... Mais il me semble que c’est dans cette direction-là... Autrement dit, voilà un poème qui ressemble vraiment à ce qu’il est seul à pouvoir être. C’est cela qui fait la différence, mais en quoi est-ce que cela consiste ?
L’ŒUVRE DE L’ART
par Claude Birman
Il était convenu que je propose quelques éléments d’approche de l’artiste, pris dans le texte biblique, à travers le personnage de Betsaleel qui est celui qui construit le Tabernacle dans le désert (Exode, 35-36).
On trouve ces éléments de compréhension dans une phrase. Le contexte est le suivant : Moïse est redescendu de sa montagne, le visage rayonnant, et il propose aux Hébreux de construire une demeure pour que Celui qui a transmis la Loi à Moïse puisse être au milieu du camp des Hébreux et non plus simplement là-haut sur la montagne. Sur la montagne, la Voix donne le Décalogue, les Commandements ; Moïse en redescend et dit, entre autres choses : « Celui qui m’a parlé a demandé qu’on lui fasse une place au milieu de nous. Pour cela, il faut que chacun apporte de quoi bâtir cette maison. » Tous les Hébreux apportent donc ce qu’ils ont à donner : « Tous les hommes et toutes les femmes, ce que leur cœur portait à offrir pour tout l’ouvrage que l’Éternel — traduit-on — avait ordonné d’exécuter par la main de Moïse, les enfants d’Israël l’apportèrent en offrande à l’Éternel. » (Verset 29.)
Le mot « Éternel » est ici peut-être mal choisi dans la mesure où, précisément, il s’agit qu’il ne soit pas seulement l’Éternel, mais qu’il soit au milieu, là dans le camp, et pas seulement là-haut sur la montagne.
Est décrite cette synergie, ce rassemblement où chacun apporte quelque chose. Les détails en sont très beaux, c’est une énumération très concrète : il y en a qui apportent « des bracelets, des pendentifs, des anneaux, des colliers, des étoffes d’azur, de pourpre, d’écarlate, de lin, de fin lin, de poils de chèvre, de peaux de bélier ». Bref, ils apportent tout ce qu’ils ont, car il s’agit que cela convienne à cette Voix qui demande à vivre parmi les Hébreux, dont on imagine l’émotion. On apporte donc ce qu’on a et notamment tout ce qu’on avait raflé en Égypte. Cela dit pour situer le contexte.
La généalogie
Le passage qui nous intéresse est la phrase suivante, c’est-à-dire les versets 30, 31, 32 et 33, que l’on va regarder de plus près. Moïse s’adresse alors au peuple et dit : « Voyez : Hachem a appelé par son nom Betsaleel, fils de Hur, fils d’Uri. » Cette première phrase contient plusieurs éléments. Il y a plusieurs personnages : le peuple rassemblé, Moïse, lequel parle au nom d’Hachem cela fait déjà trois et qui désigne Betsaleel au nom d’Hachem, ce Betsleel lui-même étant défini par sa généalogie, ses deux ascendants, Uri et Hur, tous deux de la tribu de Juda, qui apparaît donc aussi présent à l’arrière-plan.
D’abord, qui est Uri » ? On peut rappeler avec Rachi qu’il était fils de Miriam, sœur de Moïse. Betsaleel est donc un proche de Moïse, ils sont apparentés. Que l’artiste soit proche du prophète ne nous étonne pas, ici, mais ils sont apparentés à deux titres : d’abord par Uri, puis par Hur, son grand-père qui, lui, était fils d’Aaron.
Que caractérisent ces deux filiations » ? Beaucoup de choses, mais les commentaires mettent l’accent ici sur un point précis, en apparence un peu détourné, qui est que Miriam doit être considérée comme l’une des sages-femmes qui ont refusé de mettre à mort les petits garçons en Égypte lorsque Pharaon l’avait exigé d’elles.
Du côté matrilinéaire, Betsaleel s’inscrit donc dans une perspective de résistance, résistance à un pouvoir mortifère. Les généalogies dans la Bible nous disent par là qu’untel s’inscrit déjà dans une filiation et vient donc reprendre et accomplir quelque chose déjà préalablement en jeu et qui représente un très ancien combat.
Du côté paternel, c’est encore plus net : son grand-père Hur est ce fils d’Aaron qui s’est fait tuer lorsqu'il s’opposait à la construction du veau d’or, ce qui est très beau et très profondément éclairant.
Des deux côtés la mort est en jeu.
Voici donc ici la première détermination : le grand artiste est présenté comme quelqu’un qui, généalogiquement, a affaire avec une lutte à mort. Rien ne naît de rien : on a une affirmation puissante qui prend sa source dans une opposition radicale. Cette radicalité, on le voit, est double, faite d’une part de la défense de la vie contre l’oppression absolue et, d’autre part, du fait de mettre sa vie même en jeu pour s’opposer à la résurgence de l’idole (car le veau d’or resurgit au désert comme une rémanence de l’esclavage en Égypte).
Et qu’est-ce que ce veau d’or exactement, sinon le faux œuvre ? Manière de dupliquer l’oppression, c’est-à-dire pour les démarches abstraites, le démembrement de l’identité.
Ce pathétique de Hur qui, mourant parce qu’il s’oppose à la construction du veau d’or, est précisément le grand-père de celui qui va construire le Tabernacle, constitue évidemment un enseignement génial. C’est, autrement dit, l’idée que le poète qui accomplit son œuvre est celui dont les aïeux ont été des poètes assassinés. (Et nous avons là dessus un récit d’Élie Wiesel.)
Betsaleel, d’autre part, reprend le combat de sa tante Miriam, cette fois non plus directement contre l’oppression, mais contre le retour, dans l’œuvre, de l’oppression. Il y a ici une symétrie, et l’on pourrait dire que le veau d’or est à la politique de Pharaon ce que le Tabernacle sera à la parole de Moïse. Ainsi, de même que Moïse et Pharaon s’opposent, s’opposent le veau d’or et le Tabernacle.
Il s’agit donc d’une œuvre d’art qui installe au milieu des Hébreux, sous une forme effective — un principe, une intentionnalité, qui ne sera plus seulement un sens, quelque chose d’abstrait, mais au contraire un centre, un mode de vie. Le rôle de l’œuvre est de rayonner : une œuvre d’art est comme un arbre qui crée l’espace qui se déploie autour d’elle. L’arbre à la fois tire substance du sol qui l’entoure ; comme, ici, les Hébreux apportent tous leurs possessions, l’œuvre se nourrit de ce qui l’environne, mais l’arbre rend ensuite par son feuillage, par ses fruits, par son ombre, ce qu’il a aspiré, centre son environnement et crée son propre espace. Bien entendu, le veau d’or proposait la même chose, mais d’une manière fausse, c’est à dire en répliquant l’oppression dont pourtant les Hébreux avaient justement voulu s’affranchir. (On peut dire au passage, d’ailleurs, que les femmes avaient refusé de participer à la construction du veau d’or : elles avaient refusé de donner leurs bijoux, lesquels servaient très précisément à distinguer l’identité, puisqu’aux bijoux de famille est associée l’identité des gens. Les femmes n’ont donc pas voulu marcher dans ce projet qui voulait fondre l’identité — définition du projet fasciste ; les hommes, par contre, ont édifié le veau d’or parce qu’ils s’impatientaient de ce que Moïse restait sur sa montagne, c’est-à-dire que précisément le Tabernacle manquait, n’est-ce pas ? Voilà que Moïse est sur sa montagne et reçoit la Loi, très bien, on nous le dit, mais en attendant, en bas, il faut y croire...) C’est-à-dire que tant qu’on n’a pas Dieu là, présent au milieu de nous, ça reste douteux, et l’on peut être très pressé de mettre fin à ce doute en se créant soi-même son œuvre, œuvre humaine et qui serait alors ce faux poème par excellence pour la destruction duquel on est prêt à mourir si on est l’ancêtre d’un grand artiste (la « Novlangue » d’Orwell).
Voilà pour la généalogie. La leçon ici est, je crois, que cela ne s’improvise pas : l’homme de l’art, celui qui va véritablement concrétiser l’intention de vie, qui va faire que l’intention de vivre soit présente parmi nous et nous anime, celui-là est l’héritier d’une longue résistance aux différentes oppressions mortifères. Il y a donc là une historicité du cheminement de l’art qui ne doit pas être perdue de vue. En quelque sorte, s’exprime là le fait même de ce que vise le cheminement de l’art, la présence sensible de l’intentionnalité originelle.
L’élection
Donc, bien sûr, il y a le pathos derrière. Mais ce qu’il y a dans le présent, ce n’est pas cette espèce de souvenir des durs combats, c’est au contraire une évidence, une évidence immédiate, sans reste, sans bords et sans débordements, et qui est dans ce terme qui commence le verset : « Voyez », sur lequel les commentateurs s’en donnent à cœur joie en disant : « Voyez ». Voyez quoi ? Et la réponse que donne le Talmud est : « Voyez que Betsaleel a l3 ans... » Qu’est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, c’est la Bar-Mitsva, à l3 ans. Il faut interpréter cette Guemara.
Cela veut dire que, d’abord et déjà, « treize » c’est « un ». La valeur numérique de Ehad, le mot qui veut dire un, c’est treize en hébreu. Donc quand on dit treize en hébreu, ça veut dire un, mais « un » non pas, là, formel, mais « plein », c’est à dire qui a tout en lui et qui est accompli.
« Voyez ». Je le comprends comme cela : cette longue lutte à travers les générations a fait en sorte que surgit quelqu’un qui est d’emblée — parce que treize ans ce n’est pas vieux, aussi — tout à fait en position de produire l’œuvre. Et, en effet, ceci nous permet de rendre compte de cette autre dimension de la création qu’est son immédiateté. Je ne crois pas dire de bêtise en rappelant que la première grande comédie qu’ait écrite Calderón le fut lorsqu’il avait treize ans, et elle est aussi bonne que celles qu’il a écrites après. Cela ne veut pas dire qu’il soit un enfant prodige comme Mozart ou d’autres. C’est treize ans et pas moins. Cela signifie que c’est un homme accompli, mais que dès qu’il est accompli en tant qu’homme, immédiatement, il est effectif. Les commentaires disent : « Voyez ». C’est donc aussi qu’il y a quelque chose là à admirer, quelque chose de miraculeux, précisément la présence là, immédiate, dans l’instant, de cette même Loi. Distinguons là, n’est-ce pas : il s’agit de la présence de la Loi dans le camp du peuple ; non plus sur la montagne, mais dans la plaine.
Or, cette présence est d’abord dans la présence de Betsaleel lui-même et ensuite dans son œuvre. On joue ici sur le sujet et l’activité créatrice que l’on dédouble.
Cela, c’est le deuxième élément : ce n’est plus la généalogie, c’est ce que j’ai appelé l’élection. Élection de Betsaleel, l’artiste, comme on dit, favorisé des dieux. En quoi est-il un favori ? Eh bien, précisément, la faveur, c’est la chance, c’est-à-dire le fait que son apparition a été rendue possible par une lente décantation, par une critique — on peut comparer sa généalogie à une espèce de critique, critique de l’oppression qui empêche la vie, critique des fausses œuvres — qui fait que, à un moment donné, la possibilité de l’œuvre nouvelle est dégagée. L’horizon dégagé, à ce moment-là, tout naturellement, comme pour le petit Aymerillot de la Légende des siècles. Voilà que Betsaleel est là, et on peut le désigner, avec Hachem, par son nom.
L’étymologie de Betsaleel que je retiens est celle-ci : Betsaleel est construit sur Etsel, l’ombre. Donc, les commentaires disent : « Ce petit, là, Betsaleel, est comme l’ombre de Dieu sur terre... » à la manière de Soliman le Magnifique (qui se présentait comme l’0mbre de Dieu sur terre). L’artiste, ici, est donc à prendre de droit divin non pas au sens où il est question de le soutenir ou de le consacrer, mais au contraire de reconnaître en lui, dans la manière dont il se comporte, l’évidence sensible qui correspond à l’évidence intellectuelle qu’apporte Moïse, bien que pourtant ce ne soit pas non plus un symbole de la Loi ou une espèce d’allégorie, non, ce n’est pas du tout cela puisque c’est voilé ; il est là lui-même, il est en correspondance avec ce dont Moïse vient parler, il comprend, il est, comme il est dit ensuite, inspiré, et pourtant il ne n’est pas non plus une image, car l’image serait la copie, alors que Etsel c’est l’ombre, mais l’ombre qui précède la chose, la prédétermination.
Etsel renvoie aussi, bien sûr, à Atsilout, dans la Kabbale, ce d’où vient le monde. C’est-à-dire qu’il est lui-même, à l’égard de la vie entre les hommes, comme Dieu lui-même est à l’égard du monde, si l’on veut cette image, ou comme la Loi de Moïse est à l’égard de l’Histoire.
Les aptitudes
Ce qui me paraît essentiel, pour comprendre la richesse de ce thème, et ce sur quoi je vais insister en troisième partie, puisqu’on vient de voir la généalogie puis l’élection et que maintenant vont s’évoquer les aptitudes de Betsaleel, c’est, me semble-t-il, de se délivrer de cette idée qu’ici l’œuvre d’art serait une illustration de la Loi. Ce n’est pas une illustration, c’est tout à fait autre chose, puisque c’est, si vous voulez, une trans-position. Par là même, c’est une transfiguration : à partir de ce qui, pour Moïse, est la Loi, qui vient de la montagne, Betsaleel va faire quelque chose qui est présent parmi les hommes et qui a la même valeur, mais une toute autre efficacité.
Alors, quelles sont les aptitudes de Betsaleel ? Cela va concrétiser ce que nous sommes en train de dire. Donc, troisième et dernière idée, les aptitudes qu’on prend le temps de passer en revue. « Il [Hachem] l’a comblé [Betsaleel] de l ’esprit d’Élohim, qui lui a départi habileté, intelligence et savoir pour toutes sortes d’ouvrages, pour concevoir des projets d’œuvres et les réaliser en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres à enchâsser comme pour œuvrer le bois et pour exécuter toute espèce d’ouvrage » (Exode 35, 3l-33). Il a d’abord ces trois grandes qualités, qui désignent, dans la tradition, la compréhension : Hochmah, Binah, Daath, c’est à dire la sagesse, l’intelligence et la connaissance.
Les commentaires disent, en résumé : « sagesse », c’est du côté d’une intuition, d’une évidence en quelque sorte révélée, qui nous est donnée. « Intelligence » est, au contraire, un discernement patient qui vient en partie de nous, qui n’est pas purement une évidence surgie qui me vient à l’esprit, mais quelque chose que j’ai cherché. Et « connaissance » est la synthèse des deux, c’est à dire quand il y a à la fois intuition et distinction, clarté de l’évidence et mise en état opératoire de cette évidence.
Par conséquent, très curieusement, voilà Betsaleel décrit d’abord pratiquement comme une sorte d’intello, ce qui est agaçant pour un artiste. Les commentateurs disent que ne n’est pas pour en faire un intellectuel au sens où Orson Welles l’entendait, lorsqu’il disait que tous les arts de spectacle et d’expression doivent se méfier comme de la peste de l’intellectualité, qui justement tournerait le dos à l’expression. Elle ne s’exprime pas comme celle de Moïse, cette intelligence. Si Betsaleel « a l’intelligence de Moïse », il l’a — et c’est un très beau commentaire que je vous résume — comme inversée : il est l’envers de Moise.
Voilà comment une anecdote dit la chose. Moïse va le voir et lui dit : « Construis une arche sainte, les objets et la résidence du Tabernacle. » (Il y a trois choses à construire : l’arche, les objets qui font la médiation et la demeure, la tente.) Betsaleel écoute et lui dit : « Tu es sûr qu’Il a dit ça ? Il n’a pas dit plutôt de construire d’abord la demeure, ensuite les objets et après, l’arche ? » Le Midrash dit que c’était là une mise à l’épreuve et que Moïse répondit : « Comment l’as-tu su ? C’est bien là la preuve que tu as compris, puisque j’inversais pour te mettre à l’épreuve et que tu as déjoué le piège ». Moïse s’exprimait de son point de vue. Moïse est le genre de type qui se soucie comme de l’an quarante de la demeure : du moment qu’il a l’arche, il est content. Pour lui, l’arche compte d’abord. Même si la Loi n’est pas recevable, l’important est qu’elle soit la Loi. Il lui suffit d’habiter une vérité totalement désincarnée pour que l’essentiel soit sauvé (c’est d’ailleurs pourquoi il traînait un peu sur la montagne). Tandis que Betsaleel est au contraire celui qui sait, comme le texte le dit ici, que l’idéal ne peut se maintenir dans ce monde sans être solidement protégé. L’arche sainte ne pourrait rester ne fût-ce que provisoirement, sans la protection de la demeure.
Ce que Betsaleel voit tout de suite, c’est la nudité, en quelque sorte, de l’arche, le fait que le sens qui ne serait pas anticipé par une formulation qu’il faut appeler esthétique, au sens étymologique, c’est à dire sensible, de l’ordre de la sensation, serait immédiatement vulnérable et même non seulement inaccessible et en danger, mais dangereux. Par conséquent, il faut d’abord la demeure pour pouvoir y mettre le sens.
C’est cela, l’intelligence de Betsaleel qui, comme tous les grands artistes, est un grand penseur, mais précisément un penseur qui ne commence pas par énoncer des pensées, mais qui commence au contraire par les installer. C’est un installateur. C’est la tekhnê. Mais il n’installe pas quelque chose qui serait déjà construit, déjà pensé si j’ose dire (c’est peut-être là ce qu’il y a de plus essentiel à dire). Son installation — l’image mauvaise. Il faut la garder parce qu’elle est provocatrice, mais il faut s’en méfier — installe le sens et, par là même, il l’instaure.
Pour le dire d’une manière simple : il y a une complémentarité entre Moïse qui vient avec sa Loi, mais qui finalement n’a pas où la mettre, et Betsaleel qui fait en sorte que tout soit tourné vers la réception de ce sens, c’est-à-dire qu’il n’y ait plus rien, dans le camp, de seulement fonctionnel. Son œuvre va être de faire en sorte que le sens circule. Pour que le sens circule, il faut que toutes les possessions des Hébreux soient rapportées à ce sens, servent à construire le Tabernacle.
Il y aurait donc, je crois, deux façons naïves de voir les choses. D’un côté, celle de l’artiste « mettant en images », en quelque sorte, les idées d’un penseur : Moïse qui « utiliserait » Betsaleel comme un ouvrier. De l’autre, celle de l’artiste qui ferait un peu n’importe quoi, comme ça, puis ça fait une œuvre parce que c’est joli : la fantaisie, au sens péjoratif, de l’art.
L’art n’est pas fantaisie. Il n’est pas non plus au service d’une cause préalable. Autrement dit, l’artiste ici fait en sorte que l’idéal soit protégé ; c’est-à-dire qu’il n’est plus un idéal, mais une évidence, quelque chose qui ne nous tire pas en dehors de notre vie quotidienne, mais qui, au contraire, infuse complètement notre quotidien. La poésie passe dans la langue et, en quelque sorte, la ressource, comme les arts plastiques passent dans la décoration ou le théâtre, dans la manière de marcher, de se mouvoir.
Pour finir, voyons le détail de cette conception des œuvres d’art.
Cette quadruple aptitude est d’abord, littérale ment, aptitude à « penser des pensées », ce qu’on peut aussi traduire par « concevoir des œuvres d’art ». Penser véritablement une pensée, ici, c’est lui donner forme, faire que cette pensée soit formulée : c’est ce qui fait toute la différence entre une pensée qui se cherche et une pensée qui se trouve. La pensée qui se cherche est du côté de l’intellection pure, du côté de Moïse. Comment se trouve-t-elle ? En trois temps qui sont l’or, l’argent, le bronze, c’est-à-dire qu’elle se trouve et se retrouve à des niveaux de plus en plus concrets, matérialisés même.
Au niveau de l’or, d’abord, la forme accomplie. Cette pensée qui s’accomplit et prend une forme claire, cette pensée parfaitement formée correspond ici à ce que nous appelons un chef-d’œuvre, pensée qui a pris une forme pure. Pure dans deux sens. D’habitude, lorsqu’on parle de pensée pure, cela désigne une pensée sans image, qui ne se réalise pas, alors qu’ici, au niveau de l’or, la pensée pure serait une pensée qui a développé sa propre forme, sa demeure, qui s’installe en elle-même et dans son propre être, qui se présente elle-même.
Ensuite, au niveau de l’argent (ici intervient un jeu de mots entre kessef et kissouf) correspond celui du désir. D’une certaine manière, là, on perd quelque chose et on gagne autre chose : il s’agit d’investir le désir et les aspirations. Cette pensée réalisée dans l’or rayonne et investit le mode même du désir des Hébreux autour.
Enfin, avec le bronze, elle concerne cette fois l’existence des gens. Ce n’est plus simplement le désir, c’est la manière dont ils s’orientent dans la vie même, la forme de leurs petites cuillères.
Un dernier mot sur le passage suivant où il est dit que Betsaleel peut aussi tailler la pierre et travailler le bois. Il peut tout faire, mais qu’est-ce que cela veut dire d’important ? Il y a ici une séparation : les trois métaux précieux d’une part, pierre et bois d’autre part. Ce n’est donc pas le même travail. La pierre et le bois, c’est la matière par excellence dans l’Antiquité. Mais ce qui relève ici du rapport direct à la matière, et non plus simplement du rapport à la présentation de la pensée, reste dans la continuation de la présentation de la pensée.
Pour le dire de manière nietzschéenne : toute élaboration objective est dans le prolongement d’une intuition poétique. Toute connaissance scientifique a commencé par des poèmes, la physique, par exemple, avec les poèmes de Parménide, ou le rapport entre la musique, la physique et l’acoustique chez Pythagore. C’est donc à partir d’une position de sujet qu’on va pouvoir viser une saisie objective. Qu’il y ait position d’objectivité suppose une subjectivité, et ce sujet lui-même est le résultat d’une activité poétique au sens fort du terme. Donc Betsaleel aussi, au-delà de son œuvre d’artiste proprement dite, va avoir affaire à la pierre et au bois dans le prolongement de son action.
Comment rendre compte également, ici, de l’opposition pierre-bois ? Il y a deux rapports à la matière : du côté de la pierre, mettre la matière en valeur. Il s’agit de tailler la pierre et de la sertir, de faire ressortir ce qui dans la nature peut être pour nous un mode de présentation du monde, nous présenter le monde à nous-mêmes. La pierre précieuse, c’est ce que l’on sort des entrailles de la Terre et qui, venant de la terre, trouve sa place comme faire valoir du monde extérieur à l’intérieur du monde humain.
L’autre geste, ici le rapport au bois, est le geste inverse : le bois n’est pas mis en valeur lui-même, mais il met en valeur. Le bois construira les étais, les supports. C’est l’usage de la matière comme matériau. On est donc là en pleine considération du fonctionnel. Il reste donc, en conclusion, à reprendre ce qui a été dit ce matin : cette espèce de remembrement qui s’accomplit nous amène à réfléchir sur le rapport entre fonctionnement et poésie, pour reprendre les termes d’Henri. Je ne suis pas sûr à proprement parler qu’il existe des objets purement fonctionnels selon cette différenciation fonctionnelle cultuelle, car, après tout, fonctionnel pour fonctionnel, on se passe d’objet ! Il fut dur d’imposer les fourchettes au Moyen Âge : c’était, au début, considéré comme dégoûtant de manger avec une fourchette.
Quand quelque chose est fonctionnel, on pourrait en dire, lorsqu’on le temporalise : voici un objet qui n’est plus que fonctionnel, un objet réduit à sa dimension fonctionnelle. Or cette dimension correspond tout simplement à un épuisement du sens. Bachelard disait aussi : « Les hommes n’ont pas découvert le feu pour faire cuire leurs aliments. » On ne peut pas se représenter des hommes aussi prosaïques d’emblée : ils ont été attirés par le feu parce que ça brille, ça bouge, c’est chaud, c’est magique. Ensuite, ils se sont aperçus que cela pouvait aussi servir. On n’invente pas, on ne crée pas les choses de manière a priori fonctionnelle.
La fonctionnalité est ce qui reste quand le sens est décapé. Alors comment le sens se perd-il ? Eh bien, justement, par une sorte de déclin du culte. À l’origine, il y a une solidarité étroite entre la signification et l’efficacité. C’est pourquoi j’aime beaucoup l’exemple du masque rituel : pour un Africain, un masque rituel doit être beau pour être efficace. On va le réaliser de la manière la plus originale possible dans ce but.
Notre Tabernacle est-il un masque rituel ?
Avec son masque rituel, l’Africain doit avoir quelque chose qui fasse vraiment venir l’ancêtre en lui, une demeure qui l’y invite. Il faut que la moue de l’ancêtre apparaisse de manière très expressive sur le masque. Est-ce fonctionnel ? Bien sûr ! En tant qu’objet cultuel, bien entendu, mais, en même temps, c’est beaucoup plus — justement — parce que les deux ne sont pas dissociés : c’est une présence effective du sens, le passage du sens dans le quotidien.
Revenons aux Hébreux qui faisaient leurs dons. Nous avons vu que ce qu’ils donnaient, c’était ce qu’ils avaient pris en Égypte. On a par conséquent cette image : il n’y a pas d’objets fonctionnels, il y a simplement des objets qui ont perdu toute signification parce qu’ils sont les résidus, les restes d’une oppression, ce qui demeure d’une fausse présence, c’est-à-dire en réalité d’une absence. Ce sont ces objets-là eux-mêmes, tout ce prestige d’une « Égypte » qui s’est en fait révélée un monde idolâtre, ce sont ces faux semblants qu’on reprend pour composer à partir d’eux d’autres objets, eux, libérateurs.
Il y a par conséquent deux sortes de rapports à l’objet : l’un où l’objet m’est soumis, en quelque sorte. Je m’en sers. C’est ce qu’on appelle un objet fonctionnel. Il me sert. Or c’était déjà la première vengeance des Hébreux que de se servir des objets des Égyptiens.
Il y a une deuxième fonction de l’objet. Je ne crois pas que l’art puisse cesser d’être religieux, ni que la religion puisse cesser d’être artistique. C’est pourquoi je ne distingue pas objet cultuel et objet artistique. Je suis, de ce point de vue, d’accord avec Bettelheim, à savoir que l’art moderne est le point de départ d’une nouvelle ouverture de l’esprit. Ce même objet dont je me sers peut aussi m'ouvrir l’esprit. Ne privilégiant plus seulement la fonctionnalité pure de l’objet, je le dispose de telle sorte qu'il m'aide à m'interroger sur ce d'où je développe, moi, telle ou telle fonctionnalité.
L’objet, quand il cesse d’être fonctionnel, devient interrogatif, un objet-question.
Par là même il me sort de l’anonymat, de la servitude, parce qu’il me révèle à moi-même tel que je suis, moi en tant que sujet. Et ici, précisément en tant que peuple hébreu, la question est, en l'occurrence : qu'est-ce que ne plus être un esclave, et ce grâce à l’œuvre d’art ? Eh bien, c’est découvrir en quoi on ne fait pas double emploi.

DÉBAT
« le chiffre et la lettre »
Serge GAVRONSKY. Dans cette énumération, menant de l’or à la pierre et au bois, où se trouve la terre ? Pourquoi son absence, parlant de la fonctionnalité ? Par exemple, la céramique semble également ancienne…
Claude BIRMAN. La question est judicieuse. Auparavant, avant même de parvenir au Sinaï, la première chose que firent les Hébreux, c’est un autel de terre. Précisément, la terre ici serait donc préalable à l’œuvre : nous sommes faits de terre. Un autel de terre signifie la communauté qui s’engageait dans le désert, tandis qu’il s’agit maintenant de faire une demeure pour la transcendance. La terre ainsi serait du côté de l’immanence. Et une fois que c’est prêt, ça marche : il y a un beau nuage qui descend et « Dieu s’installe » ; après cela, on ne pourra plus approcher.
Régine BLAIG. Ne peut-on pas évoquer la fragilité de la terre par rapport à ces matériaux qui, eux sont faits pour durer ?
Claude BIRMAN. Oui, c’est cela.
Manuel ZACKLAD. Il semble que le mot « fonctionnel » a pris un sens péjoratif, alors que découvrir de nouvelles fonctionnalités à un objet est le sens même de la créativité.
Claude BIRMAN. Oui, dans la mesure où lors qu’on découvre une nouvelle fonctionnalité à un objet, c’est que, précisément, on ne le prend pas pour un objet fonctionnel. Sinon, comment se poser des questions à son sujet ?
Tu évoques le fait que la pierre et le bois sont dans la suite des métaux, c’est-à-dire que l’activité inventive, l’invention d’une nouvelle fonctionnalité est dans le prolongement de l’invention artistique. C’est la même créativité, mais sur un plan qui n’est plus la représentation subjective, mais la prise en compte des potentialités de l’objet. Tu tailles la pierre, c’est-à-dire que tu dégages la fonctionnalité propre à l’objet, qui pourtant n’est pas expressive de ta propre subjectivité. La beauté de l’objet, je crois, symbolise ici ses potentialités propres, et c’est cela la nouvelle fonctionnalité : elle est objective. Ce n’est pas la subjectivité qu’on y trouve, mais ce déploiement de l’inventivité subjective qui permet la mise à jour des potentialités de la chose. On passe effectivement du côté de l’objectivité.
Tu dis : « Découvrir de nouvelles fonctionnalités, c’est toujours découvrir ». Mais ce n’est plus seulement se découvrir, mais découvrir les objets en tant qu’on se découvre soi-même. C’est cela pour moi le rapport entre l’art et la science.
Manuel ZACKLAD. Alors en ce cas, si on parle de la fonctionnalité de l’œuvre d’art, de la fonctionnalité artistique…
Claude BIRMAN. Au sens où j’entends fonctionnalité, cela n’aurait plus de sens. Ce qui est fonctionnel signifie créatif, moins la subjectivité.
Henri MESCHONNIC. Ce serait l’utilitaire !
Claude BIRMAN. Pas forcément l’utilitaire. Cela peut être gratuit, « scientifique ». C’est-à-dire l'objet pour lui-même… Je rappelle un exemple très simple de ce rapport art-science. Darwin consacrait beaucoup de temps à composer ses herbiers et, au bout d’un moment, il trouvait ça desséchant. Il raconte que, lorsqu’il n’en pouvait plus de faire ses herbiers, il arrêtait tout, changeait de pièce et relisait à haute voix une tragédie de Shakespeare. Il retournait après à ses herbiers, regonflé. Ce n’est donc pas la même activité, bien sûr, mais l’une dépend de l’autre. Si l’on n’a pas l’esprit ouvert par l’art, on ne peut pas devenir un savant. On ne peut pas découvrir de nouvelles fonctionnalités de l’objet si l’on n’a pas, justement, le sens de l’ouverture.
Francis BAILLY. Je voudrais faire deux remarques. La première est justement relative à la science. Il existe en effet, à l'intérieur même de la science, un débat sur ces questions : est-ce que les théories scientifiques, le calcul, sont orientés vers la pure efficacité, l’opérativité, ou est-ce que cela peut servir à « autre chose », c’est-à-dire contribuer à développer des formes d’explication, de compréhension beaucoup plus générales, et donc d’essayer de contribuer, tout en ne comportant pas de sens intrinsèque, à former un sens ? Il me semble que c’est ce que voulaient dire aussi Prigogine et Stengers dans La Nouvelle Alliance, à savoir qu’il peut ne pas y avoir une simple fonctionnalité du développement scientifique. C’est ce que recherche également quelqu’un comme Thom quand il essaie de réaliser ce qu’il appelle « une esquisse d’une sémio-physique », dans laquelle il tente précisément un rapport à des constructions de signification, ce qui ne va pas de soi.
Je voudrais rappeler à ce sujet une anecdote qui correspond à quelque chose de profond. Lorsqu’on demandait à Jacobi : « Mais à quoi peut bien servir ce que vous faites ? », il répondait : « À l’honneur de l’esprit humain. »
Claude BIRMAN. Je préfère cela à ce que tu as dit avant…
Francis BAILLY. Oui, car précisément il ne s’agit pas, à proprement parler, de chercher « un » sens. Claude BIRMAN. Tailler des pierres. Tailler des pierres, c’est à part. Ce n’est pas de l’ordre du déploiement du sens, mais de cette liberté de reconnaître les potentialités de la chose hors de nous que le déploiement du sens permet. Mais de là à retrouver le déploiement du sens dans un monde extérieur ! Cela, c’est extrêmement dangereux, parce que cela risque justement de bloquer le rapport à l’objet et de nous enfermer dans un univers symbolique.
Francis BAILLY. Absolument.
Le second point que je voulais soulever en liaison avec cela a été développé par les gens de l’école de Francfort en particulier, qui ont dénoncé précisément l’instrumentalisation de la raison elle-même, lorsqu’elle a été utilisée de façon fonctionnelle plutôt que de façon, pourrait-on dire, créatrice. Cela me paraît très important, parce que c’est une dimension politique majeure…
Claude BIRMAN. En effet, cela me paraît très clair : c’est Pharaon…
Francis BAILLY. Voilà. Il ne suffit donc pas de faire référence à la raison. Encore faut-il qu’il n’y ait pas eu instrumentalisation et qu’elle soit engagée dans un mouvement qui l’authentifie dans son usage, exactement comme le sens lui-même demande à ne pas être réifié, parce que dans sa réification, le sens lui-même devient idolâtre.
Claude BIRMAN. Oui, cela devient « la » raison, et si ce n’est plus ni la raison des choses, ni la nôtre, alors, à ce moment-là, c’est celle de qui ? Eh bien, forcément, celle de la mort…
Le meilleur, là-dessus, c’est Chestov, qu’on peut prendre pour un irrationaliste, si on lit de loin, mais en réalité voilà ce qu’il dit : la croyance en la nécessité de la raison, c’est le militantisme — « raison » — en tant que développement somnambulique et fatal (cette fatalité somnambulique qui ne peut être finalement qu’une raison d’État, par exemple). Et c’est, en réalité, une manière d’évacuer deux choses : — Adomo le dit aussi — d’une part, que les choses nous apparaissent dans leur être avant tout discours (par exemple, ici, les pierres qu’on peut tailler) et qu’il faut d’abord être silencieux devant l’objet. Si on se met à raisonner, on perd la singularité des choses. D’autre part, on y perd aussi l’autre singularité, notre propre singularité, celle de notre affirmation, le fait que je m’affirme en tant qu’homme dans un monde qui lui-même se présente à moi en tant que monde. Il y a donc deux versants, et par conséquent deux usages de la raison : l’un qui doit être au service de mon affirmation, de ma liberté, de mon identité, et un autre qui doit être au service de la description, de la théorisation et donc des potentialités de l’objet.
Francis BAILLY. Cela s’appelle « la dialectique delà raison… »
Claude BIRMAN. Oui, si l’on entend cela de manière non péjorative. Mais si, au lieu de cela, j’isole une raison qui n’est ni celle de l’objet, ni celle du sujet...
Henri MESCHONNIC. On entend souvent dire, par exemple, que la poésie est partout. Il y en aurait dans la peinture, dans la science, dans la chanson, dans la nature. La poésie est partout et, quand la poésie est partout, eh bien elle n’est nulle part, parce qu’effectivement elle est alors bloquée dans le symbolique. Elle est bloquée parce qu’elle n’est plus transformatrice du rapport au langage, qui est lui-même un rapport au monde. Donc, en ce sens, je n’aurais, moi, qu’une définition — quitte à paraître affreusement réactionnaire — et purement restreinte (puisqu’il y a définition « restreinte » ou définition « généralisée »). Je pense que dire que la poésie est partout, c’est la tuer. C’est la confondre avec le sentiment poétique. C’est très beau, le sentiment poétique, bien sûr cela existe, c’est indéniable, mais ce n’est pas la même chose que la poésie. Je dirais que la poésie est uniquement langage. La peinture, c’est la peinture. La musique, c’est la musique. La poésie, c’est la poésie. De toute façon, il n’y a que la tautologie qui soit vraie !
Claude BIRMAN. Oui, mais, enfin, il ne s’agit plus, là, de la même idée. L'œuvre d’art n’est pas une chose de la nature...
Henri MESCHONNIC. Non, l’œuvre d’art n’est pas une chose. C’est une œuvre.
Claude BIRMAN. C’est une œuvre vivante. [...] Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. On disait tout à l'heure qu’il ne fallait pas prendre mie œuvre d’art pour un symbole. C’est une question grave. Comment peut-on opposer clairement le symbole, au sens péjoratif où on l’entend ici, à l’œuvre, la « vraie » ? Mon idée était que le symbole se clôt sur lui-même et forme un monde en cela que l’on s’installe dans un univers symbolique par une double dénégation, de l’objet et du sujet. C’est pourquoi je parlais tout à l’heure d’un monde « magique et anonyme ». Cela peut être très jouissif, parce que c’est justement un monde de la jouissance. Jean Zacklad en disait : « Le seul moyen d’en avoir une idée aujourd’hui, c’est la Californie. » (Il n’avait jamais mis les pieds en Californie. Il parlait là de l’image qu’on se fait de la Californie, image d’un monde dans lequel il n’y a pas d’idéal, parce qu’on est dans la jouissance, mais où il n’y a pas de réel non plus pour la même raison.)
Voilà peut-être une vision de l’art qui nous ferait manquer justement la véritable réussite de l’art. Car celle que nous décrivons ici est une médiation ouverte « des deux côtés » : d’un côté Betsaleel répond de l’intention de Moïse (il est là, lui ; Moïse arrive avec sa loi, parle aux Hébreux, mais Betsaleel va en faire quelque chose). Il est ouvert sur l’idéal, dont pourtant il n’est pas une simple illustration, mais une reprise. En même temps, il est ouvert sur le monde réel. L’œuvre d’art réussie est véritablement, dans les deux sens, des deux côtés, une mise au monde.
Au fond, paradoxalement pour le sens commun, c’est par la poésie qu’on a un rapport au réel. L’artiste est celui qui nous met en contact avec la réalité qu’on ne voit plus, justement parce qu’on est pris dans un univers « symbolique ». Il est celui qui « casse les images .» C’est pareil du côté des significations : il rend possible l’éveil, l’ouverture d’esprit, l’éveil aux significations et le rapport au réel en même temps, le rapport à l’objet et le rapport à l’identité du sujet. C’est dans ce sens que l’œuvre d’art est véritablement une mise en œuvre de l’éthique.
Ce rapport que décrit Henri dans la poésie entre l’éthique et le politique, on le voit ici : le Tabernacle est véritablement le point de départ de la marche vers la terre promise. Et c’est contenu dans l’autre étymologie du nom de Betsaleel, qui renvoie à Bethsah, l’œuf, qui fait de lui l’artiste par excellence, le germinatif : il ouvre une possibilité dans l’horizon de laquelle quelque chose va pouvoir se développer.
Philippe GUMPLOWICZ. Et c’est lui-même aussi Betsaleel, c’est « la maison de lui-même ». Claude BIRMAN. Pour illustrer ce que serait un monde clos symbolique, j’ai trouvé un petit passage rigolo dans Rosenzweig, qui se lance un peu à la manière de Saint Augustin dans une critique d’un art qui serait jouissif, mais qui nous fermerait à la vérité et à la réalité : l’art comme drogue. C’est cela, l’univers symbolique au sens péjoratif. Voilà ce qu’il dit, parlant de la musique : « La musique fait tout oublier. Elle fait oublier à l’auditeur l’année dans laquelle il vit, son âge. Alors que son corps est éveillé, elle le transporte, lui, parmi les gens qui rêvent, ceux dont on dit que chacun possède son monde propre. C’est l’univers onirique. Et réveillé en sursaut, il se peut qu’il s’écrie : « Jamais fait de meilleur rêve ! », et à la première occasion il se saisit de nouveau de la bouteille et s’enivre sur les rives de son Léthé. C’est ainsi qu’il vit une vie ailleurs, non pas même une vie ailleurs, il vit mille vies, et aucune n’est la sienne propre. En vérité, le chien qui entre dans une tristesse infernale quand sa maîtresse a joué du piano, ce chien a une vie plus authentique, et même si je puis dire, plus humaine, que cet amateur de musique. »
Philippe GUMPLOWICZ. Je vais parler — c’est un peu bête de commencer comme ça, surtout après cela — en tant que musicien.
Chaque fois qu’on revient sur ce passage, puisqu’il s’agit là de la Parascha de la semaine dernière, on a l’impression, surtout lorsqu’on parle comme ça à des clercs juifs, que c’est a priori prescriptif, c’est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de Betsaleel, on dirait : voilà comment l’artiste juif doit être, voilà l’archétype de l’artiste doté de l’inspiration du Rouah d’Élohim, inspiré par le souffle de Dieu à la fois comme un artiste et comme un prophète. En même temps, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’il est « au service de ». C’est très clair : quand les gens lui apportent leurs ustensiles piqués en Égypte pour construire le Tabernacle, il rassemble tout cela, il va donner la meilleure forme à ce Tabernacle qui sera la présence de Dieu parmi les Hébreux, soit ; mais je ne peux pas m’empêcher de penser à l’artiste du réalisme socialiste, qui est lui aussi le réceptacle de l’âme soviétique, des bonnes dispositions authentiques et réelles de tout le peuple, ce qui lui donne une force, une forme, etc. C’est peut-être étonnant dans ma bouche, mais je me dis que si c’est pour nous dire que l’artiste doit être une espèce de saint-sulpicien, cela n’en vaut pas la chandelle…
Ce n’est pas ce que j’entends là-dedans. Sur l’art, cela nous dit peut-être des choses, le rapport à la matière est intéressant. Mais sur l’artiste ? Dans une stricte optique rabbinique où chaque mot compte, le fait qu’on insiste tellement sur les matériaux est intéressant. Il y a trois Parascha où on nous décrit comment doivent être faites les choses, comment les objets cultuels doivent être faits, et ces trois Parascha s’inscrivent entre les moments où la Torah est donnée : elle a été donnée il y a trois « semaines », et puis après cela repart sur le don de la loi, sur des choses apparemment plus élevées, plus nobles ou plus éthiques. Cela doit donc avoir une importance, mais alors laquelle, je ne vois pas.
Éliane CHEMLA. Je reprends les trois déterminations dont tu as parlé, Claude : la création comme immédiateté, je vois. La transfiguration du sens par l’œuvre même, transfiguration du sens de ce qu’elle représente, je vois quel sens donner à ces deux déterminations en matière de création artistique au sens commun, je veux dire hors de la Bible. Mais la généalogie, je ne vois pas.
Claude BIRMAN. Cela fait quatre questions. La première chose, en ce qui concerne notre « laboratoire » présent ici, est que c’est un hasard total, « divin », si nous nous retrouvons aujourd’hui à traiter de cela...
Tu prenais, Philippe, l’exemple du réalisme soviétique qui me paraît très bon pour désigner exactement ce qui ressemble à ce dont on parle comme son frère, ce qui ressemble le plus au vrai, c’est-à-dire le faux. Le faux est vraisemblable, semblable au vrai... C’est pour cela que je citais Rosenzweig, au sens où la différence — et là est l’obstacle — est que, dans le réalisme socialiste, l’idéologie est donnée d’abord et l’on demande aux artistes d’illustrer cette idéologie, alors que je vois dans l’esprit de ce texte exactement le contraire. Betsaleel est présenté non comme un exécuteur des hautes œuvres qui dessinerait ce qui est déjà fixé par ailleurs, mais — et c’est pour cela qu’on insiste sur son intelligence — comme celui qui reprend l’initiative de Moïse « par l’autre bout ». Moïse vise à une réalisation de la vérité et Betsaleel, en quelque sorte, lui fait la leçon et dit qu’il ne peut être question que le peuple reprenne le sens qui a été retrouvé sur la montagne s’il n’est pas centré. C’est seulement à partir du moment où le peuple est centré qu’il sera en mesure ensuite d’accueillir le sens. S’il y eut un « art soviétique », ce fut par exemple celui de Kandinsky, cet ensoleillement qui invite à sortir des isbas pour accueillir les possibilités neuves délivrées par la fin du tsarisme. Il y a donc un parallélisme : de même que les Hébreux ont été obligés d’attendre que Moïse soit redescendu de la montagne, de même Moïse devra attendre que Betsaleel ait construit la demeure pour pouvoir ensuite être en présence d’Hachem parmi le peuple. Il y a deux temps. Dans le réalisme socialiste, il n’y a ni l’un ni l’autre. Il n’y a pas de distance entre le projet et la communauté ; le slogan doit être immédiatement illustré. Il n’y a pas cette irréductibilité de l’expression artistique et de l’expression religieuse, philosophique ou intellectuelle. Et le fait qu’il n’y ait pas cette distance, c’est la mort parce qu’à ce moment-là, les deux étant bloqués ensemble, il n'y a plus de rapport au réel et plus de rapport à l’idée. C’est pour cela que Rosenzweig disait : « Oui, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir à écouter de la musique, mais si cette musique vous fait oublier où vous êtes et quand vous êtes, d’une certaine manière vous êtes trahis, parce que la véritable musique est celle qui vous apprend où vous êtes et quand vous êtes. Non pas celle qui vous fait oublier l’année où l’on est, mais celle qui vous ouvre à l’année, au Temps, à l’Espace et au sens. » C’est peut-être ainsi que l’on peut, peut-être, avoir un critère évidemment très extérieur du « beau » poème : celui qui nous ouvre à la vie, tandis qu’une expression artistique fallacieuse nous couperait des choses et du sens. Le sens général de la question posée sur cette Parascha, où l’on insiste sur les éléments du Michkhan et sur le fait qu’avant et après il est question de la Loi est, me semble-t-il, celui que j’ai indiqué. Il y a cette alternance qui n’est pas une alternative, au contraire, puisqu’il n’y a pas l’un sans l’autre : s’il y a une loi qui est reçue du Sinaï, cela ne peut être effectif que dans la mesure où c’est repris d’une manière qui soit intériorisée par la communauté. Ce n’est pas une loi qu’on imposerait de l’extérieur au moyen de grands symboles, de grandes représentations, mais qui vient correspondre à ce que d’elle-même la communauté a élaboré. C’est une rencontre. Il est donc alors normal qu’on alterne des passages législatifs très abstraits, très généraux, prescriptifs, et des considérations extrêmement cénesthésiques qui prennent en compte tel aspect du réel, tel autre aspect, tel aspect du vêtement, du bijou, disant par là véritablement que, de la même manière que l’on a tissé quelque chose avec les significations, il y a aussi quelque chose à tisser avec ce que la vie sociale peut avoir de sémiotique, que cela vienne se rassembler et correspondre. Correspondre sans se confondre. C’est un passage. Moïse ensuite ira à cette demeure et s’en éloignera ; cette demeure est l’autre pôle. Moïse lui-même est pauvre sans cet autre pôle ; car s’il n’y a pas cet autre pôle, il y aura alors l’idole.
Gérard CALLIET. Ce qui me travaillait sur ce sujet, c’était que je ne voyais pas le rapport entre ce qui est exposé comme une positivité et ce que je ressens comme une préoccupation constante : se battre contre cet ennemi, l’idolâtrie sous toutes sortes de formes. On pourrait donc parler du « bon art » comme quelque chose qui s’élève assez souvent contre l’art. On trouve beaucoup de très bons artistes qui sont des gens qui n’aiment pas l’art. Il y a par exemple une détestation des écrivains chez Artaud, qui est la marque de la manière dont il se débat avec de mauvaises productions.
Claude BIRMAN. Artaud, c’est un peu Hur... À ma connaissance, il n’a pas pu finalement produire une œuvre ; il est mort dans la contestation de ce qui se présentait comme art et qu’il repoussait. Il est une bonne figure de celui qui fait de sa vie une opposition au veau d’or.
J’ai cité Victor Hugo, mais Henri, ce matin, citait Gombrowicz. Il y a toujours un fond de colère…
Henri MESCHONNIC. Je pense que l’art, ce n’est pas l’amour de l’art. Rien n’est plus opposé à l’art que l’amour de l’art. L’amour de la poésie donne des choses atroces, puisque ça donne l’idée qu’on sait ce qu’est la poésie et qu’il n’y a donc plus qu’à la reproduire. C’est bien en ce sens qu’à la fois l’histoire de l’art n’est pas l’art et l’amour de l’art non plus. L’art a à lutter contre l’histoire de l’art et l’amour de l’art, d’où « La haine des poètes », cette série de petits articles de Gombrowicz.
Claude BIRMAN. Et c’est parce qu’il y a eu le fait qu’on a résisté, qu’on ne s’est pas compromis et qu’on a survécu à cela, qu’il peut apparaître. C’est le « Voyez » dans une œuvre, une espèce d’évidence sereine qui n’a plus du tout l’air d’un combat. C’est parce que la guerre a été gagnée qu’il peut y avoir la paix. Mais la paix n’a rien à voir avec la guerre. C’est la demeure. Comme Salomon par rapport à David : c’est Salomon qui bâtit le Temple parce qu’il n’est pas un guerrier, lui. Mais il y a eu David avant.
Gérard CALLIET. Dans le fait qu’on veut éviter à tout instant que cela ne soit dévoyé et débouche sur de l’idolâtrie, c’est-à-dire que le combat soit perdu et que le résultat soit exactement l’inverse de ce qu’on voulait faire, n’aurait-on pas mis des règles qui, en quelque sorte, ont stérilisé l’art juif et qui l’auraient canalisé dans une certaine direction ? Il y a en particulier des secteurs où pendant très longtemps on n’a pas vu de Juifs s’exprimer.
Claude BIRMAN. C’est intéressant et c’est dans le texte : cela c’est la distance. Ce serait la méfiance de Moïse à l’égard de Betsaleel, le fait qu’il n’est pas porté de lui-même à se reconnaître dans son autre ; d’où le fait que ça passe par Hachem. Ils sont quatre, en fait : Hachem, Moïse, Betsaleel, le peuple. Il est incontestable qu’il y a une méfiance.
Gérard CALLIET. Que la tradition condamne l’idolâtrie peut s’entendre comme très polémique par rapport à tout art possible, ne peut-on pas dire, alors, en grossissant le trait, qu’est-ce que l’art, si ce n’est finalement ce que les Hébreux taxent d’idolâtrie ? Un masque africain, pour un Hébreu qui sort d’Égypte, peut être tout simplement le symbole de l’idolâtrie, de ce à quoi on peut échapper. Avec notre distance d’Occidentaux, on peut trouver beau un masque africain qui transmet dans une tribu le pouvoir des ancêtres, pouvoir au sens aussi mortifère, et donc perpétuation de ce dont on ne sort pas. Les Hébreux, à ce moment-là, n’auraient peut-être pas collectionné les masques africains. Ils les auraient peut-être réduits en poussière pour en faire autre chose.
Claude BIRMAN. On est ici en présence de la troisième étape. Freud, par exemple, s’extasie sur l’interdit de la représentation chez les Hébreux en disant : « Ah, c’est merveilleux, comment ont-ils trouvé cela ? Ils ont changé l’histoire du monde. » Il prend au sens littéral, dans les dix commandements, l’interdit de la représentation et dit : « C’est le commencement de l’intelligence. » Tant qu’on est prisonnier d’une image, on est effectivement prisonnier d’un monde magique. Il faut donc d’abord se délivrer des images. Mais, dans notre texte, il s’agit de signifier le sensible, c’est-à-dire de signifier dans la représentation, dans l’image, dans l’immédiateté, non pas un message qui serait déjà prêt, mais une exigence d’ouverture et que cette même exigence se re-trouve. Les Commentaires disent que cette insistance sur le sensible, c’est pour faire éclater le sensible. De telle sorte que tout signe sensible devient finalement significatif d’ouverture. C’est tout le contraire de l’idole qui enferme dans une certaine mentalité.
Régine BLAIG. Mais rien ne dit dans le texte que cela doive aller vers le sensible, vers l’intelligence du sensible. Qu’est-ce qui le dit ? Il s’agit de construire la demeure, mais il n’y a pas vraiment de liberté de construction ; il y a obligation d’utiliser l’or, l’argent, le bronze. Il faut qu’il utilise tout son savoir. Tout doit être mêlé : la broderie, la gravure, le tissage, les métaux, le bois. Et la pierre n’est pas utilisée comme matériau de construction, mais en tant que pierre précieuse... Cela ne fait pas appel au sensible.
Claude BIRMAN. Le sensible, pour moi, est juste ment le fait que les choses se voient, se touchent.
Régine BLAIG. Mais il s’agit d’une liberté d’œuvrer tout à fait restreinte, puisqu’on a déjà la position de tous les matériaux.
Claude BIRMAN. Pourquoi restreinte ? C’est au contraire une expansion de pouvoir utiliser tous les matériaux. Il ne se bornera pas à utiliser l’or : aucun matériau ne lui résiste. Voilà l’idée, ici. Tout va devenir signifiant. Tous les matériaux devenant porteurs de sens, le corps deviendra transparent à lui-même. Il n’y a pas, d’un côté, un idéal de liberté et, de l’autre, l’évidence d’un enfermement. Celui qui donne la liberté va demeurer parmi eux. Évidemment c’est assez difficile à se représenter puisque, précisément, c’est abstrait. Ils vont se sentir accompagnés par un Dieu vivant. C’est un renversement total de l’enfermement égyptien où la loi était proche des gens, mais en tant que loi d’oppression. Ici elle est très loin, cette loi de liberté. Et le renversement est que la liberté doit revenir aussi proche des gens que l’était l’oppression. Proche, c’est à dire sensible, justement, dans ce qu’on peut toucher, voir, entendre, goûter. C’est palpable. L’artiste est celui qui rend palpable la liberté.
[...] Ce sur quoi j’ai désiré mettre l’accent, et qui me paraît le plus moderne, c’est sur la liberté totale de l’art par rapport à toute l’idéologie préalable. C’est justement par là qu’on va accéder à l’idée. Ce n’est pas l’idée qui peut nous donner l’Œuvre. Cela est très important, à mon avis, pour comprendre l’art moderne, la conception moderne de l’art. Bettelheim dit que l’art d’aujourd’hui est amené à jouer dans les villes le rôle que la religion autre fois jouait dans les campagnes, c’est à dire éduquer les enfants l si l’on veut que les enfants s’adaptent à la civilisation moderne, cela ne peut passer que par l’art.
Il faut se débarrasser de l’idée que l’art est au service d’une religion. Les cathédrales n’étaient pas au service des prêtres. C’est exactement le contraire de la propagande : les cathédrales au Moyen Âge révélaient un mode de vie qui était comme la réponse à une certaine mentalité abstraite. L’art modèle nous révèle ce que peut être la vie moderne. On n’en a pas la signification avant. On en a une espèce de pressentiment, mais ce sont les artistes qui nous le révèlent. Ils nous le font, justement, sentir, et pas seulement souhaiter ou intuitionner. Et dans ce sens-là, comprendre. Il n’y a pas de « religion », au sens strict, préalable à l’art qui la représente. C’est l’art qui fait la religion et non l’inverse. Chagall est en ce sens un artiste « religieux ». Il n’est pas au service d’une foi toute faite. Pourtant, il crée une religion : se « sentir ensemble relié à et par quelque chose ». Être à demeure.
Royaumont, le l4 mai l993
Texte établi pour la publication par Philippe Jaworski.
NOTES
avec la participation de Francis Bailly, physicien, chercheur au CNRS.
Danielle Bailly, professeur.
Claude Birman, agrégé de philosophie.
Chantal Birman, sage-femme.
Régine Blaig, sculpteur.
Gérard Calliet, informaticien.
Eliane Chemla, auditeur au Conseil d’État.
Gérard Cohen-Solal, physicien, chercheur au CNRS.
Dominique Crèvecœur, producteur de films.
Anne Marie Gavronsky.
- Serge Gavronsky, écrivain, directeur
- du département de français, Columbia University, N.Y.
Philippe Gumplowicz, écrivain, musicologue.
Raquel Levy, peintre.
- Henri Meschonnic, poète, traducteur,
- professeur de linguistique université Paris VIII.
- Jean-Yves Rondier, producteur de films scientifiques.
Anne Vernet, comédienne.
- Manuel Zacklad, chercheur, enseignant,
- Intelligence artificielle-université de Compiègne.
- © revue NOTES l994 Tous droits réservés
NOTES
Publiées par Raquel Levy
avec le concours de la Fondation Royaumont
70, avenue Foch 75ll6 Paris - Tel. 45 OI 75 44
Création, Mise en page Sylvain Gabbay
______________________________Publiées par Raquel Levy________________________
Avril 1993 N° 4
Le 11 octobre 1992 s’est tenue à l’Abbaye de Royaumont une première rencontre
(science, philosophie, peinture, écriture, musique) organisée par Notes
sur le thème « le chiffre et la lettre ».
Ont participé à cette rencontre : Francis Bailly, Danielle Bailly, Claude Birman,
Gérard-Cohen Solal, Philippe Gumplowicz, Philippe Jaworski, Youval Micenmacher,
Anne Portugal, Raquel Levy, Jean-Michel Salanskis.
INTRODUCTION
Comment se parler, compte tenu de la complexité du langage dans chaque spécialité ? Comment communiquer avec quelqu’un qui n’a pas les mêmes codes ? Est-ce possible ou non ?
Par-delà l’apparente diversité de tous ces savoirs, est-ce qu’au fond il y a une unité ? Poser des questions, questionner les questions, est-ce pour cela que nous sommes ici ? Il s’agit d’ouvrir des portes, d’inventer des passages.
Comment ouvre-t-on des portes ? Faut-il fabriquer des passages ? Comment ? Ouvrir des portes, c’est poser des questions, non ? Quelles sont les questions que nous devons nous poser, et en quels termes, de manière à communiquer ?
Chacun de nous, dans sa spécialité, ouvre des portes d’abord dans son travail personnel. Ensuite dans son secteur, avec des spécialistes de ce secteur. Est-ce qu’il est possible que des gens qui travaillent dans des secteurs différents (de recherche, de création), qui souvent même s’ignorent, puissent se rencontrer à un niveau qui ne soit pas simplement celui de la vulgarisation ?
Par exemple, j’ai fait — et je fais — des livres avec des écrivains. Qu`est-ce que je fais quand je fais un livre avec un écrivain ? Je ne fais pas communiquer la Peinture avec la Littérature ou la Poésie. La peinture c’est la peinture. Et la poésie, c’est la poésie. Même si peintres et écrivains travaillent ensemble depuis longtemps, il s’agit de disciplines totalement distinctes. Chacune a ses techniques, ses outils, ses objectifs. Rien, apparemment, ne les destine à se rencontrer.
Qu`est-ce qui se passe quand je décide de travailler, comme peintre, sur un texte ou un ensemble de poèmes d’Anne-Marie Albiach, par exemple ? Ce texte ou cette suite me parle, me dit quelque chose. Ce quelque chose, comment puis-je le traduire dans mon travail de peintre ?
Anne-Marie Albiach me confie un texte intitulé « CÉSURE : le corps », pour que j’en fasse un livre. Un livre, c’est un volume ; il y a des pages ; il y a un format à définir ; des décisions typographiques à prendre, etc. Tandis qu’un tableau, c’est une surface plane, qui a, dès le départ, son format, ses limites, etc.
Alors, comment vais-je traiter en peinture quelque chose qui doit se présenter comme un volume ? Ce texte-là d’Anne-Marie Albiach, quel genre de volume appelle-t-il ?
Ce texte est double (césure, coupure) : à la fois abstrait et concret ; froid et sensuel. Alternatif (apparition/disparition).
Le principe du volume sera le pli. Une forme en accordéon qu’il faut déplier. Le Livre déplié, on a deux faces.
Sur une face, le texte imprimé sur fond blanc du papier. Chaque « page » est un bloc, avec en son centre une, deux ou trois lignes de texte. Chaque « page » est un miroir de n’importe quelle autre page. « La disparition de l’objet en miroir… : lieu du miroir. » Répétition. Entre les « pages » (division, alternance), une saignée de couleur rouge, grenat, brun rouge, etc. « Le corps porte le blanc de la fiction qui le divise. »
Sur l’autre face, des aplats de papiers collés de couleur rouge, grenat, brun rouge, etc. Blocs qui débordent dans les saignées de l’autre face : « un débordement imprègne et devient cet excès » :
Le volume déplié, posé verticalement, peut être vu (lu) par transparence ou devant un miroir (champ contrechamp). Le livre a souvent été exposé selon ce dispositif de miroir au fond de la vitrine.
Telle a été ma lecture de ce texte, sa traduction. Évidemment, ce n’est pas une illustration. Une illustration, c’est représenter des bateaux en face d’un texte qui parle de bateaux.
Une fois que ce livre est réalisé, je peux dire que j’ai fait communiquer ma peinture et la poésie d’Anne-Marie Albiach. Mais n’est-ce pas aussi en passant par des préoccupations de sculpteur ?
Une question que je peux me poser à partir d’une expérience telle que celle-là : qu’est-ce que ma peinture a gagné, ou de quoi s`est-elle enrichie ?
Et en quoi ?
Et qu’est-ce que le texte a gagné — ou éventuellement perdu — dans cette confrontation ? Est-ce que, lorsque je reviens à mon travail spécifique de peintre, c’est-à-dire au tableau, quelque chose a changé pour moi ? Ou encore, est-ce que ce travail sur le livre, lorsque je reviens au tableau, fait que je fais mieux ce que je fais, mes tableaux ?
Il ne s`agit pas d’une expérience d’ordre esthétique, mais d’une ouverture dans le travail. À partir de la description d’une expérience de ce type, entre deux disciplines différentes, mais considérées comme voisines (appartenant toutes deux à ce qu’on appelle le domaine artistique), est-ce qu’on peut imaginer des passages analogues entre des disciplines telles que philosophie et écriture, musique et mathématique, etc.
Ici, je pose une question : qu’est-ce que ça veut dire le domaine artistique ? Après tout, pourquoi des travaux de création aussi différents que la peinture, l’écriture, la musique, la sculpture, la danse, etc., sont-ils rangés sous l’appellation générique d’Art ? Qu’est-ce que créer ? Qui est créateur ?
Est-ce que vous créez, vous qui êtes dans d’autres disciplines ? Est-ce que vous ne créez pas ?
Raquel Levy
SOMMAIRE
-
-
INTRODUCTION
RAQUEL LEVY
page 1
-
-
L’ÉCRITURE
CLAUDE BIRMAN
page 3
-
-
LITTÉRATURE, SCIENCE,
TRADITION JUIVE.
JEAN-MICHEL SALANSKIS
page 4
-
-
DÉBATS
LE CHIFFRE ET LA LETTRE
page 14
L’ÉCRlTURE
Par Claude Birman
L’écriture naît de la divination. Sublime dans son ambition, mais dérisoire dans ses procédés, le devin associe tel événement à tel signe et conserve la mémoire du signe pour prévoir, à partir de son occurrence à venir, la reproduction de l’événement. L’indigence de la divination tient évidemment à l’arbitraire de ces associations prétendues, accumulées au moyen d’une observation empirique inapte à distinguer les rencontres aléatoires des consécutions effectives. Mesure pour mesure : l’inanité de cette confusion initiale propre à la divination se dévoile dans l’éclatement ultérieur des fonctions positives de l’écriture. Échappant aux jeux et chimères du devin, l’écrit devient véhicule pour deux utilités diverses : notation des hymnes et comptabilité. Le mage s’efface devant l’assurance du prêtre exalté, devant l’audace du roi calculateur. L’hymne dit le divin qui inspire ces passions qui nous conduisent, le calcul met à leur service sa rationalité. Tablettes de chant, tablettes de comptes : première dissociation institutionnelle du temporel et du spirituel, qui mutile et fausse les parties dissociées. Privé de rationalité, l’hymne glisse dans l’idolâtrie : comment éviter la fascination du symbole, s’il n’est relativisé par sa place dans une série numérique ? Privé de référence fixe, le calcul les tourne toutes en dérision. Il les sert et les quitte tour à tour, puis les abolit enfin, ne servant plus d’autre maître que lui-même. Il retourne à son profit le sacré par la consécration de la quantité. Avoir plus vaut mieux qu’avoir mieux, si avoir mieux n’est plus qu`une question de plus ou de moins.
Par cumulations culturelles, ces deux usages de l’écriture atteignent les formes élaborées du langage mathématique et du langage mystique.
L’intelligibilité mathématique oriente vers la maîtrise de la nature. Par sa méthode de réduction des faits aux données quantifiées, elle délivre la perception du réel de toute imagerie. Mais cette vérité dite scientifique n’est pas encore une vérité ; elle n’est que non fausse, objective, c’est-à-dire d’une subjectivité neutre, disponible pour une détermination plus individuelle. Le langage mystique la développe de son côté, par ses appréhensions poétiques, prophétiques, métaphysiques, de l’unité. Il atteint là une « vraie vérité », mais défigurée par son isolement. Solfège et logique mathématique font bien deux langages universaux, deux écritures dont l’une peut rendre compte de toute qualité, et l’autre de toute quantité. Le langage des tonalités (acoustiques, picturales, mais aussi tactiles, olfactives, gustatives ou combinées) se juxtapose à celui des nombres. La chaleur du ton d’une couleur ne s’indique pas dans la mesure de sa longueur d’onde. Tons et longueurs : cette dissociation marque l’échec de l’écriture. Une écriture ontologique noterait le réel indivis, et non alternativement ses aspects qualitatif et quantitatif.
L’écriture réinventée rapporte le compte au chant, applique l’un au multiple. Ainsi, la particularité du langage biblique est de viser à manifester le « réellement réel », à savoir le pouvoir de réalisation. Cette écriture sert une perception qui saisit dans son unité l’objet comme tout. Elle n’admire ni ne compte les choses. Elle n’est ni phénoménologique ni scientifique. Elle apporte aux choses la dénomination qui les renouvelle à partir de leur fondement. L’écriture poétique comme l’écriture mathématique n’ont en regard de potentialités créatrices, surréalisantes que dérivées. Elles sont les bénéfices secondaires d’une inventivité plus essentielle, mais plus secrète. L’écriture primordiale ignore la dissociation du nombre et de l’image, du chiffre et de la sphère, qui ne résulte que de sa décomposition. Elle se réaffirme en intégrant compte et chant dans la dualité organique d’un langage abstrait algorithmique apte à signifier l’unité du chant, enveloppé par un langage concret expert dans le décompte des actes et situations. Ainsi se réordonne la dérive des symboles : au lieu que l’essentiel s’évoque par des images tandis que le contingent fait l’objet de mesures affines, la réalité intime des choses devient visée d’une pensée rigoureuse et l’apparence dicible dans sa densité.
LITTÉRATURE, SCIENCE, TRADITION JUIVE
par Jean-Michel Salanskis
J’ai préparé une réflexion que j’ai intitulée « Littérature, science et tradition juive ». Elle correspond à la manière dont j’avais compris ce qui nous rassemble aujourd’hui. Je ne suis pas certain que mon interprétation soit la bonne ou, au moins, la seule possible. Mais j’ai bon espoir qu’elle soit dans le cadre. En tout cas, c’est effectivement une manière de se poser, disons, la question de l’unité. Moi, ça me gêne de la nommer comme cela, mais pour des raisons qui sont peut-être des raisons philosophiques non universelles. Le thème de l’unité est un thème qui a le propre de m’angoisser. Ce qui a été désigné là, dans l’intervention de Raquel Levy, et qui viendrait un peu donner sa chair à cette question de l’unité, ce n’est pas absolument sans homologie avec ce dont je vais parler. Il s’agit bien d’élaborer, à partir de cette situation de fait où nous sommes, qu’il y a de l’incommensurable dans les genres (moi, j’aurais envie de dire les genres de discours), mais ce ne sont pas simplement les genres de discours, mais les genres d’activités. On pourrait dire que ce sont les genres existentiels. Il y a de l’incommensurabilité dans les genres existentiels et finalement cela prend la forme de ce que j’aime bien appeler disciplines. Discipline est un mot qui a peut-être, par excellence, la faculté de nommer quelque chose qui n’est pas inauthentique (c’est pour cela que je ne dis pas institution), mais qui contient bien en soi l’idée d’une forme dure. On n’est plus dans l’indéterminé ; on est dans un mode spécifique et c’est ce que dit le mot discipline. Donc c’est un peu de ça que je vais parler. Je vais parler d’un problème de communication ou de difficulté d’interprétation, ou de difficulté de traduction entre des régions disciplinaires. Et les régions disciplinaires qui vont être évoquées par moi seront la littérature, la science et la tradition juive. Les titres sont trop larges : la science ne va pas vraiment intervenir comme telle dans sa figure la plus générale, mais ce seront plutôt les disciplines formelles, et même probablement de façon proéminente, les mathématiques qui seront présentes à mon esprit. La tradition juive, elle aussi, interviendra d’une façon spécifique, mais peut-être que c’est à ce niveau-là que la réduction, par rapport à ce que pourrait suggérer le titre, sera la plus faible. Et là où la réduction sera vraiment scandaleuse, c’est vis-à-vis de la littérature qui, vous le verrez, est à peine réellement présente à mon esprit. Ce n’est pas tout à fait un hasard. Il faut quand même, même si l’exposé ne fait pas droit d’une manière précise ou restitutive à la richesse de la littérature, il faut quand même qu’elle soit présente pour cette réflexion, au moins comme titre. Alors voilà, c’était donc mon entrée en matière avec le climat que j’ai ressenti. Maintenant je raconte l’histoire elle-même.
Le thème choisi pour l’agréable rendez-vous qui est aujourd’hui le nôtre à Royaumont fait signe, pour nous, de manière indéfectible vers une alternative disciplinaire. Le chiffre et la lettre, en effet, nous les comprenons comme disant respectivement le champ du lógoV calculant peut-être, selon toute probabilité, celui de la science et le champ de l’écriture inspirée peut-être, selon toute probabilité, celui de la littérature. Or, il se trouve que la tradition juive se laisse appréhender tout à la fois d`un côté comme de l’autre : comme le développement fidèle à l’origine d’un poème, d’un mythe, d’une littérature, d’une prophétie, d’un art du langage s’égalant à une mystérieuse compétence pour l’existence angoissée-heureuse, et comme l’accumulation étrange d’une science éthique, d’une métaphysique rationnelle du « Qui ? » 1, d’un rigoureux formalisme de la pensée et du comportement. La première acception privilégie naturellement la référence au récit biblique d’une part, à sa méditation universelle et résonnante dans la Kabbale d’autre part, ou finalement, le secret précieux de l’existence juive déjudaïsée ; la seconde, en revanche, a les yeux fixés sur le Talmud, la loi, et l’existence observante.
À quoi il faut ajouter, pour ne pas induire en erreur, ni sous-estimer la difficulté de tout jugement d’un tel cas, que la tradition juive ne saurait être perçue que comme une forme antécédente, préalable du champ disciplinaire invoqué : comme une écriture inspirée d’avant la littérature, une prélittérature, ou comme une science ratiocinant avant la synthèse logico-mathématico-physique de la science proprement dite, une pré-science. Ou encore, même si la tradition juive ne devait pas être envisagée « avant », et donc comme esquisse ou prélude plutôt que comme accomplissement, elle manque pour des raisons radicales à pouvoir être véritablement identifiée comme science et comme littérature : n’est-elle pas, nul ne l’ignore, une tradition religieuse ? Même si, plus qu’une autre, elle s`affranchit de la crispation caractéristique de la pensée spécialisée, notre réflexion perdrait beaucoup de sa pertinence possible à négliger de telles limites.
Le champ problématique
de l’alternative Science/Littérature
Tâchons donc d’explorer ce que réactive et ce à quoi peut nous amener la considération de l’alternative qui nous occupe.
Interroger la relation de la tradition juive à la finalité et la méthode littéraires aussi bien qu’à la finalité et la méthode scientifiques nous apparaît d’abord comme nécessaire parce que c’est une façon de poser le problème général de la place qui revient à la tradition juive : en tant que quoi la comprendre ? En effet nous savons bien, à partir du registre politique, qu`une question ne cesse de se poser dans l’urgence historique, la possibilité de l’antijudaïsme sous l’une ou l’autre de ses formes dépendant de la réponse : le judaïsme est-il une religion, la loi d’un peuple, ou bien encore un « esprit » donnant lieu à une école, mais n’ayant pas lieu d’avoir lieu, ni sur la carte du monde ni dans le champ des confessions, voire plus généralement dans le spectre des comportements possibles ?
Un tel nœud problématique révèle la non-indifférence de la question épistémologique : il est clair que ce que nous pourrons dire au niveau d’une réflexion érudite-éthérée du rapport que la tradition juive entretient avec un modèle littéraire ou un modèle scientifique aura du poids et du sens pour l’interprétation du lien social juif, s’il est vrai que la tradition reste le principal opérateur de ce lien. La science et la littérature sont à coup sûr, par exemple, des instances à l’égard desquelles la religion est en relation d’interdéfinition, et la légitimité avec laquelle on peut dire le judaïsme une religion est donc immédiatement concernée par la question épistémologique. Cela bien que le mot épistémologie, dans l’usage ordinaire, ne soit pas facilement employé pour qualifier ce genre d’élucidation. L’affaire du judaïsme est pour nous une occasion de comprendre la centralité philosophique de l’épistémologie : nous resterons néanmoins plutôt laconiques sur ce thème.
Poursuivant notre effort de situation, nous remarquerons encore que la tradition juive n’est pas seule à motiver une alternative de relecture où Science et Littérature s’affrontent. La psychanalyse, aussi, suscite la même sorte de perplexité de rattachement, ou de couverture a posteriori. Si Freud a voulu pour elle le statut de science, et si Lacan a pu sembler, par le recours qu’il faisait à l’exemplarité mathématique pour présenter la plupart de ses concepts fondamentaux, surenchérir à cet égard sur Freud, cela reste une sorte de vérité de fond, une évidence massive sans cesse confirmée par la statistique et la sociologie des intérêts, que la culture psychanalytique et la psychanalyse au sein de l’atlas culturel ont beaucoup plus à voir avec la littérature et l’art qu’avec la science et les mathématiques. Pour résumer de façon caricaturale, mais parlante, nous le croyons, la retombée de la trajectoire lacanienne, il semble que le maître français ait créé une armée d’adorateurs de la chose scientifique stylistiquement et conceptuellement voués à la chose littéraire, la prégnance des thèmes heideggeriens dans le lacanisme ayant plus d’impact sur les modes de pensée effectifs, sur l’usage de la lettre des psychanalystes, que l’emphase valorisante sur le mathématique comme tel. Notons d`ailleurs que le titre « le chiffre et la lettre » pourrait fort bien, pour ces raisons précisément, servir d’emblème à une réunion de psychanalystes.
Mais il faut voir, à notre avis, au-delà de cet exemple de la psychanalyse. Une alternative « Science ou Littérature » pèse d’une façon générale sur tout le champ anthropologique : si elle a été au premier plan du grand débat philosophico-méthodologique du structuralisme, qui occupait ce champ il y a vingt ou trente ans, elle a été nommée et pensée il y a plus longtemps, lorsque Dilthey a cru pouvoir spécifier l’herméneutique comme l’élément de ce qu’il appelait « science de l’esprit », et elle revient aujourd`hui, à la grande surprise de beaucoup qui se croyaient débarrassés de ces inquiétants problèmes, du côté des sciences cognitives, qui règnent désormais sans partage sur le même champ anthropologique : les critiques adressées par H. Dreyfus, T. Winograd et F. Florès au paradigme dit « cognitiviste » consistent essentiellement à nier que la connaissance puisse donner matière à une science ou une technique procédant comme la science exacte de la nature, à affirmer qu’elle relève de plein droit d’un savoir herméneutique (et la référence aux textes phares de l’herméneutique ne fait pas défaut dans leurs plaidoyers).
C’est donc un problème universel, connu comme tel, de savoir si une science humaine donnée vit essentiellement de la pratique interprétative spontanée des textes — et au-delà, relève philosophiquement de la situation herméneutique au sens quasi ontologique que prend le mot chez Heidegger ou Gadamer — ou si elle est justiciable d’une formalisation ou d’une mathématisation, l’une quelconque de ces deux opérations bien différentes suffisant en tout cas à arracher l’objet de la science humaine en question au champ littéraire (au sens large).
Si donc l’ampleur potentielle de la région concernée par l’alternative « Science ou littérature ? » doit être aperçue, il n’en reste pas moins que nous devons aussi rester capables des distinguos nécessaires pour approcher ce qui est proprement notre sujet. Dans le contexte que nous venons d’évoquer, science et littérature entrent en conflit au moment où il s’agit de théoriser un objet : faut-il alors emprunter un sentier théorique profondément apparenté à la littérature, faire jouer une modalité théorique de l’attitude littéraire (c’est cela que serait l’herméneutique), ou faut-il en appeler à ce parangon de la catégorie de théories qu’est la science ? Dite dans ces termes, l’alternative survient au moment où il s’agit de rendre compte d’un objet, elle survient relativement au pôle épistémique. Dans le cas de la tradition juive, notre interrogation est différente : nous nous demandons si la tradition juive est science ou littérature, si la modulation singulière du spirituel qu’elle incarne est à classer comme science ou comme littérature (ou bien, à titre de possibilités plus faibles : si elle doit être envisagée comme pré-science d’avant la science, ou plutôt comme prélittérature d’avant la littérature ; ou encore, si elle doit être dite analogue à la science ou à la littérature), mais nous nous le demandons « avant » de l’avoir classée comme savoir ou de connaître son objet.
C’est en ce sens que nous excédons le champ de l’épistémologie par la réflexion que nous proposons : au lieu qu’il y ait un triptyque
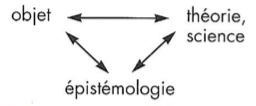
on a un discours (la tradition juive) qui ne se présente pas clairement comme connaissance d’un objet, et qu’il s’agirait d’annexer en quelque sorte directement à l’un des deux paradigmes, le littéraire ou le scientifique, sans qu’on puisse médiatement s’interroger sur la question de savoir comment il s’approprie un objet. Dans le cas épistémologique, le membre littérature de l’alternative n’est présent que par l’intermédiaire du terme herméneutique, lequel est à l’évidence une modalité scientifique de la littérature : on est déjà dans la théorie, dans le savoir, dans la science en un sens très large, il s’agit seulement de savoir si pour un certain type d’objet, un représentant théorique de la littérature, un représentant de la littérature dans le champ de la science, n’est pas requis. Dans le cas de notre interrogation sur la tradition juive, il y va pour commencer de la question de savoir si celle-ci peut tout simplement être vue comme un savoir, une théorie, cela fait partie de ce dont nous nous enquérons lorsque nous réfléchissons sur l’alternative « Science ou littérature ? » Néanmoins, le simple fait d’interroger une modalité de la pensée par rapport au modèle de la science, et d’envisager la coutume de cette forme de la pensée du point de vue du type de validation et d’enchaînement qu’on y trouve insère jusqu’à un certain point le régime spirituel considéré dans le contexte de la connaissance : d’où notre droit à parler tout de même d’épistémologie.
Nous nous en tiendrons là pour cette entrée en matière. Il convient maintenant d’essayer de prendre position sur le sujet à partir d’une évocation du contenu de la tradition juive.
Formalité de l’intelligence halakhique
Dans cette perspective, nous allons nous appuyer sur ce que nous osons, avec quelque outrecuidance, appeler les « résultats » des quelques tentatives qui ont été les nôtres au cours de ces dernières années de comprendre la tradition halakhique dans la perspective d’une analogie avec les disciplines formelles. Tout d’abord, soulignons bien quel était l’objet choisi pour ces efforts d’homologation : exclusivement l’élaboration talmudique. Étaient donc par principe mis à l’écart tout aussi bien la philosophie médiévale juive, la tradition kabbalistique, la Torah comme texte narratif édifiant-par-lui-même (la Torah « protestante »), et même le midrash, c’est-à-dire la Torah comme texte édifiant au gré d’une lecture juive autorisée. Notre point de départ était la reconnaissance du caractère juridique du propos talmudique : nous partions d’une première analogie, prise comme indiscutable, entre Talmud et code Napoléon. Il s’agissait alors de qualifier dans sa relation au mode formel de l’intelligence la méthode selon laquelle les savants-décisionnaires font évoluer le code et la compréhension du code.
Ce que nous avons relevé est tout d’abord3 le fait que tout le raisonnement traditionnel, si contourné, si sidérant qu’il puisse être, quel que soit l’usage du « raccourci », de la « fulgurance » qui est volontiers le sien, s’adresse toujours à des structures logiques standard, « aristotéliciennes », si on veut les caractériser par un label grand public (en ayant à l’esprit quelque chose comme Van Vogt et son Monde des Ā), affiliées à la logique des prédicats du premier ordre, si l’on veut nommer en termes modernes leur rattachement. Nous avions décrit, en prenant l’exemple de la théorie du garmi et du grama, comment l’intelligence traditionnelle constituait des arbres de ramification des catégories juridiques en relation avec des critères selon une voie réflexive au sens kantien (à partir de textes donnant des exemples de cas). À ce niveau, le lien avec la chose formelle est lâche et tient peu au fait qu’il s’agit du droit juif (la même chose se dirait sans doute d’autres droits) : le lien se limite au fond à une sorte d’inscription de la théorie juridique comme théorie logique parfaite, comme arborescence nette, bien tranchée à chaque nœud, selon des critères univoques (et ce en dépit du fait que l’on sait bien que devant le réel, les catégorisations ont toute chance d’exploser, d’être mises en défaut par les innombrables cas d’intermédiarité concevables : certes le tribunal, les juges sages-savants auront à trouver la manière de saisir chaque cas, pour ne pas le nier dans son ambiguïté, mais il est posé que la tâche de la théorie est de produire une structure parfaite des cas purs). Le caractère réflexif de l’approfondissement historial de la compréhension des catégories du droit halakhique, en revanche, semble quant à lui l’indice d’un type de pensée littéraire-herméneutique.
Dans une seconde réflexiont4, nous avions mis l’accent sur trois registres de « collusion » possible entre talmudisme et disciplines formelles :
1 - la relation à l’infini – 2. le caractère jusqu’à un certain point « axiomatique » du dégagement des catégories et de leurs liens – 3. l’engagement de la pensée traditionnelle juive dans la direction d’une « logique pratique », assez comparable dans ses thèmes et ses problèmes à celle que des modernes comme Von Wright ont pu proposer5.
C’est le second point qui constitue une surenchère sur ce qui précède, tout en concernant au fond le même corpus, à savoir la structure catégoriale se dégageant de l’exercice intellectuel talmudique. Nous avions insisté sur ce qu’on pourrait appeler le conventionnalisme délibéré, absolu, de cet exercice. Si l’on dénomme formelle une démarche où l’on demande aux acteurs de prendre les termes toujours au sens de la convention en train de se dessiner dans le groupe où les phrases résonnent, alors l’exercice talmudique est formel : aussi bien les catégories de base, en termes desquelles se définit le « réel juridique », que les concepts ultérieurement dégagés afin de produire la forme synthétique de l’enseignement et du décret de la loi, et que même la littéralité du texte auquel se réfère la discussion sont décidés-négociés-prescrits par la discussion des docteurs, et nous devons les lire dans cet esprit.
Le premier point est en revanche un point que nous dirions, en langage de théorie des fondements des mathématiques, un point « sémantique ». De même que les théories formelles modernes mettent en scène un « réel » fictif-platonicien infinitaire, à l’égard duquel on recommande de ne pas croire, mais qui reste obstinément dans le champ parce que sans lui, on ne sait pas tenir à la question du continu et de l’espace, de même, les théories juridiques du Talmud « présentent » l’imprésentable connu comme tel usuellement nommé Dieu, sans doute parce que, à défaut, l’élaboration du droit ne saurait plus tenir à ce qui est son enjeu, et qui est l’infini-de-ce-qu’on-doit-à-autrui, disons l’éthique.
Le troisième point est en quelque sorte la synthèse des deux, mais en même temps, il se situe sur un autre plan : si l’enjeu ultime est l’éthique, le champ est nécessairement celui de l’éthos ; mais découper et comprendre l’éthos selon une structure logique parfaite, cela peut bien passer par une décision conventionnelle des catégories naturelles et juridiques, cela ne peut éviter d’impliquer une compréhension elle-même formelle de l’action.
La synthèse théorique du droit n’a pas seulement à prendre en charge la catégorisation statique de ce que le droit évalue, elle doit aussi envisager les comportements, les décisions, les normes, et la logique des phrases qui leur correspond : il n’y a pas seulement une logique de la dénotation-description à la clef, mais aussi une logique de l’action, la prescription, etc., une logique pratique.
Et nous avions relevé dans le document talmudique plusieurs traces d’approche de type « pragmatique » au sens moderne, logique du mot. L’analogie que nous parvenons ainsi à soutenir a-t-elle des conséquences précises sur le jugement du rapport de la tradition juive avec la science et la littérature, respectivement ?
Le statut de la dracha
Bien entendu, il faut d’abord rappeler la restriction par laquelle nous avons initié le bref exposé de l’analogie que nous avons donné : si une collusion définitive du mode talmudique avec la science formelle devait être décidée à la lumière de l’analogie, cette décision n’engloberait pas le « reste » (considérable) de la tradition juive.
Deuxièmement, faisons encore l’observation de méthode suivante : nous nous sommes laissé guider exclusivement par ce que nous aurions envie d’appeler l’éthos logique de l’activité talmudique, en voulant désigner par là l’ensemble de ce qui la règle, ou sa constance factice comme coutume, et qui n’est pas nécessairement visible à la surface, ni même explicite. Notre hypothèse philosophique générale est qu’il n’y a pas de pénétration épistémologique authentique des genres de discours autrement que par le partage de l’éthos logique « en situation » : c’est seulement à ce prix et sous cette condition que l’épistémologie peut coïncider, dans notre esprit, avec l’art de la lecture externe qui nous semble un des visages essentiels de la philosophie aujourd`hui ; paradoxalement, la lecture externe n’est conforme à sa vocation que si elle passe par l’internalité de l’éthos logique). Donc, la référence au chiffre, à la numéricité, n’est pas ce qui fait critère pour nous. À première vue, et tout en sachant notre incompétence (qui tient, précisément, à ce que cette fois, nous manquons de l’éthos logique), les gematrioth contiennent un renvoi à la numéricité, et l’on pourrait faire passer par là le rattachement de la tradition à la mathématique ou à la science. Nous jugeons au contraire — de loin — que l’important est que ce renvoi se situe au niveau du lexème (on compte la somme des valeurs des lettres d’un mot) ; or, privilégier le niveau du lexème nous semble un grand trait caractéristique du mode littéraire de la pensée, lequel est encore le mode non littéral de l’herméneutique, dans les termes de Salanskis [l99lb] 6. Donc nous verrions plutôt les gematrioth comme les complices possibles d’une assimilation de la tradition à des modèles littéraires. Ce sur quoi nous nous appuyons, en revanche, on l’aura constaté, concerne ces « niveaux » du discours que nous savons décisifs pour la mise en œuvre de l’esprit formel et scientifique : la phrase, le texte, la syntaxe, l’inférence…
Sur le point central qui nous occupe depuis le début de cette réflexion, venons-en maintenant à l’essentiel : nous croyons que les éléments d’analogie que nous avons dégagés qualifient en effet plutôt le mode traditionnel juif comme un mode formel (formel/scientifique, sous réserve que la science soit réellement associée de façon indéchirable à la formalité, ce qui, bien entendu, pose en fait problème) que comme un mode littéraire. L’éthos logique partiellement identifié par notre analogie est celui d’une formalité, et par définition, cet éthos logique est régulateur, configurant pour l’exercice halakhique. Néanmoins, il y a une difficulté, et elle est de taille : c’est celle que soulève cet opérateur privilégié de la pensée talmudique qu’est la dracha. Or cet opérateur nous renvoie à la strate littéraire. La dracha, c’est la mise en avant d’un verset de la Torah afin d’énoncer un enseignement du Talmud sur la loi : le verset mis en avant n’est pas là pour apporter de l’autorité à la parole d’un docteur déjà pleinement autorisé, mais pour spécifier/exprimer en quel sens doit être pris l’enseignement sur la loi qui est prononcé. Ce « en quel sens » lui-même signifiant à la fois que la dracha aide à déterminer les frontières de ce que veut la loi (la limite du permis, de l’interdit, qui renvoie le plus souvent à un problème de catégorisation du monde naturel ou de la sphère du comportement du monde-de-la-vie en général), et qu’elle évoque les registres de significations dans lesquels saisir les termes de l’énoncé de la loi.
Par conséquent, l’intelligence talmudique est techniquement adossée à un texte de littérature, celui de la Torah. Elle prend les significations dont elle a besoin dans ce réservoir non quelconque. De plus, il est à peu près clair que la fonction de la dracha va relever la plupart du temps d’un modèle herméneutisant/lexical, donc littéraire en notre sens : très volontiers, l’enjeu de la dracha est de nous faire entendre un mot dans un certain sens. Est-ce que la prise en compte du phénomène de la dracha suffit à faire basculer nos analyses, et à nous faire revenir à un modèle littéraire herméneutique classique pour le talmudisme ? Nous n’irions pas jusque là. En fait, la situation est doublement complexe.
1) d’une part, la dracha indique une non-clôture de la formalité talmudique. Il n’est pas vrai que cette dernière se donne le texte de la Torah comme thème, comme objet, comme vis-à-vis de son mouvement herméneutique propre, comme il arrive dans le mode herméneutique protestant. La dracha n’est même pas le midrash, qui se donne comme réagissant à un verset, bien que ce ne soit généralement pas une réaction élucidante au sens herméneutique classique : la dracha va chercher le verset qui lui convient, et donne donc au document toraïque un rôle passif. Mais l’indication de non-clôture est tout de même essentielle : elle dit que les significations avec lesquelles se tisse le jeu juridico-logico-formel du talmudisme ne peuvent pas être immanentes à ce jeu, égalées à la manière dont il les joue ; on doit toujours faire reparler une parole qui n’est pas prise dans le jeu et qui apporte la pure bénédiction d’un supplément de sens.
2) dans ce recours, l’intelligence talmudique n’a pas comme objectif l’élucidation du sens déposé dans la Torah, nous l’avons déjà dit. Cela veut dire, comme nous venons de l’affirmer, qu’elle n’est pas une herméneutique-de-la-Torah au sens de Ricœur, mais cela veut dire plus que cela : en fait, elle ne peut pas non plus en être une science, parce qu’elle ne se tourne pas vers le thème de ce que dit la Torah, elle fait parler la Torah pour élucider la loi que disent la Michna ou la Guemara. L’excès de signification « littéraire » vient donc pour alimenter l’herméneutique de la loi, que nous concevons comme analogue à l’herméneutique formelle de la mathématique, et non pas pour être par lui-même un enjeu cognitif. Précisons ce deuxième point afin de dégager la différence entre la situation talmudique et la situation mathématique. Dans L’herméneutique formelle7, nous avons expliqué dans quelle mesure on pouvait reconnaître, au sein de la mathématique, l’activité d’une herméneutique formelle, inscrivant sur le mode formel les versions successives de l’énigme du continu, de l’infini, de l’espace, et relançant ainsi toujours plus profondément l’injonction d’avoir à les penser qui situe historialement la mathématique.
Reste que l’infini, le continu, l’espace sont pour la mathématique des termes-à-connaître ; la mathématique est en position prédicative à leur égard, bien qu’elle prédique d’une manière très particulière (par des théories plutôt que par des phrases, et sans doute, à la vérité, par les textes-selon-les théories, en dernière analyse, plutôt que par les théories elles-mêmes). Et, si ces termes sont maintenus dans leur transcendance au fil de l’herméneutique formelle, il n’en est pas moins vrai que d’une certaine manière, il court toujours une présomption de recouvrement de l’énigme (qui peut parfois prendre des formes idéologiques abusives ; on ne peut pas ne pas faire comme si la version de l’énigme recouvrait l’énigme, et c’est toujours de la version elle-même, ou de son rapport à celles qui précèdent que vient la réaffirmation de la transcendance de l’énigme.
En revanche, le fond littéraire de la Torah n’est pas mis du tout en position de sujet de l’énoncé [sujet du dialogue, du texte] par l’intelligence talmudique, et le supplément de sens qu’il apporte sert à l’élucidation du sens de la loi tel que déposé dans ses « versions » que sont par excellence les codes michnaïques [la Michna originelle, mais aussi le michnê Torah, le shoulkhan aroukh, etc.]. À l’intérieur de l’herméneutique de la loi, on peut reconnaître, nous semble-t-il, un fonctionnement analogue à celui de l’herméneutique mathématique ; les versions sont prises comme recouvrant l’énigme de la loi au sens où l’on ne peut pas accéder à ce qui fait énigme dans la loi indépendamment d’elles, et au sens où elles sont bien l’inscription projetée de la totalité de la détermination de la loi, à chaque fois. La Guemara, d’une part, dévoile la transcendance du sens de la loi sur la formulation michnaïque originelle par un questionnement logique des limites de ce qu`elle vise, d’autre part, semble-t-il, — et c’est là qu`elle se sépare du modèle mathématique — elle met la pensée en quête de suppléments de significations essentiels pour les concepts qui l’organisent, et ce en faisant appel à un autre lieu du sens, celui de la Torah dans son ensemble, qui n’est pas seulement la première esquisse michnaïque, mais aussi, le récit de l’histoire du peuple juif, le récit métaphysique de l’origine du monde et de l’humanité, un recueil de maximes, proverbes, psaumes et poèmes, etc.
Néanmoins, et ce serait peut-être, d’un certain point de vue, le plus important, le lieu du sens toraïque reste en position passive ; le sens qui est capté aux fins de l’herméneutique de la loi est plus un sens imposé au texte de la Torah, ou tout du moins, « dont il est capable si on le veut », qu’un sens dont le texte de la Torah exigerait par lui-même qu’il fût entendu. La fonction de surabondance de la Torah se limite à ceci qu’elle fournit l’occasion du sens, c’est-à-dire, la plupart du temps, l’indication d’un contexte. Soit le cas suivant : la dracha « le verset dit : celui qui frappe un homme frappe une bête », dans la halakha des coups et blessures, nous fait comprendre que la loi du talion — selon laquelle, si l’on a blessé son prochain, on le dédommage en argent — demande d’envisager le corps de la victime comme force de travail, dans le registre économique. C’est l’intention herméneutique visant la loi, bien entendu, qui nous porte à extraire une telle signification du passage du Lévitique auquel la dracha nous renvoie. Mais nous ne pourrions pas être orientés dans une telle direction si la Torah ne nous présentait pas, entre autres choses, un univers humain authentique, où l’agriculture et l’élevage sont susceptibles de valoir pour l’économie en général. La surabondance de sens disponible dans la Torah, c’est, si l’on veut, le « savoir d’arrière-plan » [background knowledge] dont la théorie moderne de la cognition a découvert le rôle primordial pour l’intelligence humaine, mais avec incluse en lui toute la richesse des relations sociales, notamment les dimensions aiguës comme la poésie.
Pour résumer l’acquis de cette section, on aurait donc, avec l’activité talmudique, un exercice de type formel-scientifique quant à ce qui concerne sa visée propre et son style de fonctionnement et d’accumulation, mais qui reste comme atteint par le littéraire au plan d’une effraction essentielle, attestée par le mode drachaïque. Peut-être ne pouvons-nous pas, ici et maintenant, aller plus loin dans notre effort de comprendre. Essayons néanmoins d’ajouter quelques considérations qui auront trait à l’interprétation du fait juif dans l’histoire.
Bénédiction du sens,
mythe, identité, religion
Comment ne pas voir, en effet, que le point que nous venons de discuter sous l’angle épistémologique est en même temps le point où se noue la singularité juive ? En dépit des restrictions que nous n’avons pas négligé de faire, chacun sait que la tradition halakhique n’est pas un morceau quelconque de la « chose juive », mais son cœur. L’expérience d’une longue histoire nous enseigne, certes, que les juifs empiriques, de chair et de sang, ont déployé un monde qui excède largement ce noyau c’est ce que nos restrictions tenaient à concéder ; mais elle nous enseigne aussi que le couple formé par l’observance de la loi et le savoir nécessaire à cette observance n’a jamais cessé d’être le centre, le point névralgique auquel tout se rattache. La définition du juif mise en avant dans la sphère de l’observance, et le seul concept de mariage connu des juifs comme leur, continuent, en Israël exemplairement, de marquer de manière institutionnelle cette dépendance du fait juif sur le noyau halakhique, sans que personne ne semble envisager sérieusement de mettre un terme à cette situation. Les diverses tentatives de prendre quelque distance avec le contenu et l’herméneutique spécifique de la loi se soldent généralement par la perte de la référence juive, non pas certes dans le cœur des individus, la plupart du temps, mais dans la discussion et le devenir qui enchaînent sur la tentative. À vrai dire, on éprouve en y réfléchissant comme une certitude que Philip Roth ne pourrait pas écrire une littérature intégralement vécue par le monde comme « juive » alors même que la tradition juive, notamment la loi, n’y tiennent quasiment aucune place s’il n’y avait pas, par derrière et en plus, les « hommes en noir » au sujet de l’intégrisme desquels nos journaux nous font frissonner.
Mais, si la tradition halakhique est le cœur, le noyau, la Torah au sens large est à l’inverse cette part du message juif qui a échappé aux juifs, pour devenir le livre de la sagesse de centaines de millions de goyim : le christianisme mondial se définit comme cet héritage du judaïsme qui s`est débarrassé de la loi, et qui donc ignore l’accumulation talmudique [plus habile, en un sens, est l’option islamique : avouer la filiation en intégrant Moïse et Jésus à la narration fondamentale, mais sécréter par ailleurs un Talmud propre, une tradition exégétique de la loi qui se présente comme autonome]. Pour cet héritage, ce qui reste, donc, ce n’est pas « rien », c’est le trésor de signification auquel ne manque jamais de faire ses emprunts la tradition « formaliste » de la loi : la Torah. La brisure historique déterminant la solitude d’Israël en face d’un monde qui pourtant lit la Torah est donc en résonance et en rapport avec la situation épistémologique décrite par nous.
Est-ce à dire que le christianisme serait à comprendre comme une prise de pouvoir du littéraire dans un monde où prévalait le modèle formel-scientifique ? Une telle affirmation serait, bien entendu, bien trop sommaire et trop rapide. Proposons néanmoins deux observations qui suivent cette piste, mais de manière plus mesurée :
1) en installant le sujet religieux dans le seul rapport avec la Torah, le christianisme a en quelque sorte limité le commerce du sens au rapport avec la surabondance du sens. La surabondance du sens déposé dans la Torah dément pour l’exercice halakhique la clôture « mathématique » de l’herméneutique de la loi, rappelle que l’énigme même du sens de la loi ne se réduit pas à ce qu’en restitue-reconstruit-anticipe sur le mode problématique la science halakhique, mais qu’il y a derrière, plus englobante et plus irréductible, l’énigme de l’humanité comme humanité éthique. Il est structurellement fort différent de n’avoir cette surabondance qu’en arrière-plan d’une investigation « formelle » de la loi et d’être directement livrée à elle. Il apparaît ainsi que le christianisme est fondamentalement un protestantisme bien avant que le protestantisme n’existe, et que la situation du face-à-face avec la Torah est pour ainsi dire programmée dans l’option chrétienne au moment plus archaïque où elle se sépare du fonds juif. Il apparaît aussi que dans l’ordre épistémologique se produit la même chose que dans l’ordre éthico-métaphysique : comme Benamozegh l’explique si lumineusement8, Paul a voulu que les chrétiens fussent des juifs parvenus à la fin de l’histoire, des « morts ressuscités » pour qui la loi n’avait plus de sens, étant donnée leur substance eschatologique. De tels sujets, étant par-delà la loi, n’ont pas affaire avec la couche de signification qui est l’herméneutique spécifique et savante de la loi, ils n’ont par conséquent pas d’autre rapport au sens — dans le cadre de leur religion — que celui qu’ils entretiennent personnellement où qu’un clergé leur organise à sa surabondance absolue dans la Torah. Cette surabondance elle-même ne se produit plus comme quelque chose qui se relativise toujours, à la faveur de la dracha, à un geste logique dans l’articulation de la loi, elle semble destinée à diffuser seulement vers le sujet, à se fixer en lui comme sentiment.
2) Mais ce sentiment, justement, que fait-il de la valeur « mythique » de la Torah ? Après tout, la Torah est aussi le « mythe originaire » du peuple juif, la narration qu’on supposerait normalement riche de son identité historique. Et le mécanisme sentimental le plus simple n’est-il pas justement celui de l’identification adhésive à la geste du moi collectif où l’on se reconnaît ? L’éviction de la strate légaliste-formaliste-scientifique nous paraît induire le risque que la relation à la surabondance du sens prenne la forme d’un vécu sublime de l’appartenance. Il est tout de même singulier que les fondateurs de Salt Lake City aient eu Moïse et la terre promise à la tête, alors que ceux d’Israël rêvaient plutôt les idéaux socialistes de l’Europe. Le fait que la surabondance du sens soit vouée à l’herméneutique de la loi empêche le développement d’une ferveur identitaire littéraire dangereuse parce qu’elle relie la surabondance du sens à la position du moi — les juifs n’ont pas leur identité là où c’est sublime, là où ça raconte, dans le cinéma fabuleux de la Torah, mais là où ça fait mal, dans la halakha (et, malheureusement, par-dessus le marché, dans la persécution). Dans la situation chrétienne du face-à-face avec la surabondance du sens toraïque, le seul antidote possible est la contestation et le renversement de la narration traditionnelle par l’établissement scientifique des faits : la critique historique du récit de la Torah. Aussi cet antidote s’est-il développé dans le monde occidental chrétien. Nécessairement, semble-t-il, l’antidote a quelque chose à voir avec la science : là où n’opère plus la fonction « scientifique » de la loi, qui positionne le récit toraïque comme réservoir où l’on puise, et qui, par le rôle qu`elle lui donne aussi bien comme par la prescription qu’elle assume à l’égard de l’identité, interdit l’usage identitaire de la surabondance de ce sens, nous avons la science du fait historique, qui elle, conjure la piété identitaire en lui dérobant son bon objet narratif.
S’il est ainsi possible, dans le monde chrétien, en fait dans le monde chrétien déchristianisé, parce que le monde chrétien pur et dur ne tolérait pas la rectification historique de la bible, d’échapper au vertige identitaire, comment fait-on, dans ce monde, pour respecter la surabondance du sens, celle que la littérature est la seule à savoir délivrer et garder ? La surabondance désintéressée qui mande l’amour de l’humanité, au sens infini et singulier de l’expression ? Tel nous semble être le problème que débattent, d’une manière ou d’une autre, tous les contempteurs inquiets du statut de la « culture » dans nos sociétés. Et il est difficile, quel que soit l’optimisme naturel dont on jouisse, de nier la pertinence de leur souci.
Mais, délaissant ces perspectives acrobatiques de philosophie comparée des religions, nous pouvons aussi méditer le tableau épistémologique de la modalité halakhique donné dans cet article dans un tout autre esprit : en nous demandant ce que ce tableau enseigne au sujet du statut de religion du judaïsme. Et peut-être pourrait-on penser ainsi : par elle-même, la tradition talmudique n’aurait pas part au religieux, puisque, considérée ainsi, elle n’est pas autre chose que l’herméneutique de la loi, et qui plus est, elle l`est sur un mode qui la rattache plutôt au modèle formel/scientifique. Mais l’opération de la dracha introduit autre chose. Elle ouvre l’exercice sur une surabondance du sens qui induit comme une vision universelle multidimensionnelle de la situation éthique de l’homme. L’exercice halakhique n’est pas religieusement prescrit par cette surabondance, mais il est religieusement élargi, relancé, ouvert, il n’est pas enfermé dans la misère normale du sens, dans le scepticisme mystérieusement bivalent de la déréliction : scepticisme sur l’objet, et scepticisme sur l’évasion éthique.
Notre conclusion prudente et prévisible serait donc que le judaïsme est une religion. I
Agrégé de mathématique et docteur en philosophie des sciences, Jean-Michel Salanskis est chargé de recherche au CNRS.
Bibliographie
(1985) Wittgenstein : l’obligation ou la perplexité, in Le discours psychanalytique, p. 15-19.
(1986) La philosophie analytique et la tradition de la Loi juive, in 5747 Traces, CIíms.
(1991a) L’herméneutique formelle, Éditions du CNRS
(l991b) Die Wissenschaft denkt nicht, in Revue de Métaphysique et de Morale, no 2, p. 207-231
(1991c) Talmudisme et formalisme, preprínt. (1992) Le tort de l’image, in Césure no 2, p.163-196.
Notes
- Hansel (1983), (1988). 2. Salanskis (1985, 1986, 1991c, 1992). 3. Salanskis (1986). 4 Salanskis (1991). 5. Von Wright (1983). 6. On peut déplorer que dans le présent article, littéral vienne signifier l’autre du littéraire, mais peut-être cette incommodité nous aide-t-elle à respecter la difficulté de notre sujet. 7. Salanskis (l99la). 8. Benamozegh (1946).
DÉBATS
« Le chiffre et la lettre »
Philippe JAWORSKI. Jean-Michel, pourrais-tu préciser ce qui est, pour toi, l’élément discriminatoire entre la compréhension littéraire et la compréhension scientifique et où passe au juste cette frontière entre science et littérature ?
Tu as beaucoup parlé de « surabondance du sens » en y associant souvent l’adjectif « littéraire », surabondance littéraire du sens. Mais le littéraire ici est-il un mode d’appréhension essentiellement lié à la narrativité, est-il celui qui fait la place à la métaphore, ou est-ce qu’il supposerait de manière tout à fait fondamentale un type de relation qui serait de caractère herméneutique dans un sens très rudimentaire, presque primitif, c’est-à-dire une relation de sujet à objet qui passe par une médiation linguistique, donc à la fois un élément de codes extérieurs et un élément très subjectif, une expression directe du sujet ? Où passe exactement l’élément de discrimination ?
J’ai été très sensible à cette manière que tu as eue de tenir les deux termes sans faire retomber un discrédit, sans introduire cette dissymétrie qu’on trouve souvent entre science et littérature. Il me semblait plutôt au contraire que là c’était l’élément littéraire qui venait au dernier moment, sans arrêt, rouvrir sur autre chose ce qui se fermait. Évidemment, c’est une vieille histoire… mais je voudrais savoir où tu places le « bord ».
Jean-Michel SALANSKIS. Méthodologiquement ce n’est pas cette question que j’ai soulevée : j’ai pris comme problématique l’assignation du modèle littéraire ou scientifique à ceci ou à cela. J’ai fait comme si la démarcation science-littérature elle-même ne faisait pas problème, ce qui surlégitime ta question. Deuxièmement, ce que je pense de la démarcation. Je te répondrai d’une part à un niveau informel et d`autre part au niveau formel que tu as toi-même esquissé en disant : « La narration, un mode rudimentaire de l’herméneutique, la métaphore… » Je donnerai donc une réponse qui sera dans ce registre, c’est-à-dire critérielle. Mais je donnerai d’abord une réponse informelle en disant que d’une certaine façon je ne sais pas tellement. Je ne sais pas tellement parce que j’ai justement entrepris pour ma part un travail qui est de montrer que l’herméneutique fonctionne dans le champ formel. À partir du moment où l’on avance cela je pense qu’il faut tout de même en garder la radicalité. Si j’ai soutenu cela, cela signifie que je crois que la distinction ne « marche » pas, qu’elle est d’une certaine façon insaisissable, malgré tout. En même temps, même si je crois important de venir déstabiliser la certitude de « clivage », je crois aussi qu’empiriquement il est bon de savoir que ce sont deux choses et d’aller de l’une à l’autre… J’aime la séparation aussi si ce n’est pas une séparation durcie dans une espèce d’ontologie des genres du discours qui croirait être sûre de ce dont elle parle, donc une réponse sentimentale. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui semble pouvoir fonctionner la plupart du temps comme critère : la narrativité serait un candidat. Je ne sais pas si c’est le « bon » candidat parce que la narrativité est peut-être prélittéraire… Voilà une première chose que l’on pourrait imaginer : que pour qu’on parle vraiment du littéraire lui-même, il faudrait qu’il y ait autre chose que la narrativité. Deuxièmement, est-ce qu’on ne pourrait pas considérer qu`il y a de la narrativité dans le champ formel ? Je ne sais pas… c’est un candidat possible, mais ce n’est pas celui sur lequel je m’appuie le plus volontiers. Celui sur lequel je m’appuie le plus volontiers regroupe les autres points dont tu as parlé : caractère primitif de l’herméneutique, métaphore. Je crois qu’à un certain niveau on peut dire que le mode littéraire est celui qui attend le sens au niveau du lexème. Le mode formalo-scientifique est celui qui attend le sens au niveau de la syntaxe à un niveau global, à une plus grande échelle. Il y a donc une réserve du sens qui n’est pas encore là au niveau du lexème et qui viendra plus tard. Alors quand vient-il ? Est-ce qu’il vient au niveau de la liste d’axiomes ? Est-ce qu’il vient au niveau du texte démonstratif ? On ne sait pas trop : mais on peut dire qu’il n’est pas possible d’attendre le sens de cette manière-là si on n’accepte pas de le confier à la syntaxe. En ce sens que je dirai que la syntaxe est « relevante ». Non au sens où la syntaxe serait « en soi » une objectivité scientifique ou mathématique, mais parce que c’est la seule façon d’attendre. Cela rejoint ce que tu dis parce que l’herméneutique primitive est celle qui peut tout de suite s’interroger sur le mot (en tant qu’unité minimale sur laquelle on peut s’interroger) avant de…. Dans l’immédiateté humaine, qui est la même que celle de l’interlocution du dialogue, ce sur quoi on peut s’interroger c’est le mot : il y a à mon sens une appropriation de l’échelle du mot à l’immédiateté du « je-tu », par exemple. Je pense que la métaphore peut se rattacher à cela aussi. Voilà l’esquisse d’une réponse.
Philippe GUMPLOWICZ. J’ai été très intéressé, même passionné par ce que tu as dit et à la fin, je l’avoue, un peu déçu. Je me suis dit qu’au bout du compte on arrivait à une vieille dichotomie qui est celle qu’on trouve dans la tradition chrétienne, c’est-à-dire de « Judaïsme, religion de la loi », « Christianisme religion de la foi ». Est-ce qu’on ne retrouve pas cette opposition, la science étant du côté de la loi et la littérature étant du côté de la foi ? Tu as désigné des voies de passage, notamment la dracha, c’est très bien. Le Talmud est une exégèse infinie de la Loi, mais on peut se poser la question suivante : comment se fait-il que chez les juifs la littérature soit venue si tard ? À savoir que si le Talmud est exégèse, commentaires et déclinaison infinie de la loi, on peut définir aussi la littérature comme exploration infinie des figures et des tourments du désir. On a l’impression que cette aspiration à la littérature, à l’art même en général, a été comprimée pendant très longtemps chez les juifs dans la discipline du corset talmudique, ce qui fait que les juifs se sont astreints, génération après génération, à commenter, à décliner la voie, la loi. Il y a eu compression puis le christianisme a été comme une sortie ; cela a été comme une grande fuite à un moment donné amenant un salut qui venait par la foi, non par la loi. Et il a fallu attendre longtemps, très longtemps, pour voir arriver une littérature juive fondée sur une exploration des figures du désir ; (et, entre parenthèses, le fait que cela ait été si longtemps comprimé par la discipline, le commentaire, la loi, l’ascèse de la pensée, a donné à ce jaillissement quelque chose de très fort, de très intéressant.)
Et si question il doit y avoir c’est : comment sortir de cette vieille opposition entre foi et loi, dût-elle réapparaître sous les termes modernes de science et littérature ? Et pourquoi a-t-on ce besoin, qu’évoquait Raquel avec beaucoup de sensibilité, de cette expression diffuse, bredouillante, désirante, nous, aujourd’hui, ici et maintenant ?
Jean-Michel SALANSKIS. Il y a là plusieurs points, il me semble. Le premier est qu’il est triste de retomber sur la démarcation du judaïsme et du christianisme. Je conviens tout à fait du caractère assez largement traditionnel de ma conclusion de ce point de vue là, mais d`une certaine façon je me sens obligé de m’en tenir à une conclusion de ce type parce que j’ai l’impression que c’est pertinent sur l’objet. C’est simplement ça ma réponse : je crois que c’est vrai dans cet ordre. Toutefois j’aimerais corriger cela en disant que l’on gagne plus à avoir la distinction comme cela qu’à ne pas l’avoir, c’est-à-dire que ce qui est grave à mon avis dans la position chrétienne c’est qu’on perd le sens de ce qu’est qu’une herméneutique scientifique de la loi.
Mais une herméneutique scientifique de la loi est un objet extraordinaire et improbable. Je fais l’analogie avec les mathématiques et cela veut dire pour moi que je vois dans cette herméneutique scientifique de la loi la même merveille que les mathématiques et dans ma bouche, ce n’est pas rien de dire cela : cela atteste la tradition de la loi comme mode analogue au mode mathématique ou scientifique. Cela atteste une espèce de jonction mystérieuse possible de la déduction, du calcul, de l’inscription syntaxique parfaite d’une part et d’autre part de la relation herméneutique à l’énigme. Pour moi c’est considérable. Car ce qui me semble grave n’est pas tant cette dichotomie d’un christianisme du côté de la foi et du sentiment et d’un judaïsme du côté de la loi et de la science que de laisser agir de mauvais jugements axiologiques là-dessus, l’image de la science de la loi comme image de sécheresse, de sclérose et de mort et de l’autre côté le sentiment et la foi comme chaleur, vie, etc.
Le plus important à mes yeux par rapport à notre débat présent serait de garder cette distinction si elle est pertinente en y réintroduisant de bonnes perspectives, de bonnes axiologies. Ce serait ma réponse au problème un peu politico-sentimental que tu poses et auquel je suis sensible. Je voudrais maintenant aborder : tu évoquais ce que Raquel a dit et j’ai été aussi très frappé en l’écoutant, la question « qu’est-ce que le domaine artistique et qu’est-ce que la création » ? Si on admet qu’il y a une unité du domaine artistique et que donc les gens qui sont en dehors du domaine artistique (mettons par exemple les mathématiciens) ne créent pas puisqu’on ne créerait que dans le domaine artistique, c’est éminemment le genre de question que je me pose. Qualifier la tradition juive c’est un peu qualifier un « truc qui est en travers » comme l’art. Cela ressemble au problème de qualifier la science et la littérature dans leur rapport. En cela justement je te rejoins, c’est aussi le problème de la création. Car le Talmud est à comprendre comme une création. C’est évident d’ailleurs : il y a des milliers de pages, des arguments vertigineux, merveilleux, mais ce n’est généralement pas vu comme création. Je voudrais à la fois militer pour qu’on voie la prolifération, l’infinité, la merveille dans toutes ses activités et en même temps je crois que si on voulait ne pas les voir dans ce qu’elles ont de particulier on raterait tout. Ainsi, pour voir le génie de la tradition juive, il ne faut pas avoir besoin de dire que la tradition juive c’est aussi de la foi et de la mystique ce qui était la démarche de Sholem, par exemple. L’image de la tradition juive qu’il associait au Talmud lui était insupportable. Il écrit donc un énorme bouquin pour décrire qu’il y a une mystique propre, un sentiment propre dans le judaïsme. J’ai l’impression qu’on rate toujours quand on fait cela parce qu’on ne convainc pas les gens. On les convainc pendant un certain temps, ils disent « Ah oui » et puis finalement « c’est presque aussi bien que le christianisme », et puis après…
C’est similaire pour la question de l’art et si l’on veut comprendre qu’il y a quelque chose qui est axiologiquement comme l’art dans la science, je suis d’accord. Mais méconnaître la spécificité disciplinaire de la science, non.
Francis BAILLY. Je voudrais rouvrir une petite controverse dans l’emploi que tu fais, et que tu explicites d’ailleurs bien, du terme « herméneutique » concernant les questions scientifiques et sur l’aspect de clôture éventuel de l’aspect scientifique. C’est dans un certain sens, dans une certaine acception du mot « clôture » qu’il y a clôture du scientifique puisque le scientifique est précisément question sans cesse reportée d’une part et que, même à l’intérieur des systèmes formels d’autre part. on sait que le sémantique excède le syntaxique : et que de ce point de vue là on ne peut pas dire qu’il y a clôture à cause du syntaxique. C’est un premier aspect et il est relié au fait que dans le concept d’herméneutique, au moins historiquement, et je crois encore chez beaucoup de personnes. Il y a l’idée que l’on peut désigner une originarité et qu’il existe un « vrai » donné à découvrir. De ce point de vue il me semble que l’entreprise scientifique et notamment l’entreprise mathématique se présentent au contraire comme champ complètement ouvert de construction à élaborer, conceptuelle, référentielle, de calculs, de concepts et que cela ne renvoie pas à un « vrai » préexistant, mais que cela construit, à la fois de façon intégrative et en même temps contestataire, un « nouveau vrai » sur du « vrai » qui a été établi. Je prends l’exemple du continu et je ne pense pas que le continu tel qu’on le conçoit en un certain temps moderne réponde vraiment à un continu tel qu’il a pu être élaboré en un temps de l’Antiquité. Je crois que la construction est précisément l’élaboration créatrice de ce que la question du continu subvertit, mais dont le lexique a gardé le terme parce que, bien qu’il soit vrai qu’il y ait une énigme par-derrière, toute cette entreprise est une entreprise absolument ouverte dans laquelle il n’y a pas un sens préétabli à rechercher.
Je pense d’ailleurs, et je vais plus loin, que la question du sens n’est pas une question d’ordre scientifique. Les sciences n’ouvrent pas sur une question de sens. Cette question est exclusivement attachée aux relations humaines et bien qu’on se serve de la science pour développer les relations humaines en tant qu’instrument, c’est là une chose à laquelle donner sens ; dans la pratique scientifique elle-même, il n’y a pas de sens à proprement parler même s’il y a des structures d’intelligibilité et des choses comme cela. C’est important parce que sur cette question du sens et suivant l’acception qu’on lui donne et la distinction que l’on fait entre sens et signification et ainsi de suite, on est en mesure de dire qu`il y a une séparation à opérer, réelle, entre ce qui est littéraire, artistique et ce qui est scientifique. Et ce n’est qu’à un niveau extrêmement élaboré, presque vide de contenu, que l’on peut espérer reconstituer une forme d’unité, unité de type plutôt formelle. Que je retrouve d’ailleurs tout à fait dans le travail que tu présentes.
Ce n’est pas que je ne sois pas convaincu par rapport à l’herméneutique formelle que tu présentes, c’est qu’il m’apparaît que tu tires le terme « herméneutique » dans une certaine direction qui ne correspond pas à celle qui est reçue en général et qui peut créer des confusions et que, par ailleurs, le caractère « clos » de la démarche scientifique me paraît, tout à l’envers, très constructif et très ouvert.
Claude BIRMAN. Pour revenir à ce que l’on disait tout à l’heure nous sommes parvenus au constat que le caractère formel des activités dites littéraires aurait disparu au bénéfice du sentiment et de la foi. Raquel au contraire avait insisté sur la nécessité de connaître la chorégraphie pour pouvoir transcrire la peinture en danse ; la chorégraphie possède un caractère éminemment formel et ce que tu as dit sur l’analogie entre la forme juridique talmudique et la forme mathématique amène cette question qui rejoint le souci de Francis, à savoir celle de la différence d’intention 2 ce n’est pas la même chose d’être normatif et d’être descriptif. Or justement lorsqu’on parle d’infini en mathématique je suppose qu’on n’est pas normatif, mais descriptif… alors que lorsqu’on parle d’éthique, même si c’est formalisé dans le Talmud, c’est normatif. Mais ce n’est pas si facilement réductible.
Jean-Michel SALANSKIS. Est-ce que, selon ce que j’ai dit, la littérature serait exclusivement dans le « sentiment » ? Je ne crois pas. La seule chose que j’ai nommée comme étant du côté de la littérature c’est la surabondance du sens.
Là où j’ai introduit le sentiment, c’est pour décrire la situation où se trouve laissé le chrétien par l’abandon de la halakha devant la Torah. Cela paraît plus particulier que ce que tu me prêtes en l’occurrence. Que peut-il y avoir de formel dans l’activité littéraire ?
J’ai présenté un jour l’idée que je viens de développer à quelqu’un appartenant au groupe OULIPO et il a eu une réaction de grande exaspération ! Il avait l’impression que je lui refusais tout ce qui était « bien », à savoir le formel, et que je le laissais avec la merde. Alors, comment dire ?
Je me défends de cela parce que je ne veux certainement pas aboutir à cette axiologie : je vois bien que dans l’agencement de quelque chose qui est dans le champ artistique, roman, poème, peinture, sculpture, musique, etc., il y a de la formalité, au moins au sens où il y a des formes dont l’exactitude compte, par exemple.
Mais j’ai pris ici le terme de formalité dans un sens extrêmement spécifique : j’ai parlé de ce que j’ai appelé la convention axiomatique c’est-à-dire du fait de faire jouer les termes selon la convention qui est en train de se dégager dans un groupe, dans un travail. Il y a donc la question : qu’est-ce qu`on met derrière l’adjectif « formel » ?
Pour ma part je persiste à croire que, malgré OULIPO, ce qui passe dans le littéraire n’est pas cet élément disciplinaire propre que j’entends lorsque je parle de formalisme. Je crois plutôt que ce qui va intervenir au bout du compte est le logique. Il faut absolument distinguer ici le logique en tant que type de morphologie : selon Thom il y a des morphologies logiques particulières : hiérarchiques, arborescentes, comportant des réitérations toujours licites… etc.
À mon avis tout cela peut entrer dans le littéraire. Cela n’entrera pas comme l’enjeu de l’affaire et d’ailleurs je n’ai jamais été convaincu par les discours du type « Art expérimental » : des gens du milieu cinématographique m’ont expliqué que l’enjeu du cinéma serait de développer des « grammaires inouïes » de l’image… Je ne suis pas convaincu.
Je pense qu’avoir rapport à un certain mode grammatical selon la convention axiomatique tout en étant « branché » sur un terme imprésentable n’est pas le fait de la littérature. Ce qui paraît intervenir au contraire dans le domaine du cinéma ou de la littérature c’est un « jeu » avec les grammaires ou un jeu avec les morphologies logiques.
Mais ce que je décris et appelle « formalisme » est autre chose : c’est précisément une façon de s`en remettre à ces morphologies selon l’élément de la convention. À ce moment-là, les grammaires ne sont pas comme telles objets dans le mode mathématique, car si elles le sont dans ce champ précis cela veut dire qu’elles coïncident avec l’objectivité constructive. C’est alors un cas particulier.
Ce que j’ai décrit sont plutôt des morphologies logiques sujets par rapport à une énigme de l’infini par exemple qui, elle, est en position d’objet.
Danielle BAILLY. Il me semble que, si on amalgame les sciences humaines au littéraire au sens large que tu lui donnes, on réduit tout cela au classificatoire et à des combinatoires alors que dans ce domaine il y a tout de même un aspect argumentatif, analytique et explicatif (je pense entre autres à la linguistique), qui se compare aux approches théoriques que l’on trouve en sciences exactes.
Jean-Michel SALANSKIS. Je n’ai pas pris position là-dessus, j’ai rappelé l’histoire ; des gens ont dit : « les sciences humaines ne peuvent être qu’herméneutiques ».
Pour ma part je fréquente plutôt des sciences humaines qui tournent le dos à cela et qui s’installent dans le mode logique ou qui essaient de faire fonctionner des modèles mathématiques. Je pense néanmoins que lorsqu’on avance qu’on ne peut pas faire de linguistique sans faire réintervenir quelque chose comme l’élément herméneutique, cela me semble vrai. Mais c’est très complexe.
Le problème que soulevait Claude et qu’on tente d’analyser concerne ces statuts de morphologie logique incroyablement nombreux existants dans la nature humaine :
– Il y a la morphologie logique qui fonctionne d`une certaine façon dans les mathématiques : grossièrement parlant elle fonctionne comme sujet dans la convention axiomatique.
– Il y a la morphologie logique telle qu’elle va fonctionner chez OULIPO : là j’ai l’impression que c’est de l’ordre d’un substrat. C’est comme la gouache : comment vais-je présenter des objets qui vaudront en tant qu’art sinon en m`appuyant sur le substrat qu’est la morphologie logique ? Ainsi d’une certaine façon la morphologie logique peut être considérée ici comme un matériau d’expression.
– Dans l’ordre des sciences humaines, ce n’est qu’éventuellement qu’elles utiliseront les morphologies logiques comme vecteurs de modélisation, ce qui est déjà très différent. Et on sait très bien qu’en utilisant les morphologies logiques de cette manière on les utilise d’une manière très différente qu’en physique où ce qui se passe est tout autre chose.
– Et que se passe-t-il en l’occurrence ? C’est très complexe à expliquer, mais disons que, s’il y a au moins une vertu en laquelle nous sommes quelques-uns à croire de la lecture transcendantale des sciences, c’est celle de nous expliquer que les morphologies logico-mathématiques n’interviennent pas comme des modèles, que c’est autre chose, qu’elles sont en position subjective, un peu comme dans les mathématiques.
– Les morphologies logiques en mathématique sont dans une position subjective qui fait que c’est en elles que se dépose la version de l’énigme ; dans la physique il se passe très probablement quelque chose d’un peu similaire sauf que ce n’est pas l’énigme même de la physique qui est signifiée par les morphologies logico-mathématiques, mais l’acception particulière des catégories.
Voilà déjà quelques statuts. Il y en a beaucoup. Donc, à part le problème de savoir s’il y a des traductions, des distinctions fondamentales, il y a aussi le fait qu’il faut reconnaître la variété incroyable des mixtes qui existent.
Pour en revenir à ce qui se disait sur la prescription, je pense que comparer la halakha et la mathématique formelle, par exemple du point de vue de l’axe sémantique description-prescription, fait partie de ce que j’ai essayé de faire.
Cela dit, c’est complexe parce que d’une part en tant qu`herméneutique de l’infini, du continu et de l’espace, les mathématiques sont très largement prescriptives. D’autre part la halakha en tant qu’activité d’élucidation a de larges aspects descriptifs : si l’on veut faire une analyse dans le sens des philosophes du langage actuels, on trouvera dans le Talmud des énoncés de normes, mais aussi beaucoup d’énoncés descriptifs qui sont tels dans le sens d’une description métalangagière puisque beaucoup d’énoncés parlent d’autres énoncés. Lorsqu’on dit dans le monde juif que la hohmah est une science, je pense que cela désigne entre autres une description des « bonnes » catégories du « bon » droit, par exemple, et une description du système conceptuel qui préside à la réalisation sur terre du bien.
Philippe JAWORSKI. Je voudrais proposer en contribution à notre débat une réflexion sur l’exégèse, on parlait d’herméneutique, tout à l’heure, comme la possibilité de fournir à un texte une extériorité ou un « dehors » qu’il n’a pas.
En cela je me réfère à ce passage de « La muraille de Chine » de Kafka (dans la traduction d’Alexandre Vialatte) où celui-ci, avant Roman Jacobson, décrit cette structure paradoxale de la communication où, entre l’Empereur de Chine qui envoie depuis l’une des extrémités de la chaîne un message et le destinataire de ce même message à l’autre extrémité, se situe toute une série d’obstacles infranchissables qui font que le « messager porteur du message » ne peut jamais en réalité sortir de « l`espace intérieur » appartenant au destinateur — le palais de l’empereur —, et que même s`il y parvenait il s’affronterait alors au « milieu », à un « centre commun » dans lequel précisément on ne pénètre pas, la Ville Impériale elle-même : ici l’espace de la transmission ne s’ouvre pas, il ne cesse au contraire de se fermer et le destinataire en attente du message, de son côté, ne peut qu’appeler en rêve le message.
À partir de là, comment justifier cette activité de l’exégèse, du commentaire de texte, de la critique ? Il y a comme une solitude du texte, une intériorité dont il a absolument besoin. Cette espèce d’emprisonnement, de clôture peut-être de toute œuvre et de toute création sur elle-même apparaît comme indispensable. Le message n’est pas d’abord destiné à être clair, univoque, transmissible et susceptible d’être immédiatement accueilli par l’autre. Il y a comme une espèce d’obscurité de la création, consubstantielle à la création elle-même. L’œuvre a besoin d’un « dehors », d’une extériorité, qui ne peuvent lui être fournis que par ce qui n’est pas du tout elle. Le texte ne nous dit jamais comment il demande à être lu. Il ne nous parle pas la langue de sa lecture.
C’est un premier point. Le second est qu’en poussant plus loin il y a peut-être ici la démystification d’une certaine représentation de l’expérience littéraire 2 dans cette vision d’une communication jamais réalisée conformément à ce qui l’a suscitée peut-on voir une désacralisation de l’origine ?
En cela qu’on croirait, on imagine, on « rêve », recevoir le message, avoir accès à un message clair qu’on associe à la vérité, à la source originelle… Peut-être faudrait-il travailler sur l’envers de ce que cela pourrait être, sur le négatif en quelque sorte, pour tenter de sortir de ce « désastre » de la non-communication où l’on a à chacun des deux pôles d’une part un désir et de l’autre une attente et entre les deux le message cheminant indéfiniment et n’arrivant jamais.
Claude BIRMAN. On peut effectivement partir de cette question du message. Tu évoques l’attente du sens. On peut aussi renverser la proposition et poser le problème du sens de l’attente… Et dire que, quel que soit le message reçu, la distance demeure, que le message n’est jamais transmis, mais que nous en avons « quelque chose »… En rapprochant cela de notre thème du chiffre et de la lettre, on peut effectivement y voir aussi cette question de l’écriture qu’on a abordée aujourd’hui sous différents aspects.
Pour résumer, la difficulté est de distinguer sans les opposer et de mettre en rapport sans les confondre ces deux approches : l’une plus scientifique, chiffrée, formalisée, avec les réserves à mettre sur ce terme de « forme », calculante ; on pourrait éventuellement, par exemple, calculer le chemin qu’il faut franchir, où ce qui serait à écrire serait alors à compter, à recenser, à énumérer, à reconnaître, à décrire, ce qui donne une dimension de l’écriture en tant que valeur descriptive. L’autre dimension étant évocatrice, et évocatrice finalement d’une image.
Ces deux fonctions de l’écriture, l’une du côté du chiffre et opérant un compte, un recensement, l’autre du côté de la lettre et présentant une image, sont sans cesse interférentes. Mais si l’on veut s’y reconnaître, il convient de les séparer. C’est ainsi d`ailleurs que sont nées les mathématiques, en séparant le chiffre de la lettre.
Or les séparer c’est en même temps être dans le deuil de leur unification ce qui faisait le thème précis de notre rencontre d’aujourd’hui : si l`on ne sépare pas le chiffre et la lettre, on tombe dans la confusion, on ne sait plus où l’on est, on plonge dans une pensée magique, échec de l’usage de l’un et de l’autre discours. Et si on les sépare pour que « ça marche », que ça existe, on a alors le sentiment d’avoir perdu l’essentiel.
En un sens une activité strictement scientifique ne peut véritablement se déployer que dans un écart par rapport à une autre dimension qui se réfugierait alors dans un tout autre domaine.
Les premières sources écrites se présentent déjà soit comme consacrées à la comptabilité des maisons royales, écriture significative de la puissance royale et d’une neutralité qui ouvre la voie descriptive, soit utilisée pour composer des hymnes, écriture de type littéraire ouvrant même la voie à une écriture mystique, centrée non sur un décompte, mais sur une phénoménologie de ce qu’on peut appeler « l’unique essentiel ». Autrement dit cela donne une opposition entre une écriture tournée vers l’un et vouée à la répétition du même et une écriture qui prend en charge le multiple sans dire à quoi cette multiplicité doit être rapportée.
Or à l’origine dans la divination les deux sont confondus (l’écriture ayant été inventée, paraît-il, à partir de la divination). Et ce qui est confondu alors sont ces fonctions positives de l’écriture qui se paralysent : la véritable constitution est confondue avec la coïncidence ainsi que le signe avec la chose. La séparation entre écriture comptable et écriture hymnique est le prix à payer pour sortir de cette confusion.
Car le mélange entre ce qui serait ici évocation de l’essentiel, normative, chant qui dit la qualité et une discursivité qui fait le décompte de ce qui est déjà tangible aboutit à un propos magique.
On sépare la rationalité propre au calcul, et avec elle tout le travail de connaissance, de la manière de dire d’où viennent nos passions : on a deux discours, l’un objectif sur la nature et l’autre subjectif sur l’origine de nos émotions. On a d’un côté les tablettes des comptes et de l’autre celles des hymnes. Ce qui évidemment d`une certaine manière mène très longtemps après à la dissociation du spirituel et du temporel. Or, c’est un malheur en ce sens que la divination est une espèce de « péché originel » qui aboutit à la dissociation, à la dichotomie de l’écriture. Pourquoi ? Parce que si véritablement ce qui est du côté de l’hymne, de l’incantation, n’a pas d’appui rationnel et tangible, comme disait Jean-Michel, si la surabondance du sens ne trouve pas d’ancrage dans la rationalité, l’imagination, la pensée même, se fixent sur une représentation : on perd le moyen de passer d’une représentation à une autre. Autrement dit, le danger du discours poétique en ce sens est la fascination pour un « symbole « .
Si l’on ne peut pas situer un symbole dans une série numérique, on ne peut pas le relativiser. Il y a alors isolement, absolutisation. Il y a là le risque d’une dérive du discours religieux qui peut mener à une idolâtrie. Et, sinon à l’idolâtrie, du moins à l’irrationnel. Irrationnel ne signifiant pas ici seulement le manque de rationalité, mais le fait que démuni de rationalité on est pris au piège de la représentation.
Si l’on considère l’autre cas, le calcul, lui, ne possède pas de référence fixe ; il y a donc là perte du référent puisqu’aucun référent fixe ne tient par rapport au défilé d’une série numérique. Il y a alors dérision de la référence.
C’est un peu ce qui nous est décrit avec les descendants de Caïn dans la Genèse où il apparaît que les activités, qu’elles soient artistiques, scientifiques ou techniques, sont présentées comme des palliatifs dangereux à un deuil antérieur. On nous parle d’un descendant de Caïn qui invente la musique, d’un autre qui invente la métallurgie…
Ils détiennent chacun une partie de ce qui est à dire, et qu’est-ce qui est à dire, pourquoi des chiffres, pourquoi des lettres, sinon qu’il y a quelque chose à dire, un message à formuler, mais comme les deux faces sont dissociées, elles tombent chacune d’un côté. On perd le fameux « sentier de rectitude », le sentier droit qui permet de ne pas verser soit dans la fascination pour les symboles, soit dans la déqualification et l’unidimensionnalité.
Il ne reste donc plus qu’à « donner la solution », si l`on peut dire. L’essentiel avant tout est peut-être d’essayer de penser cette disjonction dans sa nécessité, donc de la penser dans les deux sens : Si on est du côté de la quantité et qu’on veuille vraiment avancer, il faut que tout soit relatif, et toujours dans une série numérique, sinon on « bute ». Si on est du côté de la « lettre » au sens ici où je l’oppose au « chiffre », il faut se tenir dans une description d’un objet permanent, irréductible, herméneutique peut-être. Sinon l’écriture poétique qui ne décrirait pas l’essentiel de ce qui est à dire n’aurait rien dit (et il ne faut pas, là, que cela puisse être relativisé).
Si ainsi on dissocie/associe les deux on a alors précisément une créativité.
Tu parlais tout à l’heure de création, on la trouve ici : on aura une créativité scientifique, une créativité artistique. Par là, la réponse à la question qui était « qu’est-ce qui fait le domaine de l’art » peut être : c’est la manière de saisir l’unité de l’essentiel à travers une qualité (de la saisir sous la forme d’une présence ou même éventuellement d’une absence). Créer, en ce sens-là, c’est faire apparaître.
Dans le domaine scientifique, créer n’est pas tant faire apparaître que relier : relier des éléments isolés, les éléments d’une pluralité. Si on réussit à poser ainsi le problème, même dans ces termes très simples, on voit apparaître la solution : il y a une formule talmudique que tu n’as pas citée et qui dit : « De deux choses je choisis toujours la troisième »…
L’unité du discours ne réside précisément que dans un discours qui unirait ensemble, même de manière un peu problématique comme nous le faisons ici, ces deux approches de manière à ce qu’aucune des deux ne soit réductrice et ne se perde elle-même dans cette réduction.
Peut-on maintenant le caractériser ? De quoi s’agit-il, si l’on veut introduire le concept d’un discours « du troisième type » qui ne soit ni exclusivement scientifique ni exclusivement littéraire ? Ce serait le discours qui rapporte les deux modes l’un à l’autre, qui accepte qu’ils soient rigoureusement distingués et qui ensuite ne les amalgame pas, mais les réunit. Comment ? Par une circulation entre eux. Comment accéder à un point de vue permettant de réunir deux démarches aussi opposées, aussi antithétiques.
Comment pourrait-on dire ou écrire quelque chose d’essentiel qui ne soit pas simplement un compte de ce qui est ni l’expression d’une admiration devant ce qui est, ni un bilan ni une extase ?
Si on est dans une approche qui n’est pas phénoménologique et qui n’est pas scientifique, on est peut-être alors dans une approche pragmatique, ce qui amène cette question : quel serait le fondement d’une démarche pragmatique dans le discours et dans l’écriture ?
Nous connaissons la démarche pragmatique pratique dans la vie ordinaire où l’on ne fait pas de science et pas d’art non plus, où l’on tombe dans la platitude et où l’on vit sur des acquis et sur une lente ruine de ces acquis. Qu’est-ce qui permettrait de renouveler cette dimension intermédiaire ?
Sous sa forme maudite, c’est Jabaal, le premier nomade, descendant de Caïn, l’homme moyen insatisfaisant.
Cette dimension du milieu doit s’originer dans l’unité même de l’objet qui va être ensuite traité de manière soit scientifique, soit artistique. C’est donc une écriture de la dénomination, et c’est un peu délicat. Ce serait l’idée de partir d’une manière de nommer les choses qui soit telle qu’ensuite et secondairement les potentialités créatrices de l’objet soient préservées : ce serait d’être en quelque sorte en amont de la distinction entre activité scientifique et activité artistique sans être pour autant dans la trivialité ou dans la confusion.
Cela exige un certain niveau d’abstraction, un peu comme une écriture primordiale, non au sens temporel, mais au sens où on associerait le nombre et l’image. Alors comment pourrait-on ainsi intégrer une approche exacte des choses à une approche mystique sans que ce soit une confusion, mais au contraire une dualité organique ?
Il faut que ce soit un langage qui renverse les habitudes et qui parle des actes de manière concrète et de la « poésie » de manière abstraite. Il faut qu’il y ait cette sorte de croisement.
Ordinairement l’essentiel s’évoque par des images et ce qui est contingent fait l’objet de mesures : ce que l’on connaît le mieux est donc ce qui est le moins important pour nous.
Ce discours « ontologique » serait que ce qui est pour nous la réalité intime des choses soit visé par une pensée rigoureuse et non par des symboles, pensée rigoureuse donc articulée de manière formelle, Jean Zacklad parlait de topologie formelle, et que l’apparence puisse être dite de manière dense c’est-à-dire par une reconnaissance concrète des situations. Je décris là le langage biblique.
Mon hypothèse ici est que le langage biblique, celui bien sûr qu’on rencontre dans la Bible, est un langage : il excède le texte biblique proprement dit. Il l’excède à travers les commentaires, à travers le Talmud, mais aussi à travers ce qu’il y a de biblique dans la parole même des gens, dans cette part du discours qui n’est justement ni scientifique, ni littéraire, ni triviale, qui est prophétique si l’on veut et essentielle même dans des choses simples et qui saisit le « milieu ».
Une phrase du Zohar dit que prendre le texte biblique pour de l’histoire c’est comme le prendre pour de la poésie : or ce n’est ni de la poésie ni de l’histoire. Jean Zacklad en disait « Plus que du mythe et moins que de l’histoire », c’est-à-dire qu’il s’agit de nommer d’une certaine façon, cette façon étant celle qui à la fois en fait le décompte et les rapporte en même temps à l’enjeu essentiel, au référent. Discours qu’on pourrait prendre pour poétique s’il ne visait pas à l’exactitude et pour exact et historique s’il ne visait pas à mettre en rapport l’événement et l’enjeu. Est-ce possible ?
Ce n’est jamais tout ã fait possible et par conséquent cela suppose une espèce de dialogue entre les deux dimensions.
Qu’est-ce qui fait qu’un texte est dit « canonique » dans la Bible ?
C’est précisément le fait qu’il répond à ces trois dimensions : scientifique, artistique, pragmatique. Si on veut avoir affaire à un texte « biblique », il est immédiatement tripartite. Pourquoi ?
Parce qu’il y a forcément une partie, ici c’est la Torah, le Pentateuque, les cinq livres de Moïse, qui est cet effort de nomination antérieur à la distinction entre les vœux et les rêves d’une part et les événements d’autre part.
C’est peut-être simplement le côté des initiatives : quand on dit Bereshit, « au commencement », est-ce de la poésie, est-ce de l’histoire ?
Non, c’est simplement une espèce de diction pure de l’initiative. Que ce soit l’initiative individuelle, collective, sacerdotale, etc. — il y a cinq livres.
Comment cela va-t-il être ensuite repris ? Cela suppose que cette première partie de la Bible se reflète dans les deux suivantes qui sont, elles, nettement plus unilatérales.
Qu`est-ce que la partie des Nevihims ?
On en parle comme étant les livres prophétiques, c’est-à-dire comme d’un appel, ce sont les gens eux-mêmes qui parlent, qui ont des visions. Cette deuxième partie a une valeur beaucoup plus poétique qu’historique : le point de vue est que les prophètes invoquent ce qui est en jeu dans la Torah pour l’invoquer dans la réalité historique.
Les gens reçoivent donc le texte comme un appel, un message d’un destinateur à un destinataire.
Et il y a cette troisième partie qu’on appelle les Écrits et dans laquelle se trouve par exemple le Livre des Chroniques, et plus on va vers la fin de la troisième partie de la Bible, plus on va vers des textes qui sont des recensions chronologiques et qui sont en quelque sorte la réponse de la bergère au berger : de même qu’il y a un temps pour que les prophètes appellent à ce que la vie des gens implique la réalisation de l’Alliance, de cet engagement, de même il y a de l’autre côté le rappel des gestes par lequel cet appel a été repris.
On appelle et on répond, comme en responsabilité, de telle sorte que les Prophètes et les Écrits se renvoient mutuellement la balle et que c’est dans la circulation entre les deux qu’on retrouve comme un double écho de l’initiative originaire.
Et cet écho constitue l’unité, de telle sorte qu’on voit ensuite, si on regarde de près, à l’intérieur même maintenant de chaque texte, le discours de dénomination se fait par un aller-retour de plus en plus intériorisé au fur et à mesure que l’on remonte au commencement, si on inverse la flèche : on va vers l’intériorisation de cette dualité.
D’un côté agir est répondre à un appel et de l’autre appeler est répondre à un engagement.
On aura toujours et parfois dans le même verset un élan, un appel et une réponse ; la réponse renvoie à l’appel et l’appel à la réponse de telle sorte qu’on saute d’un pied sur l’autre et qu’on évite donc à chaque instant de tomber dans un discours qui serait, soit du côté du chiffre, recensement, énumération anonyme, soit du côté de la lettre, évocation de fantômes, de noms propres qui serait paralysante.
De telle sorte que l’on a la formule classique dans la tradition, qui sera ma conclusion : « Sefer Sfar Sippour » : il y a le livre, le Sefer, qui d’une certaine manière est clos sur lui-même : ce dont on nous parle c’est d’un Nom propre, d’une série de noms propres, mais qui comme tels sont en dehors de la temporalité de l’existence. Lorsqu’il s’agit de recenser ce qu`il en est de la dispersion de l’existence, c’est une série de repères, un Sfar ; un compte (c’est le mot qui a donné « chiffre » en français). Soit c’est le chiffre d’un nom propre et comme tel irréductible au cheminement de l’existence, soit c’est une série numérique qui devient alors anonyme.
Et si enfin c’est l’un rapporté à l’autre, c’est un Sippour, c’est-à-dire, et c’est là qu’on rejoint Philippe et Kafka, un récit. Cela nous éclaire sur ce qu’est un récit : ce n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait supposer, littéraire ou artistique. Nous savons bien aussi que, comme le disait Jean Zacklad, le roman n’est pas un genre littéraire en un sens parce qu’y est en jeu quelque chose qui n’est pas uniquement esthétique. En même temps un récit est dramatique et par conséquent non réductible à la simple description. Ainsi sur le plan du texte le récit est une halakha, disait Jean-Michel, c’est-à-dire une démarche pragmatique, halakha signifie « marche à pied », qui permet de récupérer chemin faisant ce qui est de l’ordre de la science et de celui de la qualité.
Philippe JAWORSKI. Il y a une longue histoire complexe et passionnante des rapports entre le chiffre et la lettre dans l’histoire littéraire et en fait la lettre des écrivains, des poètes, est de manière continue hantée par le chiffre. Il y a une hantise du chiffre dans la littérature. Un des exemples le plus clairs en est Mallarmé. Mais cela ne date pas de l’époque moderne, cette latence, cette fascination latente du chiffre par la lettre, une présence. À l’autre bout de l’éventail, nous avons tous eu entre les mains des exemples de lectures ésotériques de textes qui font appel à une méthode qui voit dans la lettre un camouflage du chiffre et ramène le texte à un message chiffré, des 3, des 7, des 9, etc., on connaît ce symbolisme universel des chiffres, qui prétend décoder du chiffre derrière la lettre et qu’il y a un message derrière la lettre auquel on ne pourrait accéder que par certains processus très complexes, souvent très arbitraires d’ailleurs, de transposition.
Claude BIRMAN. On peut poser la question suivante sur cet extrait choisi de Kafka : est-ce une vision ou un récit ? Il en a vraiment les deux aspects. L’astuce semble que cela paraît être un récit et qu`en réalité c’est une image. En cela c’est de la littérature et non pas un discours pragmatique. Il met en place la structure du récit, mais ne le développe pas. En ce sens il y a une ironie : c’est une fiction de récit ; en réalité c’est contemplatif, non narratif.
RAQUEL. C’est beaucoup plus, c’est même angoissant. Comme un tableau où tout est figé.
Philippe JAWORSKI. Il n’y a pas de pragmatique, mais il y a tout de même ce qui serait peut-être l’équivalent de la pragmatique pour ce qui est de l’effet du texte et peut-être en cela son effet maximal (que peut la littérature est un vieux problème) et qui serait d’amener, par le caractère énigmatique de ce texte et l’effort qu`il exige de son lecteur de mise en relation avec lui, une réflexion, une série énorme d’opérations…
Claude BIRMAN. Tout à fait : c’est une mise en lumière des enjeux, c’est un hymne à la transmission et à son inaccessibilité.
Jean-Michel SALANSKIS. J’ai pourtant l’impression qu’à un certain niveau on ne peut pas nier que ce soit un récit parce qu’il y a transition. On peut voir en situation au début du texte un aoriste. Il y a une temporalisation différente du côté de celui qui envoie le message et du côté de celui qui l’attend, un passage, une rupture très nette dans le texte du passé au présent.
Claude BIRMAN. C’est pour cela que je disais qu’il donne l’apparence du récit, c’est vrai, mais ce récit ramène à la structure. Il y a une fiction de récit au sens où le récit est truqué puisque la situation est donnée.
Francis BAILLY. Ce qui est frappant dans ce qui est ici mis en cause, c’est que ce n’est ni l’émissaire, ni le récepteur, mais la situation intermédiaire. Elle est comme ça, faite d’obstacles qui empêchent. C’est le médium qui manque.
Philippe JAWORSKI. L’élément de contact finit par occuper tout le champ, de sorte qu’on ne parvient jamais à l’autre terme. On ne cesse de parcourir ce qui est de l’ordre du contact, mais qui s’avère au bout du compte ne plus être du tout le contact. Il y a un mouvement presque entropique là-dedans.
Francis BAILLY. C’est cela, il y a une entropie.
Claude BIRMAN. Alors que si je comprends bien ce que tu dis sur ton aoriste, je vois effectivement au début du texte une circularité, tout au contraire. Cela rejoint ce que j’ai dit sur le Sefer. Non seulement le destinateur donne le message, mais le message lui revient, il se le fait répéter par le messager avant de l’envoyer, tout le monde y assiste, les murs sont enlevés, c’est un peu comme l’Assemblée des Saints au Paradis qui sont tous assis en cercle, la parole circule, est reçue et approuvée à la fois par tous ceux qui sont là et par celui qui l’a proférée à qui elle revient. Donc il y a là une circularité parfaite. Ensuite, ce qui provient de cette circularité se perd dans la ligne fractale dont tu parles qui est celle du multiple. Là on peut émettre l’idée que c’est une angoisse, comme disait Raquel.
RAQUEL. Et que je vois comme une spirale descendante, par les escaliers, les portes…
Claude BIRMAN. Angoisse de la transmission et en même temps une ironie. C’est la diction de l’échec de la transmission. En ce sens c’est comme le négatif du texte biblique qui est au contraire une diction de l’effectuation de la transmission.
Philippe JAWORSKI. Est-ce qu’on ne pourrait pas aller plus loin et dire qu’il y a caractérisation, en ce sens que le message vient ici du personnage suprême, de la source de l’autorité, l’empereur de Chine dans la Ville impériale au centre du monde ?
Claude BIRMAN. C’est son père.
Philippe JAWORSKI. Oui, bien sûr, mais il y a aussi autre chose…
Claude BIRMAN. Il y a ce dont le père est le signe.
Philippe JAWORSKI. Oui, absolument. Cette notion d’origine, et peut-être même d’origine absolue.
Claude BIRMAN. C’est la parole.
Jean-Michel SALANSKIS. J’avoue qu’il y a quelque chose que je comprends très mal, c’est que l’obstacle final soit la ville impériale. On a donc là l’impression que la topologie se casse la gueule puisque normalement c’est de là que cela partait, non ?
Claude BIRMAN. Non, puisque le messager était dans le palais.
Philippe JAWORSKI. Oui, c’est le reste de la ville qui fait l’obstacle.
Claude BIRMAN. C’est l’image biblique du Temple au sommet de la colline, les Lévites sur la colline en dessous du Temple et le peuple en bas et autour de la colline, sauf que là il replie l’une sur l’autre l’image du Temple et celle du palais, puisqu’il s’agit ici de l’empereur-dieu en un sens.
Jean-Michel SALANSKIS. Mais cette Ville qui est le dernier obstacle infranchissable est pourtant sur la trajectoire vers le destinataire. Et elle est aussi qualifiée comme le vrai centre, comme une hyperbole, « ce centre du monde qui s’est élevé en recevant du monde toutes ses alluvions ».
Claude BIRMAN. « Monde » ici s`oppose peut-être à « palais ».
Jean-Michel SALANSKIS. Si le point d’émission n’est pas le centre, le vrai centre est-il au milieu ?
Claude BIRMAN. Le point d’émission ici est la mort, le lit de mort de l’empereur. Ce lit de mort ne peut pas être au centre puisque le monde c’est la vie. Il est donc excentré, il est antérieur, dans l’antériorité.
Francis BAILLY. Il est sur une éminence. Des escaliers en descendent sans arrêt.
Claude BIRMAN. Il « touche au ciel ».
Francis BAILLY. Exactement.
Claude BIRMAN. Et le « centre du monde » est en même temps le centre de la Terre. Évidemment c’est la terre qui fait obstacle.
Gérard COHEN-SOLAL. En vous écoutant, je rejoins ce que tu as dit : ce récit est une image, chacun y met ce qu’il y voit, une interprétation ni plus juste ni plus fausse que ce qu’il voit, exactement comme on est amené à parler devant une œuvre d’art et en ce sens-là il est radicalement distinct d’un texte biblique qui, lui, impose un cheminement rigoureux par le biais des différentes interprétations, des différentes logiques internes, etc. Il n’y a pas moyen d’avoir le même type de débat et de discours sur un texte de la Torah que vous l’avez sur celui de Kafka parce que ce dernier est un donné sur lequel on « brode » et sur lequel je ne crois pas qu`il puisse y avoir une version plus juste, plus vraie qu’une autre. On est en pleine poésie, en pleine émotion, en plein délire en quelque sorte.
Jean-Michel SALANSKIS. J’ai l’impression pourtant qu’il y a quelque chose de précis qu’il faut décrypter.
Claude BIRMAN. C’est très exactement l’effet de ce texte.
Jean-Michel SALANSKIS. Et puis je croirai toujours que le messager finira par arriver !
Gérard COHEN-SOLAL. En d’autres termes, l’angoisse que vous ressentez n’est pas dans le texte…
Claude BIRMAN. Comme Hitchcock, Kafka génère l’angoisse…
Gérard COHEN-SOLAL. Exactement !
Claude BIRMAN. Et par là même il sort du livre… Là où je ne te suis pas en revanche c’est que si le texte permet une interprétation ce n’est pas parce qu’il serait flou, bien au contraire sa réussite vient de ce qu’il est rigoureux…
Gérard COHEN-SOLAL. Il est immobile. C’est pourquoi j’ai repris ce que tu disais sur l’image : c’est un tableau immobile où tout est donné d’emblée. Alors cela devient, sinon un réceptacle, du moins le moyen d’exprimer un certain nombre de choses que suscite en soi un tel spectacle.
Francis BAILLY. J’aimerais qu’on me rappelle la dernière phrase du texte : que dit-elle exactement ? Parce qu’il me semble que le terme allemand originel appelle peut-être un sens particulier…
Jean-Michel SALANSKIS. Dans « Ertraümen », il y a un certain sens d’élaboration.
Francis BAILLY. Exactement. Et je me demande alors si on ne pourrait pas recevoir le sens de la dernière phrase non pas comme « tu appelles — ou tu rêves — le message », mais plutôt « tu ne reçois pas ce message, mais tu l’élabores quand même. » Cela rejoint la remarque de Claude qui disait que « quelque chose » en est passé. Finalement, bien que ce message n’arrive pas tu le produis pour toi-même.
Claude BIRMAN. Là tu touches à l’essentiel, mais comment entendre cela ?
Philippe JAWORSKI. Il est sûr qu’alors la dernière phrase fait basculer totalement le texte, car si on peut lire cela comme une intériorisation complète…
Francis BAILLY. C’est-à-dire « tu fais l’expérience de ce message »…
Philippe JAWORSKI. Tout à fait : « sachant qu`un message t’est destiné, tu te le construis »…
Claude BIRMAN. Mais si le message arrivait, il détruirait l’élaboration du personnage du destinataire. En outre l’émissaire, l’empereur, n’est pas un personnage insignifiant. Il s’agit donc ici d’un message qui ne peut être reçu qu’en détruisant, et tout aussi bien « le monde », cette ville infranchissable, que la construction que s`en fait celui qui l’attend. Il faut que la distance, donc, demeure. C’est à toi de retrouver le message, soit, mais sans tomber dans une autonomie radicale qui serait le piège. En d’autres termes tu le reconstruis précisément parce que tu l’attends. Si tu n’étais pas dans une attitude d’attente, mais dans celle d’une autonomie complète, tu serais dans une rupture de l’écoute et donc dans l’arbitraire. C’est en cela que je disais qu`il s’agit peut-être bien plutôt du sens de l’attente que de l’attente du sens.
Philippe JAWORSKI. Ou des deux, en ce sens que ce texte serait une fable de l’herméneutique littéraire, des enjeux de l’activité de lecture.
Claude BIRMAN. Au fond que signifierait recevoir le message ? II faut bien le deviner ! Je prends l’exemple concret de ce que nos parents attendaient de nous en nous mettant au monde : dans la mesure même où ils pourraient nous l`expliquer, le comprendrait-on ? On ne comprend à vrai dire les mots formant un message qu`en tant qu’on réélabore le tout dans nos termes. Dans le cas précis de cet exemple intervient l’altérité irréductible du temps : nous ne pouvons pas avoir le même projet que nos parents, nous sommes forcés de le réélaborer. Par conséquent on ne peut jamais recevoir tout à fait intégralement ce qui est émis.
Francis BAILLY. On peut faire un pas de plus et dire qu`ici nous n’avons pas de procédures vérificationnistes : il n’y aurait aucun moyen de confronter cette réélaboration du message à une « vérité » du message. Cette vérité peut être postulée en ce que message il y a, mais non en ce que tel contenu du message il y a.
Claude BIRMAN. Si je te comprends bien, l’essentiel serait la correspondance entre l’attente du message qui n’arrive pas et la réélaboration que l’on fait soi-même du message ?
Francis BAILLY. Oui, mais sans qu » il y ait moyen de vérifier une adéquation, d’avoir une procédure qui permette de dire « ce que j’ai réélaboré correspond ou est vrai » relativement au message.
Claude BIRMAN. Je disais que c’était un anti-texte, au sens de l’écart ironique et de l’angoisse qu’il contient à l’égard de la transmission.
Gérard COHEN-SOLAL. Tout cela me fait penser à cette interdiction formelle et terrifiante du face à face avec Dieu…
Francis BAILLY. Si, si, c’est possible, mais on meurt…
Gérard COHEN-SOLAL. C`est-à-dire que la transmission directe ne peut pas s’effectuer. Il y a l’attente d’une transmission directe et pourtant on ne l’aura pas parce que c’est interdit…
Claude BIRMAN. Parce qu’il y a le temps. Cette image que tu as d’un face-à-face, d’une circularité, d’une interlocution suppose que l’on soit hors du temps. Mais à partir du moment où tu introduis une irréversibilité temporelle cela modifie la conception de l’interlocution : elle est toujours distendue par la succession… à ce moment-là il y aura toujours la nécessité d’une reprise aléatoire. C’est ce qu`on peut entendre par impossibilité de vérification. La reprise est donc à inventer à chaque fois avec l’aléa du risque d’une perte qui en même temps est liberté : c’est cela qu’on nous demande. S’il recevait le message n’en serait-il pas prisonnier dans un certain sens ?
Francis BAILLY. Cela va même plus loin, car il n’y a pas simplement une difficulté à la transmission de ce message : c’est une impossibilité formelle, ce « là où personne ne pénètre même avec le message d’un mort ».
Claude BIRMAN. Jean-Michel disait justement que cet aspect est un passage à la limite qui correspond à une dramatisation, à une angoisse, certainement aussi à une vérité au moment où Kafka dit cela. Car qu’est-ce que cette Ville impériale infranchissable centre du monde ? C’est vraiment le lieu du problème, de la contradiction entre laïcité et tradition, c’est la Weltlichkeit, c’est-à-dire le fait que l’on a tout un monde effectivement moderne, mais parfaitement opaque à la transmission à un moment donné.
Francis BAILLY. C’est pour cela que je vois la dernière phrase plutôt comme une forme d’apaisement par rapport à tout ce qui se passe avant : car on parvient à un paroxysme de l’empêchement, de l’impossibilité, qui n’empêche pas que tu sois pourtant là, assis paisible à ta fenêtre le soir… eh bien finalement tu l’élabores, ton message… quand vient le soir…
RAQUEL. Est-ce que cela ne peut pas être rapporté à l’enseignement de l’Ange donné à l’enfant dans le ventre de la mère et qui est oublié au moment de la naissance ? Et qu’au fur et à mesure de la vie, on retrouve ?
Claude BIRMAN. Le doigt de l’Ange… Mais ce texte ne laisse pas la porte ouverte de cette manière, sans non plus le dire autrement. La structure reste justement au-delà de toute interprétation : la structure est bien qu’il y a cette distance entre le vieux qui meurt et qui a à dire et le jeune à sa fenêtre qui attend, le père et le fils…
Gérard COHEN-SOLAL. Apparemment l’attente du message devient urgente pour Kafka au soir de sa vie alors que lui-même est aux portes de la mort. Cette attente assis à la fenêtre c’est comme la vie qui s’écoule devant quelqu’un qui n’y prend pas part, qui n’y connaît rien, qui ne peut pas agir et puis le soir là, quand il se pose des questions avant de partir, il dit « le message, où est le message » l’on appelle ça aussi la recherche de ses racines…
Francis BAILLY. Je voudrais faire une remarque sur cette incise de Jean-Michel qui mettait l’accent sur la destination : il y a, tout à fait au début du texte, une restriction : l’empereur « dit-on » t’a envoyé… etc.
Jean-Michel SALANSKIS. Oui, mais tu sais sur quoi porte cette restriction ? C’est que ce n’est peut-être pas pour toi…
Francis BAILLY. Ah, ah, ah !
Jean-Michel SALANSKIS. Ça, c’est le pire ! Mais tu as raison d’évoquer cette restriction. Effectivement il me paraissait choquant d’être évidemment sûr que le message soit pour ce type-là et pas un autre…
Francis BAILLY. Mais « dit-on », « dit-on » : c’est finalement grâce à ce « dit » que tu es au courant et que tu es en attente…
Jean-Michel SALANSKIS. C’est sur la foi de ce « dit-on » que tu te permets d’être en attente ?
Francis BAILLY. Eh bien oui. Donc il y a quand même ici une forme d’interlocution, fût-elle anonyme…
Jean-Michel SALANSKIS. Mais alors qui, « on » ?
Francis BAILLY. Voilà, exactement, qui est « on » ?
Jean-Michel SALANSKIS. « On » peut dire que c’est la tradition qui est là, sous la forme de ce discours impersonnel. Et c’est pour cela que tu ne peux pas en fait être certain du rapport de destination puisqu’il est lui-même rapporté ! Le fait que tu sois destinataire est toujours quelque chose que raconte un récit.
Francis BAILLY. Oui, mais là où il y a destination universelle possible il ne saurait y avoir ambiguïté puisque tu appartiens à l’ensemble des universels à qui c’est destiné.
Jean-Michel SALANSKIS. Mais là le récit rapporte que c’est à « toi »…
Francis BAILLY. … que c’est à toi en particulier, d’accord… mais « Dit-On — Nom propre — t’a envoyé » n’est pas équivalent à « à toi en particulier l’Empereur t’a envoyé, dit-on »…
Jean-Michel SALANSKIS. Le récit rapporte pourtant une destination singulière.
Francis BAILLY. Est-ce que ces questions sont susceptibles de se poser relativement à des écritures qui ne sont pas alphabétiques ? C’est-à-dire des écritures de type idéographique telles qu’utilisées en Extrême-Orient ? On a l’impression que ce rapport chiffre-lettre est tout de même lié à une forme arbitraire du signe et que c’est là où l’on peut articuler des lettres que l’on peut avoir cette problématique. En revanche là où il y a une sorte de présence du référent à son signe, comme dans le cas des idéogrammes, on peut se poser la question de savoir si alors ce rapport est nécessaire…
RAQUEL. Dans le cas d’une formule cabalistique juste, une vraie formule cabalistique, parlerais-tu alors d’arbitraire du chiffre ?
Francis BAILLY. On peut composer une formule cabalistique à partir d’idéogrammes : Claude évoquait la divination par exemple. L’Extrême-Orient ici aura recours à des tiges d’achillée ou des pièces de monnaie, mais il n’a pas ce recours à la lettre qui permettrait d’élaborer un système de divination avec des lettres ; il est obligé de créer des trigrammes…
Danielle BAILLY. Il y aurait donc recours à un système délibérément polysémique ?
Francis BAILLY. Oui, je pense que l’effort d’abstraction que cela implique…
Danielle BAILLY. Introduit un mystère, une épaisseur…
Francis BAILLY. Exactement. Cela crée une distance suffisante pour que quelque chose vienne s’y loger. Le passage d’une représentation idéographique à une représentation alphabétique, grâce à l’arbitraire, grâce à la forme de ce qu’on appellera plus tard un système symbolique, crée un lieu qu’on peut investir de systèmes d’interprétations, de significations, d’alo0rithmes…
Danielle BAILLY. Et de malentendus aussi ou d’incommunicabilité…
Francis BAILLY. Oui, bien sûr, mais avant tout cela crée de l’espace là où il n’y en avait pas et dans cet espace il y a de la place pour une invention. Alors que là où il y a tendance au rabattement du référent et du système symbolique, cet espace a du mal à exister et l’on ne peut pas développer ce genre de problématique.
Jean-Michel SALANSKIS. Ce que tu dis me paraît tout de même dangereux.
Danielle BAILLY. Tu es optimiste en tout cas en ce qui concerne la création.
Philippe JAWORSKI. Est-ce qu’au fond, dans tout ce qui a été dit au cours de cette journée, il a été répondu, ou que des éléments ont été apportés, à la question que posait initialement Raquel à savoir qui est créateur, quand y a-t-il création ?
Claude BIRMAN. Il apparaît que ce qui a été dégagé en termes de créativité doit être maintenu dans trois domaines et non seulement deux : deux de ces domaines peuvent être vus comme dérivés, l’un scientifique, l’autre artistique. Ces deux créativités apparaissent dérivées d’une troisième qu’elles déploient, plus originaire et bien moins facile à nommer.
Pour Kant ce sera la morale, par exemple lorsqu’il dit que si nous n’étions pas des êtres moraux nous serions dépourvus de sens esthétique bien qu`évidemment le sens esthétique ne rende pas pour autant moral. On l’était avant. Le problème du rapport entre l’art et la morale chez Kant est le même que celui du rapport entre la morale et la connaissance. Si le problème est de savoir si l’art rend moral ou si la science fonde l’éthique, la réponse de Kant est : « Non, c’est la morale qui nous rend connaissants et nous donne le sens esthétique.
Chez Kant la morale signifie le fait d’agir, de prendre des initiatives de nous-mêmes. À partir du moment où l’on agit, ce qui dans la Bible est représenté par le départ d’Abraham, il devient alors possible d’inventer dans différents domaines.
Danielle BAILLY. Et l’unité de la condition humaine se retrouve…
Claude BIRMAN. Oui, l’unité se retrouve précisément dans la circulation entre les hommes.
Francis BAILLY. Cette idée peut être discutable parce que l’histoire montre bien qu’il y a des situations où cette condition n’est absolument pas nécessaire : on a vu des comportements non moraux, non éthiques, cohabiter chez certains avec des comportements créatifs.
Claude BIRMAN. Ce qu’exprime l’histoire des descendants de Caïn, en tant qu`ici cette activité créatrice sectorielle, dérivée, subsiste même lorsque sa cause originaire a disparu.
Francis BAILLY. Cela rejoint ce que je dis : elle n’est pas nécessaire.
Claude BIRMAN. Elle est originaire.
Francis BAILLY. Entre l’originarité qui a permis quelque chose et le fait que cela continue à opérer comme originarité dans le processus lui-même, il y a un découplage et ce problème-là est difficile à traiter. On peut admettre d’un point de vue formel le fait qu’il y ait une originarité dans l’aspect éthique et moral, mais le fait que cela puisse ne plus opérer et que néanmoins il subsiste une créativité qui s`exprime et qui opère pose une difficulté.
Claude BIRMAN. Cette originarité en fait est sans cesse à réactiver : sa réactivation réunifie le projet humain.
Francis BAILLY. Mais l’on peut parfaitement avoir des créations artistiques et scientifiques coupées de cela…
Danielle BAILLY. Cela ne va nulle part…
Claude BIRMAN. Dans le domaine où œuvre Francis, cela avance très bien au contraire, mais effectivement de manière découplée du sens…
Francis BAILLY. Tu introduis donc un élément de jugement de valeur qui recouple les comportements éthiques ou non éthiques à la créativité alors qu’il n’apparaît pas nécessaire pour traiter de la créativité dans l’instant d’introduire ce jugement de valeur.
Claude BIRMAN. “Les ongles poussent après la mort”…
Francis BAILLY. Oui, par exemple.
Claude BIRMAN. Cet extrait de la première préface à la “Critique” dit le fait que s’il y a une science sans fondement elle continue un certain temps…
Francis BAILLY. Mais là ce n’est pas la science en l’occurrence qui est sans fondement au sens scientifique du terme…
Claude BIRMAN. Non, il s’agit du fondement moral.
Francis BAILLY. Il y a tout de même une difficulté politique ici du fait qu’il peut y avoir des acquis culturels dans des situations où ce que l’on considère comme une condition nécessaire à ce que la création soit possible n’est pas réuni, chez un individu ou dans des groupes. Et pourtant néanmoins il y aura cette opération créatrice. Donc ou bien on s’en réfère à quelque chose qui est intemporel, anhistorique, disant que cela opère par sa fécondité propre et à ce moment-là cela n’est pas politiquement opératoire, ou bien on dit qu’il faut trouver ce qui fait que, bien qu’il y ait condamnation politique à émettre, il y a néanmoins authentification culturelle à apporter sur tel point. C’est donc une disjonction. Et cette disjonction-là pose tout de même un problème énorme…
Claude BIRMAN. Je n’ai pas bien suivi la fin du deuxième point et ce terme de disjonction…
Francis BAILLY. Le deuxième point entraîne qu’on est bien obligé, devant une œuvre qui est acceptable, qui est vraie, de dire “elle est vraie” même si les auteurs ne répondent pas aux canons éthiques, ce qui induit que ce couplage n’apparaît pas nécessaire.
Gérard COHEN-SOLAL. Tu parles de cette exactitude comme s’appliquant à une œuvre d’art comme à l’œuvre scientifique. Je suis surpris qu`on puisse mettre en avant des notions de morale ou d’éthique dans l’art bien que dans certaines philosophies il y ait confusion entre le “bon” et le “beau”. Je crois que l’artiste dans son travail créateur ne fonctionne pas sur des bases morales ou éthiques, comme le scientifique.
RAQUEL. Ce ne sont pas des “bases”, puisqu’il s’agit du même : c’est le même qui fait tout ce qu’il fait, qui crée, pense et agit à partir de lui-même. Ce qu`il fait est une expression de lui-même.
Francis BAILLY. Hélas non, justement ! Ce serait trop simple. Il n’y a de problème politique que justement parce que cela ne marche pas comme ça. S’il y avait adéquation entre les deux, il n’y aurait pas de problème politique.
Danielle BAILLY. Mais Raquel a bien restreint le cadre de la communication qui l’intéressait : elle a dit un certain type d’exigence dans certains types de création ; et qu’ensuite il faut que cette création serve de moyen de pénétration vers d’autres créations. Elle a donc tout de même établi un clivage : il ne s’agit pas de n’importe quelle création qui suivrait sa logique indépendamment de toute éthique. Elle a défini un certain nombre de conditions selon lesquelles cette création sert à quelque chose dans un projet général.
Gérard COHEN-SOLAL. Elle a donc pris la création dans le cadre d’un projet. Il s’agit là de la mise en œuvre d’un projet et non du cadre habituel du travail créatif…
RAQUEL. Tout dépend du sens que chacun donne à son travail !
Claude BIRMAN. Si je rappelle le problème, nous cherchons l’énigme du rapport entre le chiffre et la lettre, en fait l’énigme de leur unification. Pour unifier les deux, il faut se resituer à partir de leur fondement commun, reprendre la position originaire et à partir de là ramasser ses billes. Car finalement ce qui se produit dans les différents domaines d’expression, de manière dérivée, je suis d’accord qu’il y a une coupure entre l’origine et le dérivé, c’est tout de même bien un dérivé de l’origine. Donc si on reprend le chemin de l’origine, on récupère. Concrètement, comment a été rédigé le texte biblique ? À partir de pièces et de morceaux : dc mythes égyptiens, babyloniens, de morceaux de géométrie retournés ironiquement, pour l’Arche de Noé, par exemple. Il y a tout un travail de neutralisation que Jean Zacklad a fait : on a des fécondités dérivées, voire à la dérive, que l`on va rapporter les unes aux autres et dont on va alimenter le discours. Il se trouvera bien sûr des gens pour dire “Mais finalement dans la Bible il n’y a rien d’hébreu” et cela devient de la dérision, l’hébreu n’étant alors plus autre chose qu`un retravail des productions. Au fur et à mesure que les productions surgissent dans cette dimension de la séparation où nous sommes, elles contribuent à détruire ce que tu appelles le cosmos politique. Par conséquent le geste de réinvention de l’origine est à chaque fois une espèce de retournement des acquis pour les unifier, les ramener au centre et à ce que cela puisse servir à tenir un discours sensé et orienté.
Francis BAILLY. Je suis tout à fait d’accord sur cette perspective, il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. Mais j’appelle politique au sens large la question de ce désaccord qu’il y a entre cette positivité du retournement et du remembrement d’une part et toute la connotation, et même plus, tous les faits négatifs d’autre part. Et là, il y a conflit.
Claude BIRMAN. Il y aurait donc une immoralité ou une amoralité de la création dans la mesure où qu’est-ce qui fait l’immoralité, sinon la séparation et le fait qu’une invention ne soit pas reliée au tout du projet humain. Et que la conversion amène à rapatrier.
Francis BAILLY. Cela donc prouve bien qu’il y a capacité d’invention bien qu » elle ne soit pas rapportée au tout. Je mets simplement ce point en évidence.
Claude BIRMAN. Et ceci n’est logique que s`il y a unité créatrice à l’origine.
Royaumont, le 11 octobre 1992
Enregistrement retranscrit par Anne Verner.
avec la participation de
Francis Bailly, physicien, chercheur au CNRS – Danielle Bailly, professeur – Claude Birman, agrégé de philosophie – Gérard Cohen-Solal, physicien, chercheur au CNRS – Philippe Gumplowicz, écrivain, musicologue – Philippe Jaworski, traducteur, écrivain – Raquel Levy, peintre – Youval Micenmacher, musicien – Anne Portugal, poète – Jean-Michel Salanskis, mathématicien.
NOTES
Publiées par Raquel Levy
avec le concours de la Fondation Royaumont
52, av. Pierre Brossolette 92240 Malakoff - Tel. 45 01 75 44
Création, Mise en page - Sylvain Gabbay - INTÉGRALE INFOGRAPHIE
24. rue de I'abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 45 44 0I 45
–––––––––––––––––––– PUBLIÉES PAR RAQUEL LEVY ––––––––––––––––––––
Mars 1996 – No 6_________ _________ 50 F
La littérature est, comme l’écrit Jacques Julliard, « un champ d’activité
qui, par construction, s’affranchit des règles de la morale ». Et il n’y a pas loin de la morale
à l’ordre moral, dont le « politically correct » donne la version contemporaine. Mais faut-il pour
autant se satisfaire de la « disjonction » communément admise entre l’artiste et son œuvre,
qui permet de trouver acceptable, voire naturel, qu’un homme mauvais puisse être un artiste
génial ? N’est-on pas fondé à retrouver dans le « dedans de l’œuvre » — le style, la technique
de l’artiste — les effets d’une éthique défaillante ?
Telles sont les questions abordées dans une discussion ouverte par Marcel Cohen,
écrivain, le 8 janvier 1995, à Malakoff. Y participaient : Danièle Bailly, professeur de linguistique,
Francis Bailly, physicien, chercheur au CNRS,Claude Birman, philosophe,
Gérard Calliet, ingénieur informaticien, Gérard Cohen-Solal, physicien, chercheur au CNRS,
Philippe Gumplowicz, musicologue, Emmanuel Hocquard, écrivain,
Philippe Jaworski, professeur de littérature américaine, traducteur, écrivain,
Raquel Levy peintre, Jean-Yves Rondière, cinéaste,
Éliane Schemla, maître de requête au Conseil d’État.
L’ARTISTE, L’ŒUVRE, LA MORALE
Marcel COHEN : La publication en Israël de Voyage au bout de la nuit m’a amené à braver le ridicule d’un sujet aussi vaste et à le proposer à Raquel. Les violentes réactions qui se sont fait jour en Israël me paraissent d’autant plus remarquables qu’il n’existait aucune censure à l’égard de Céline, mais bien un consensus, de la part des traducteurs comme des éditeurs, pour ne pas le publier. En d’autres termes, une majorité d’intellectuels estimait que, face à une œuvre, les critères d’ordre éthique devaient avoir le pas sur les qualités esthétiques, celles-ci fussent-elles incontestables. C’est exactement ce que Zeev Sternell, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem et membre de la gauche israélienne, reprocha à la traductrice. « En choisissant le critère esthétique, vous vous rendez la vie plus facile », déclara-t-il. Mais derrière cette question, somme toute assez simple puisqu’il s’agit, pour chacun, de savoir s’il veut, ou ne veut pas, lire une œuvre compte tenu de ce qu’il sait de l’auteur, s’en profile une seconde qui est un petit peu plus subtile tout en étant son corollaire : peut-on et doit-on dissocier l’auteur de l’œuvre ? Et une troisième : peut-on être le grand écrivain qu’est censé être Céline et, en même temps, le salopard qu’il fut ?
Tout le monde semble persuadé qu’un grand écrivain est quelqu’un « d’un peu mieux » que les autres sur le plan éthique. En tout cas, c’est une idée qui court abondamment et je me suis contenté de relever quelques citations montrant cette conviction. Cela nous amène à nous demander ce que l`on entend par éthique : est-ce le prolongement de la morale ? Y a-t-il une opposition entre les deux termes ?
Voici ce que Proust écrit à propos de la mort de Bergotte au Palais du Luxembourg, où était exposée la Vue de Delft de Vermeer. « Il était mort. Mort à jamais, qui peut le dire ? Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n’apportent de preuves que l’âme subsiste. Ce qu’on peut dire. C’est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le faix d’obligations contractées dans une vie antérieure ; il n’y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicat, même à être poli, ni pour l’artiste athée à ce qu’il se croie obligé de recommencer vingt fois un morceau dont l’admiration qu’il excitera importera peu à son corps, mangé par les vers comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste å jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations, qui n’ont pas leur sanction dans la vie présente, semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci, et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d’y retourner revivre sous l’empire de ses lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous en portions l’enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracées — ces lois dont tout travail profond de l’intelligence nous rapproche et qui sont invisibles seulement — et encore ! pour les sots. De sorte que l’idée que Bergotte n’était pas mort à jamais est sans invraisemblance » (Roger Laporte fait remarquer, dans un très beau texte où il commente ce passage, que Proust ne dit pas que c’est vraisemblable, il dit que c’est sans invraisemblance.) « On l’enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes déployées et semblaient pour celui qui n’était plus le symbole de sa résurrection. »
Si, au-delà du problème de Céline, nous pouvons nous poser le problème de la qualité d’une écriture, ou d’une composition musicale, en l’envisageant sur un plan éthique et non plus seulement esthétique, c’est parce que nous avons eu de grands devanciers, je pense notamment à Théodore W. Adorno (« Essai sur Wagner », trad. franç. 1962, Gallimard), et bien sûr à Nieztsche sur le même sujet.
Voici ce que dit Proust dans un autre passage :
« Peut-être est-ce plutôt â la qualité du langage qu’au genre d’esthétique qu’on peut juger du degré auquel était porté le travail intellectuel et moral. »
Et ceci, célèbre, de Kafka :
« Quelquefois, il me semble que l’essence de l’art, l’existence de l’art, ne s’explique que par une telle considération stratégique : pour rendre possible une parole vraie d’homme à homme. »
Edgar Poe :
« Non seulement j’estime qu’il est paradoxal de dire d’un homme de génie qu’il est ignoble en tant qu’individu, mais j’affirme sans hésitation que le génie le plus haut n’est rien que la noblesse morale la plus élevée. »
Erich Fried :
« C’est un combat (l’écriture) qui doit nous être entré dans le sang, qui doit nous avoir pénétrés jusqu’au bout des ongles, ce qui veut dire que le travail essentiel et décisif doit toujours être le travail essentiel et décisif sur soi avant même de s’asseoir à sa table de travail. Celui qui, de lui-même, ne prend pas véritablement part aux choses, qui n’a pas, surtout, combattu en lui-même les choses creuses, les poncifs, les réconforts trop faciles, et qui ne continue pas à les combattre sans relâche, ne peut jamais rien écrire de bien, sinon, au mieux, des choses bien intentionnées. »
Montherlant, dans un hommage à Charles Péguy :
« Péguy illustre en plein pour moi le mot d’André Suarès : “Il n’y a pas de grands écrivains, il n’y a que de grands hommes.”
Mot que j’entends ainsi : Il n’y a pas d’écrivain où il n’y a pas un homme. »
Francis Ponge :
« Je suis un moraliste, en ce sens que je veux que mon texte [...] soit une loi morale, [...] et seule une formule verbale, c’est-à-dire abstraite au maximum, mais concrète å la fois, parce utilisant l’alphabet, la syntaxe, le mode d’écriture et la langue commune à notre espèce et à notre époque, les révolutionne pourtant. Je veux être un moraliste révolutionnaire. »
Hermann Broch :
« Le système du “tape-à-l’œil” exige de ses partisans : “fais du beau travail”. Alors que le système de l’art a pris pour maxime le commandement éthique : “fais du bon travail”. Le “tape-à-l’œil”, c’est le mal dans le système des valeurs de l’art. » Hermann Broch ne s’en tient pas à cette considération générale sur le « tape-à-l’œil » (ou le « kitsch »), il tente de le définir : « Dans l’art “tape-à-l’œil”, les moyens d’obtenir l’effet sont toujours éprouvés. L’essence du “tape-à-l’œil”, c’est la confusion de la catégorie éthique et de la catégorie esthétique. »
Hermann Broch va loin, l’apothéose de l’art « tape-à-l’œil » étant, pour lui, l’incendie de Rome par Néron, pendant que celui-ci joue de la lyre sur sa terrasse :
« Celui qui travaille pour le bel effet, celui qui cherche seulement cette satisfaction affective, ce relâchement momentané de son oppression que lui procure la beauté, en un mot, l’esthète radical, aura le droit d’utiliser et utilisera tout moyen sans aucune retenue pour parvenir à cette beauté. »
Léonard de Vinci :
« La bonne littérature a pour auteurs des hommes doués de probité naturelle. Et, comme il convient de louer plutôt l’entreprise que le résultat, tu devrais accorder de plus grandes louanges à l’homme probe peu habile aux lettres qu’à un qui est habile aux lettres, mais dénué de probité. »
Vladimir Jankélévitch :
« C’est en général la disjonction esthétisante des qualités qui est la négation impertinente et désinvolte du sérieux éthique. Et disons plus encore : le vice, c’est la vertu dissociée ou isolée des autres vertus. Peut-être trouvons-nous là l’origine du paradoxe le plus profond de l’école stoïcienne. Celui qui a une vertu les a toutes ; celui qui a toutes les vertus sauf une n’en a aucune. Que dirait-on par exemple d’un homme juste qui ne serait pas courageux ? Ou d’un homme courageux qui ne serait pas sincère ? »
En France, on dit de Céline : « un génie mais un salopard ». Ce « mais » m’apparaît comme une injure personnelle. Le problème pour moi n’est pas de savoir si la personne qui m’envoie à la chambre à gaz a du génie ou seulement du talent.
Je repose la question : est-ce que l’on peut aborder le sujet comme cela ou est-ce ridicule ?
Francis BAILLY : Ce n’est pas ridicule. La pensée de Heidegger est-elle « disjonctible » du terrain politique ? Jean Beaufret a défendu cette position avant de se retrouver dans le camp des négationnistes... Au moment de la montée du nazisme, un mathématicien estimé par ses pairs, et qui avait démontré des théorèmes, s’est engagé dans la S.S. Quel rapport y a-t-il entre cette œuvre dont les mathématiques ne peuvent se passer et sa position « éthique » ? S’il devait exister d’emblée un accord entre la probité et l’habileté, comme disait Léonard de Vinci, ce mathématicien n’aurait pas dû prendre cette position. Manque éthique vertigineux, résultat créatif extraordinaire. Même problème avec les physiciens allemands. Cette situation conduit à se poser la question : y a-t-il un caractère éthique inhérent à une œuvre ?
Marcel COHEN : L’esthétique serait sans rapport avec l’engagement politique ? L’antisémitisme est aussi une maladie de la pensée, une atteinte à l’intelligence. Adorno dit que les effets produits par la musique de Wagner sont nocifs car ils exaltent la régression. Peut-on analyser Céline comme Adorno le fit avec Wagner ? Son écriture n’est-elle pas le comble de l’écriture « tape-à-l’œil » fabriquée en vue d’un effet ?
Philippe JAWORSKI : La question autour de laquelle Raquel nous a réunis est immense. Dans l’histoire de la production littéraire, on aurait beaucoup de mal à trouver un texte sans clichés antisémites. Chez les plus grands, les plus subversifs, ceux qui ont pris le parti des marginaux, des opprimés, des exploités, de la femme, de l’enfant, de l’esclave, le stéréotype est là.
Marcel COHEN : Nietzsche s’est intéressé en profondeur à la musique de Wagner. Adorno, également musicologue, arrive à la conclusion que les effets que produisent la musique de Wagner sont nocifs. Nous rejoignons l’idée du style « tape-à-l’œil ». Certains effets sont nocifs parce qu’ils exaltent quelque chose qui est de l’ordre de la régression. Est-ce que l’on a les moyens intellectuels et la volonté éthique d’analyser aujourd’hui les œuvres comme Nietzsche le faisait pour la musique de Wagner ?
Philippe GUMPLOWICZ : Après avoir été un fan de Wagner, Nietzsche a fini par lui préférer Bizet. Pourquoi ? Bizet était léger, Wagner pesait. Trop d’idées.
Vous en appelez à un « pot commun » entre éthique et probité artistique. Un artiste sans éthique ne se contenterait pas d’être un salopard qui écrit des pamphlets antisémites au moment où les Juifs vont à la mort. Il saloperait également son travail, entre autres, par l’usage de poncifs et la recherche de l’effet. En somme, non content de mépriser autrui, il mépriserait son œuvre. Cela sous-entend que le bien et le beau auraient quelque chose en commun, voire qu`ils pourraient bien être une seule et même chose. Cela, les Anciens en étaient convaincus. Une légende veut que dans l’antiquité, les premières musiques notées aient servi de support à des textes de lois civiles ou religieuses. L’idée traverse notre histoire jusqu’au dix-huitième siècle. Un extrait des Lettres patentes, que le roi Charles IX accorda à Jean Antoine de Baïf pour l’établissement d’une académie de musique, la résume : « Là où la musique est désordonnée, là volontiers les mœurs sont dépravées, et là où elle est bien ordonnée, les hommes sont morigénés. » Les chemins se séparent à la naissance d’une discipline nouvelle, l’esthétique, au milieu du dix — huitième siècle. Le beau obéit désormais à des règles propres. Avec le regard que vous portez sur Céline, on fait retour à une vision unitaire. Pourquoi pas ? L’entente, ou même une manière de connivence entre le beau et le bien, peut s’appréhender sur différents plans. Le rêve : l’artiste que je vénère est aussi un grand homme. La demande sociale : artiste et citoyen, dirait-on aujourd’hui. La réflexion esthétique : les rapports qu’entretient le style avec la morale (sur ce point, il y a lieu de craindre que la recherche d’une correspondance entre art et morale, si elle contribue à activer la compréhension d’un auteur, ne donne de piètres résultats en ce qui concerne son œuvre ; toutes proportions gardées, les pas de géant faits par la sociologie de l’art ces vingt dernières années ont éclairé le « contexte » de l’œuvre, peu ou pas l’œuvre proprement dite). Et enfin, le jugement « moral » : ici, terrain glissant. Disqualifier l’homme, disqualifier l’œuvre ? L’ordre moral n’est pas loin... Le « politically correct » a apporté l’autocensure, le bâillon, les excuses en série et la platitude généralisée. Le « moralement correct » continue sur la lancée, avec l’injonction et l’accusation... Au nom de quel projet politique ? Pour quels objectifs ? Pour quels bénéfices ? Il y a eu blessure. Soit. Quelle réparation veut-on ? Dans le Talmud, une réparation a un prix, donc des limites. Or les accusations pour mauvaise conduite déchaînent des procès sans limites. L’injonction morale tue la morale.
Prenons l’exemple qui nous a réunis : l’antisémitisme. Être antisémite est-il un état ? Une identité fixe ? Une position ? Une strate de la conscience ? Il y a ceux (Céline, Pound, Wagner) chez qui le poison était structurant. Et les autres, moins « monomaniaques » dans la haine, antisémites amateurs, en quelque sorte. Des nappes par-ci, des pointes par là... Faut-il ne plus lire Giraudoux, Cioran, Mircea Eliade ? Accompagner toute mention de leur nom d’une mise en garde ? Garder en réserve les textes malsains pour les ressortir, on ne sait jamais ? La chasse à l’antisémitisme devrait être aussi réglementée que n’importe quelle chasse : pas tout le temps, pas sur n’importe qui, pas n’importe où, pas n’importe comment.
Philippe JAWORSKI : L’écrivain voué à l’écriture apparaît à la fin du dix-neuvième siècle. À partir de Flaubert, l’œuvre devient la seule morale de l’artiste, la notion d’éthique n’a de sens que dans l’esthétique, l’artiste n’a de comptes à rendre qu’à sa création. James Joyce pourra dire que la chute d’une feuille et une déclaration de guerre sont une seule et même chose. Par ailleurs, l’histoire fait irruption, et l’artiste est sommé de sortir du huis clos de la création. Le développement des idéologies a joué un rôle considérable là-dedans. C’est entre ces deux pôles que l’on doit réfléchir : l’autonomie du champ de la création et l’ouverture de l’œuvre à l’histoire.
Francis BAILLY : Dans le domaine scientifique, il y a une éthique professionnelle qui n’a pas grand-chose à voir avec l’éthique sociale. Certains qui sont « bien » sur le terrain de l’éthique professionnelle peuvent fort mal se comporter dans le cadre de l’éthique sociale.
Gérard CALLIET : Dans le cas Céline tel que l’aborde Marcel Cohen, la question n’est pas dans le rapport entre le domaine de la création artistique et la morale, mais dans le moment de la création. Il y a deux erreurs à ne pas commettre : faire une distinction entre le bonhomme et l’œuvre, et crier à la collusion entre le bonhomme et l’œuvre.
Marcel COHEN : Mais relit-on les grands romans de Céline à la lueur de ce que nous savons ?
Philippe JAWORSKI : Sur Céline, on sait pratiquement tout. La saloperie du bonhomme commence avec cette mascarade de la guerre de 14 où il se fait passer pour un grand blessé.
Marcel COHEN : L’écrivain est convaincu de l’importance de poser un mot sur la page blanche. Dans les Conversations avec Kafka, Janouch entre dans le bureau de Kafka et lui parle d’un collègue que personne n’aime, et il dit : « Je lui foutrais bien mon poing dans la gueule ». Kafka répond : « Vous ne pouvez pas dire ça, le mot est le premier degré du passage à l’acte et lorsque l’on veut tuer quelqu’un, on commence toujours par le tuer avec des paroles. » Ce n’est pas tant que Céline ait été antisémite qui me gêne, mais le fait qu’il ait pris soin, soir après soir, de l’écrire. Une chose est de s’engueuler autour d’une table, une autre est de prendre la peine de distiller, soir après soir, cette haine par écrit quand on est écrivain.
Claude BIRMAN : Le centre du problème est celui de « l’un » et du « multiple ». Question de foi : soit on ressent l’évidence de cette unité de soi dont parle Jankélévitch, et dès lors que l’on a le moindre doute sur ce que l’on appelle en hébreu la temíma (simplicité, intégrité, intégralité, unité des vertus), lors de la rencontre d’un obstacle, l’on s’arrête. Je repense à ce que dit Francis Ponge : « Que mes textes soient une loi morale. » Évidemment, dès que l’on se prend à écrire, c’est pour écrire la loi morale. Mais à défaut de pouvoir assumer cette intégrité telle quelle, l’on trouvera des coefficients de liberté dans chaque situation, fût-elle « tordue », et l’on pactisera avec un certain nombre de servitudes.
Comment un individu créatif assume-t-il cette liberté originaire qui le constitue comme homme ? En hébreu, on dit que dans le monde on trouve des éclats de lumière. Celui qui se définit par cette unité — par la lumière pure — s’arrête là où elle ne se manifeste pas.
Céline se rendait compte qu’il manifestait par l’écriture qu’il n’y a pas de différence entre la liberté, l’intelligence et la vertu. Mais il le faisait avec une complaisance qui aboutissait à des textes mortifères.
Dans la Bible, il est dit que le premier rêve de liberté est l’assassinat. Un animal n’aurait pas l’idée d’assassiner quelqu’un. C’est simple, mais difficile à dire vite : il faut assumer la part de liberté, de « génialité » d’une invention scientifique ou d’une création artistique. Cette créativité est partielle. Certains savent que s’ils vont au-delà de leurs capacités à affirmer la liberté, ils vont pactiser avec la servitude. Alors, ils s’arrêtent.
D’autres n’arrivent pas à s’arrêter. Un artiste peut avoir des faiblesses à l’égard de son art ou dans la portée éthique de son propos. Il cède ã la complaisance, parce qu’il a cessé de croire à l’unité, à la possibilité d’assumer sa liberté dans tous les domaines de son être.
Alors, il essaye de se sauver par son œuvre. L’œuvre fait l’auteur. Si l’on voulait maintenir cette positivité de manière spinoziste, on dirait que Céline existe dans la mesure où ce qu’il écrit est bon et génial. Mais Céline cède à ce qu’il y a de déshumanisant dans le contexte historique ou psychosociologique. Je vais revenir sur deux citations. Proust et le « monde différent » : un monde différent n’est pas notre monde. Le psaume dit : « Le monde est fondé sur la bonté. » Proust doute que notre monde soit fondé sur la bonté. S’il y a doute, on peut admettre des accommodements. Vous avez cité Montherlant à propos de Suarès : « Il n’y a pas de grands écrivains, il n’y a que de grands hommes. » C’est « cacher » ! Dans quelle mesure un grand homme est-il tout à fait un grand homme ? Quand sa grandeur conquiert tout l’être de son être. Sinon, on arrive à cette monstruosité : des aspects géniaux dans un contexte moche. Ou bien on affirme cette unité, et quand ce n’est plus possible, on s’arrête (l’âme sensible de Rousseau). L’écrivain évite de publier, s’il craint de ne pas être fidèle à la liberté de sa parole. « Caïn parla à son frère. » S’il n’était pas en mesure de faire de sa parole un dialogue, il valait mieux qu’il s’arrête au lieu de parler jusqu’à… le tuer. Ou bien, deuxième cas, on se place en dehors de l’unité : Céline a continué à écrire après la guerre, alors qu’il reniait d’une certaine manière ses pamphlets antisémites, car il s’est dit : c’est un aspect de moi, je pourrais être une simple ordure comme mon voisin, mais j’ai un « petit plus ». Troisième cas, celui qui parviendrait à être intégralement lui-même dans ce qu’il fait, à être libre : c’est le Messie. Certains s`en approchent, ils nous apparaissent comme des hommes justes. Le quatrième cas, le plus commun, correspond à celui qui sait qu’il a en lui quelque chose de génial, mais, ne voulant pas se limiter à ce qu’il est, accepte de se compromettre et développe un ressentiment contre le projet de manifester l’unité sans compromission. Cela explique l’antisémitisme. La haine des Juifs, de la Bible, de la liberté, ont un caractère métaphysique. En premier lieu, c’est le ressentiment envers ceux qui pourraient me reprocher de la « ramener » en n’étant pas juste. Défense préventive, afin que l’on ne me dise pas que je suis un salaud alors que je me présente comme un génie lumineux. Et je tourne ma haine contre ceux qui représentent ce souci d’unité. Ce n’est pas un hasard si Jankélévitch attribue pudiquement aux stoïciens (qui ne s’intéressaient pas à l’esthétique) l’idée de la « disjonction des qualités », autrement dit, le fait que la lumière soit fragmentée en éclats.
L’unité dont il parle est le kibboutz galouyot. Si l’on ne peut affirmer davantage de liberté, on ne cède pas pour autant à la tentation de faire passer la servitude pour de la liberté, parce que si l’on cède à cette compromission, on finit par haïr la liberté. Cela est dans l’esprit de Chestov. On aime la servitude parce que l’on a cédé à la servitude. Cela me paraît s’appliquer à Wagner. Quelque chose de génial, mêlé à un ressentiment contre la vie, contre la liberté. Ce qui fascine dans sa musique, c’est l’immensité du gâchis. Parti dans un projet de liberté, il finit par chanter la mort. Manifestation d’une liberté créatrice, qui n’est pas une divagation erratique, mais l’expression même de la Loi, de la loi de vie, l’art ouvre à un engagement politique sans ambiguïté, il n’y a pas conflit entre l’art et la politique. Le monde réel n’étant pas celui dont parle Proust, il ne faudrait pas en conclure que, quand le monde est malhonnête, l’artiste ne peut pas être honnête.
Jean-Yves RONDIÈRE : Pour reprendre ses termes, il fait son bouquin pour restaurer la beauté du monde.
Claude BIRMAN : Les faiblesses éthiques introduisent des faiblesses esthétiques au cœur de l’œuvre.
Marcel COHEN : Cela me semble un point très important. Je suis content que là-dessus, nous soyons d’accord.
Francis BAILLY : Ce qui me gêne dans la formulation « les faiblesses éthiques introduisent les faiblesses esthétiques au cœur de l’œuvre », c’est la qualification des deuxièmes faiblesses : je ne dirais pas que ces faiblesses sont dans la nature de l’œuvre.
Claude BIRMAN : Est-ce que ton mathématicien a continué à créer une fois qu`il a été dans les S.S. ?
Francis BAILLY : Malheureusement.
Claude BIRMAN : Des étoiles continuent à émettre quand elles ont disparu.
Francis BAILLY : Je conçois mal qu’une œuvre puisse ne pas avoir un caractère universel. De ce point de vue, il y a effectivement faiblesse.
Claude BIRMAN : Une faiblesse n’implique pas que l’œuvre soit disqualifiée. Est disqualifié l’avenir que cela aurait pu lui ouvrir. Ce qui « sauverait » Céline, ce serait un artiste capable de le continuer, en le délivrant de ce qui l’a compromis.
Francis BAILLY : Modiano montre dans ses écrits qu’il aime beaucoup l’écriture de Céline. Les héros de Modiano sont des héros du mélange, des gens confrontés à leurs potentialités.
Claude BIRMAN : Oui, et sans doute trouverait-on Céline agissant chez tous les écrivains contemporains, on ne peut pas tellement le contourner. Mais pour prendre le cas du mathématicien, il n’est finalement pas nécessaire d’être S.S. pour être un bon mathématicien.
Francis BAILLY : En général, c’est le cas (Rires).
Claude BIRMAN : L’œuvre de ce mathématicien peut être détachée de son engagement S.S. S`il n’avait pas été S.S., cela ne lui aurait pas nui, et peut-être même cela l’aurait-il aidé. Y compris dans son travail. Dans l’Étoile de la Rédemption, Franz Rosenzweíg, en accord avec la tradition juive, définit la Rédemption comme une délivrance du monde. En ce sens, l’artiste part de rien, de l’affirmation pure de la liberté...
Gérard CALLIET : Est-ce qu’il n’y aurait pas une parenté avec le fait que la position de l’artiste est en rapport à une altérité radicale ? Il est « ce avec quoi il part », et « ce vers quoi il va ». Il faut savoir d’où vient cette unité. Claude, tu disais qu’elle vient de rien...
Claude BIRMAN : Du ciel.
Gérard CALLIET : Il n’y a rien de plus proche de l’inspiration que la mauvaise inspiration. Respirer, c’est être confronté avec le tout autre. Le tout autre peut être l’intuition qui viendrait du ciel (unité, liberté), mais en même temps il contraint à la liberté. Mais on n’est jamais loin de l’inspiration par l’autre, le mauvais autre, l’autre de la contrainte. L’autre peut devenir le pire. Céline cède à l’autre, à l’autre pire.
Claude BIRMAN : Céline assumait, son écriture était apocalyptique. Même dans le Voyage, ses grands couplets sur la charité portent sur une charité dans un monde maudit. L’histoire du colonial qui travaille pour sa fille, vous vous souvenez ? Il a toujours des personnages « bons », de manière sacrifiée, extatique, une fraternité folle dans un monde.
Jean-Yves RONDIÈRE : de crucifiés…
Claude BIRMAN : Oui... Il développe la tradition de l’apocalyptique chrétienne dans un monde voué à la perversité. Il accorde un grand poids à la réalité de la servitude. Chestov dit que le péché originel est de croire à la nécessité. Si on ne relativise pas la réalité, on finit par s’y soumettre. Mais si on la relativise trop, on peut être dans l’illusion…
Marcel COHEN : Je pense à un texte de Roger Laporte : « La vocation littéraire ce n’est pas seulement être fasciné par les grands textes que tout le monde a lus, c’est aussi vouloir les détruire dans une certaine mesure ». Jabès dit qu’écrire, c’est imposer silence aux autres paroles. Alors on en arrive à dire que Céline a un projet éthique.
Claude BIRMAN : Il se perçoit comme un témoin : « Je suis chroniqueur, dit-il. Comment pourrait-on maintenant imaginer la fin de la Deuxième Guerre si on n’a pas lu Nord ?
Jean-Yves RONDIÈRE : Il est chroniqueur de la mort.
Claude BIRMAN : Pas n’importe laquelle, celle que l’on voit autour de nous, en ce moment. Ce qu’il raconte ne s’est pas passé avant, ne se passera pas après, c’est ce qui se passe au vingtième siècle. Ce n’est pas une apocalypse en idée, mais vécue.
Gérard CALLIET : Si l’on situe le cas Céline dans cette bipolarité, l’émergence de l’art pour l’art et la convocation par les idéologies de l’artiste, on peut dire que Céline « force » la parole de tout le monde, anomique et impersonnalisée. On comprend à quel point sa position est pernicieuse. Installé dans la rupture, il utilise le langage du n’importe quoi, en le magnifiant.
Philippe GUMPLOWICZ : Peut-on dire que Céline ne répond pas à ce que l’on attend d’un homme et, dans le même mouvement, voir en lui un frère humain ?
Marcel COHEN : Ça me gêne que l’on me mette dans cette situation : si tu ne reconnais pas que Céline est un génie, tu es un imbécile.
Claude BIRMAN : Vous pouvez le reconnaître…
Marcel COHEN : On me force à l'admettre. Ce « mais », à propos de Céline, est bien une perversion. L’acceptant, je m’en fais le complice.
Claude BIRMAN : Vous adoptez la position de l’anathème au sens biblique. On brûle la ville, les habitants, les animaux. Cela pose un problème de Rédemption. Qu’est-ce qu’on peut sauver ?
Marcel COHEN : Je suggère que l’on relise.
Claude BIRMAN : Sa femme l’a fait, elle a dit : ça on publie, ça non. On l’a fait pour Luther. Allez-vous rejeter tout Luther à cause de ses pamphlets antisémites » ?
Francis BAILLY : La difficulté vient du fait que ce n’est pas au nom de l’unité que l`on pose la question, mais au nom de la disjonction. D’accord c’est un salaud, mais son œuvre ! On établit d’emblée la disjonction. Séparer l’œuvre et la saloperie est impossible, du point de vue de l’unité. En ce qui me concerne, je poursuis un combat contre ce qu`a fait Céline et je m’intéresse à ses textes. Je trouve l’unité en moi, dans le processus par lequel je suis en mesure d’effectuer ce tri.
Marcel COHEN : Ce qui pose problème, c’est que l’on nous impose d’accepter ce « oui mais », cette disjonction...
Philippe GUMPLOWICZ : Mais l’unité de l’artiste ? À chercher parmi les artistes — ou écrivains — celui qui parviendrait à être intégralement lui-même dans ce qu’il fait, à être libre, le juste, comme dit Claude Birman, on ne rencontre que du vent. Où mettons-nous la barre ?
Marcel COHEN : Si l’art, la littérature n’est pas cette tentative vers l’unité, alors quelle importance tout cela a-t-il ? Ce qui paraissait exemplaire dans le cas de la traduction de Céline en hébreu, c’est que si Céline n’était pas traduit, ce n’est pas parce qu’il y avait une censure, mais parce qu’il y avait une espèce de consensus pour ne pas le traduire.
Claude BIRMAN : Vous pourriez faire la même réflexion pour Voltaire. Voltaire est sûrement traduit en hébreu. Il faut distinguer l’avant et l’après. Une fois que quelque chose est révolu, on peut reprendre ce qui est bon, aimer les cathédrales indépendamment du christianisme historique. Que les étincelles soient dans la boue ne peut justifier le fait que quelqu’un se mette dans la boue et dise : « Vous me pardonnerez, ça ne va pas m’empêcher de produire des étincelles ». On ne peut donner quitus d’avance à quelqu’un qui fait preuve de complaisance.
Jean-Yves RONDIÈRE : Tu prévois deux types d’analyse, une pour le passé et une pour le présent ?
Claude BIRMAN : Le passé est rempli de tentatives avortées de ce que l’on doit réussir dans l’avenir.
Jean-Yves R0NDlRE. — Ce qui est condamnable aujourd’hui peut contenir quelque chose qui, dans une analyse future, dira le contraire.
Claude BIRMAN : C’est un fait. Il faut maintenir que la morale ne peut pas sortir d’ailleurs que de l’art. Les textes bibliques sont d’abord artistiques. L’artiste dit la vérité. Le moralisme qui s’oppose à l’art est forcément étroit.
Marcel COHEN : Ce qui me frappe chez beaucoup d’écrivains de ma génération, c’est une espèce de suspicion vis-à-vis de la littérature avec un grand lieu de toutes les compromissions, où les étincelles et la boue sont inextricablement mêlées.
Emmanuel HOCQUARD : Pas seulement des compromissions sociales.
Marcel COHEN : Je crois que ce qui pourrait caractériser des écrivains aussi différents, c’est une méfiance instinctive à l’égard de la littérature et une sensation que poser un mot est un acte éthique et esthétique en même temps. Ce qui pourrait caractériser la poésie aujourd’hui, c’est non seulement la haine de la poésie, mais aussi le sentiment de sa gravité extrême, d’où une raréfaction, jusqu’à « l’écriture blanche » que l’on connaît.
Emmanuel HOCQUARD : Je me demande s’il ne conviendrait pas de faire la distinction entre morale et éthique. Je ne les vois pas sur le même plan. On doit pouvoir faire des connexions entre les deux, mais si la morale est l’ensemble des règles que se donne une société à un moment donné, je ne pense pas que l’éthique soit concernée par cette histoire-là.
Gilles Deleuze, à propos de Foucault, écrit ceci : « La morale se présente comme un ensemble de règles contraignantes d’un type spécial, qui consiste à juger des actions et des intentions en les rapportant à des valeurs transcendantes (c’est bien, c’est mal…) ; l’éthique est un ensemble de règles facultatives qui évaluent ce que nous faisons, ce que nous disons, d’après le mode d’existence que cela implique. On dit ceci, on fait cela : quel mode d’existence ça implique-t-il ? » Peut-être est-ce à entendre comme lorsque Wittgenstein écrit que « L’indicible [...] forme peut-être la toile de fond à laquelle ce que je puis exprimer doit de recevoir une signification ». Chez Wittgenstein, « L’éthique et l’esthétique sont une », mais l’éthique ne traite pas du monde. Je dirais, par métaphore, que je vois la morale comme du prêt-à-porter et l’éthique comme du sur mesure, au sens où Wittgenstein évoque un essayage chez le tailleur. L’appréciation (esthétique ou éthique) consisterait à évaluer la justesse ou la correction d’un travail sans se reporter pour autant à un modèle préexistant comme en morale. Ces appréciations ressembleraient aux indications données au tailleur : « Ce n’est pas la longueur correcte. » « C’est trop long, trop court. » « Voilà, n’y touchez plus. » Une telle approche est le plus souvent négative. « Ici, quelque chose ne va pas » ; « Ici, je sens qu’il y a quelque chose de louche. » Mais qu’est-ce qui me permet de me dire : « Ici, ça ne va pas » ou « Maintenant ça va » ? Je n’en sais absolument rien, mais je sais que ça ne relève pas de la morale, des notions de bien et de mal, de beau et de laid. Il y a un certain nombre de notions qui me paraissent louches, que je ne peux pas accepter de gober comme ça, sans autre forme d’examen : œuvre, auteur, grand écrivain, beauté, style, etc. Le travail d’un écrivain est quand même d’abord un travail sur le langage, sur la « sincérité » (au sens que Zukofsky donnait à ce mot) de son propre langage. Cela suppose un examen permanent des notions que charrie ce langage, autour de moi et en moi.
Claude BIRMAN : « Dieu » ?
Emmanuel HOCQUARD : « Dieu », ça ne passe pas non plus... À la fois j’aime le côté studieux de la parole qui circule ici entre nous et en même temps, j’éprouve une certaine gêne. Je trouve cela un peu sérieux et grave. Je trouve que ce n’est pas suffisamment joueur. Il y a des problèmes qu’on devrait pouvoir aborder en jouant.
Danièle BAILLY : La science ne joue-t-elle pas ?
Emmanuel HOCQUARD : Dès qu`on parle de littérature, on est d’un immense sérieux. Rien que cela me la rend suspecte. En littérature, même ceux qui jouent le font sérieusement. Pourquoi est-ce que l’éthique ne serait pas joyeuse ?
Francis BAILLY : Quand tu dis : « Je ne sais pas d’où vient ce qui fait que quelque chose ne va pas », c’est le point important.
Emmanuel HOCQUARD : Oui, je pense que c’est le point important. Mais ce n’est pas pour autant une question angoissante.
Claude BIRMAN : « Certains mots ne passent pas ». Vous sentez qu’il faudrait dire autrement ?
Emmanuel HOCQUARD : Ce n’est pas tellement la question des mots, mais des notions que véhiculent les mots. On pourrait dire table ou chaise autrement. Ça compliquerait un peu les choses, mais ça ne changerait rien au fond. Les notions de table et de chaise ne me paraissent pas, au demeurant, particulièrement suspectes. Je pensais aux mots qui véhiculent des notions imprécises, voire ambiguës. Ou des mots qui amalgament plusieurs notions sans qu’on ait pris la peine de préciser dans quel sens on les emploie ; ce sont les plus pervers : des mots comme vie et mort, origine, temps, aimer, nature, homme, unité, commencement et fin, etc. Sans parler des mots qui relèvent de l’indicible : Dieu, infini, que sais-je encore. Ces mots, il faudrait éviter de les utiliser sans avoir pris un certain nombre de précautions. Ou ne les employer que dans les formulations négatives. Le mot le plus inoffensif en apparence peut masquer un préjugé.
Francis BAILLY : Tu es très wittgensteinien.
Claude BIRMAN : Tu sembles dire que nous souffrons d’une maladie du langage.
Emmanuel HOCQUARD : Je dirai, pour le coup, d’une maladie éthique qui se manifeste et se transmet dans et par le langage. Pas seulement les mots, mais aussi et surtout la grammaire. C’est aussi notre chance : ce dont nous souffrons dans le langage, nous pouvons en guérir dans le langage, par une critique vigilante de notre langage. Toute notre grammaire serait à reconsidérer de fond en comble. Les notions de sujet et d’objet, par exemple. J’ai le sentiment, comme on dit, que nous avons moins besoin d’écrivains, de philosophes, de psychologues ou de métaphysiciens que d’ingénieurs-grammairiens.
Francis BAILLY : Est-ce que tu penses que pensée et langage, c’est pareil ? C’est vrai, compte tenu de ce que tu dis, c’est l’essentiel.
Emmanuel HOCQUARD : J’hésite à répondre oui absolument, mais au fond je le pense. Existe-t-il une pensée musicale, une pensée picturale, etc. ? Sans doute. Encore faudrait-il préciser en quel sens. C’est peut-être ici qu’on pourrait reprendre la distinction entre dire et montrer. Mais ce que je peux dire, en tant que soi-disant écrivain, c’est que ma pensée est à l’œuvre dans le langage. Que les problèmes que je soulève, je les soulève dans et par le langage. Je ne vois pas comment je pourrais résoudre hors langage des questions que je me pose sur et par le langage. Et quand je dis résoudre, je ne veux pas nécessairement dire trouver la réponse. Résoudre un problème, ça peut aussi consister à dissoudre une question mal posée. J’affronte volontiers les problèmes en termes négatifs. Oui, c’est par le langage que nous devrions parvenir à débloquer ce qui (nous) coince dans le langage. Pas forcément de chercher à énoncer des vérités, mais plutôt à débusquer les erreurs. Comme il existait autrefois des écrivains publics, nous devrions pouvoir aller trouver le garagiste grammairien du quartier pour qu’il nous dise ce qui cloche dans nos énoncés.
Marcel COHEN : D’où viendrait la négation chez toi ?
Emmanuel HOCQUARD : Chez moi comme chez n’importe qui, comme chez un chat, je suppose : si tu lui donnes à manger quelque chose qui va l’empoisonner ou le rendre malade, il aura un réflexe de méfiance et il ne mangera pas. Il ne dira pas non, mais il se comportera d’une façon négative, qui peut lui sauver la vie. Au bout du compte, ce n’est pas si négatif que ça.
Francis BAILLY : Il y a une question que je me posais par rapport à ce que tu disais : est-ce qu’il y a des négations qui peuvent valoir, sans une affirmation qui soit sous-jacente ou qui l’annule ? Dans le système formel, dans la logique des propositions, on ne peut construire un système logique de propositions qu’à partir de deux connecteurs. Sauf si l’on accepte que le système soit fondé sur la négation. Auquel cas, on n’a besoin que de la négation. Néanmoins, on ne peut s’empêcher de dire que c’est une négation qui porte sur quelque chose. Et le « sur quoi » il porte est toujours en filigrane. Quelle est la dualité qui anime ta négation ?
Emmanuel HOCQUARD : Je ne suis pas logicien. Je répondrai, de mon propre fonds, que négation n’est donc peut-être pas le terme approprié. Que je ferais mieux de parler d’interrogation négative. Sur quoi portent mes interrogations négatives ? Sur des propositions de langage. Du langage qui court les rues, même celles des beaux quartiers. Devant telle proposition, je tique, je me méfie, je bondis même parfois. Alors, je l’examine. Je me demande : « Qu’est-ce qui m’a fait bondir ici ? » ou « Qu’est-ce qui, j’en ai le soupçon, ne va pas là-dedans ? » ou encore « De quelle notion, dont je ne me suis pas préalablement assuré, cette proposition est-elle porteuse ? » ou « Qu’est-ce qui, dans l’intonation de cette phrase, indique que quelque chose ne colle pas ? »
Francis BAILLY : Donc, tu as à ta disposition déjà un système d’évaluation qui te permet, devant une situation...
Emmanuel HOCQUARD : Certainement pas un système d’évaluation. Ça, c’est bon pour la morale. Si on parle d’éthique et qu’on est d’accord pour estimer que c’est autre chose que la morale (même si l’une est éclairée par l’autre), il me faudra parler de manière très vague de quelque chose comme un sens éthique. Pourquoi vague ? Parce que nous touchons là aux limites du langage, dirait Wittgenstein, et que nous cherchons à dire l’indicible. Mais peut-être que l’indicible se montre dans le langage, et donc dans ma vie, par ce que je nomme, faute de mieux, ce sens éthique qui fonde précisément ma critique du langage. C’est vrai, je ne sais pas ce que c’est parce que je ne peux pas dire ce que c’est. Mais s’il n’y avait rien du tout comme ça, est-ce qu`il me viendrait même à l’idée de me poser la question ou de comprendre ta question ? Il doit y avoir là quelque chose d’assez puissamment présent pour m’amener à penser que tout doit être mis à plat. Ce sens éthique, il me semble que chacun de nous en a l’expérience, même très diffuse, au quotidien. Mais aussitôt qu`on veut le saisir, comme un objet de pensée, il se dérobe. Ce qui ne me paraît pas très étonnant.
« Il y a en l’homme la tendance à donner du front contre les bornes du langage », notait Wittgenstein, au cours d’une conversation chez Schlick, le 30 décembre 1929. « Voyez par exemple lorsqu’on s’étonne de l’existence de quelque chose. Cet étonnement ne peut pas s’exprimer sous forme d’une question et il n’y a pas davantage de réponse. [...] Donner du front contre les bornes du langage, c’est là l’éthique. […] En éthique, on fait toujours l’essai de dire quelque chose, qui n’atteint pas l’essence de ce qui est en question et ne peut pas l’atteindre. » Le 17 décembre 1930, revenant sur sa Conférence sur l’Éthique, Wittgenstein remarque : « À la fin de ma conférence sur l’éthique, j’ai parlé à la première personne. Je crois qu’il y a là quelque chose de tout â fait essentiel. À ce niveau, rien ne peut plus faire l’objet d’un constat, je ne puis qu’entrer en scène comme une personne et dire je. […] Là il est essentiel que je parle de mon propre fonds. » Je regrette un peu l’expression « entrer en scène comme une personne » qui n’ajoute rien et, me semble-t-il, brouille l’énoncé, mais l’important est : « À ce niveau [...] je ne puis que […] dire je ». Important pourquoi ? Parce qu`il nous est indiqué ici que je est peut-être le seul point de passage entre dicible et indicible. Je comme mot de passe aux confins du langage. Il faudrait faire un jour la grammaire de je.
Marcel COHEN : La suspicion à l’égard du langage est ce qui fonde l’écrivain. Quiconque n’entretient aucune suspicion n’est pas écrivain. Tout écrivain sait qu’il cesse d’être totalement sincère à partir du moment où il commence à éliminer les mots.
Jabès prend l’exemple d’une femme qui quitte son amant, et celui-ci lui écrit pour lui dire combien il souffre, mais au moment où il prend la plume, il va essayer de faire des belles phrases. Et donc, il ne souffre plus, la vraie souffrance étant ce qui ôte le recours de la parole. Nathalie Sarraute dit qu`on ne peut pas écrire : « je meurs ». Toute écriture est dans une certaine mesure écrire « je meurs ». Ce qui est plus grave, c’est qu`une fois que nous avons dit « je souffre » dans un texte, nous finissons par croire que c’était la vraie souffrance. La souffrance devient la fiction de la souffrance, tout écrivain est sensible à ça.
Francis BAILLY : C’est une bonne thérapeutique.
Marcel COHEN : L’article de Patrick Kechichian qui rendait compte du livre de Henri Godard (Céline scandale, Gallimard, 1994) dans « Le Monde » était courageux. À ma connaissance, c’est le seul texte qui pose le problème d’une manière complexe, juste : « En aura-t-on jamais fini, trente-quatre ans après la mort de Céline [...] Au nom de la littérature, au nom surtout de la pensée très répandue que les écrivains jouissent dans leurs livres d’une sorte d’exonération de l’impératif moral, qu’ils constituent une élite, un clan ou une caste, qu’ils sont les juges et les garants de lois particulières par eux-mêmes édictées, on a tôt fait d’évacuer la réalité du scandale, ou de vider cette réalité de son contenu, d’en faire une donnée positive, une preuve supplémentaire et paradoxale de la grandeur. Il n’en demeure pas moins que, dans le cas de Céline, relativiser le motif scandaleux ou le contourner au profit d’une alternative bien tempérée qui mettrait l’œuvre présentable au premier rang, revient à commettre un véritable coup de force éthique dont la littérature ne peut sortir grandie. Les aspects ignobles ou monstrueux de Céline ne sont nullement périphériques, ou secondaires par rapport à la grandeur affirmée de l’œuvre. Il est, de plus, hautement improbable qu’entre ces deux termes une contradiction existe. “Mort à crédit” et “Bagatelles pour un massacre” sont contemporains. Les pamphlets antisémites et les romans participent du même mouvement d’écriture et de pensée. Céline n’a jamais renié ni regretté la moindre phrase de ses écrits. »
Jean-Yves RONDIÈRE : Il marche sur des œufs...
Gérard CALLIET : Le cas Céline est compliqué, dangereux ; il ne faut pas appliquer à son endroit un ton de propagande. On peut même arriver à un certain point de compréhension de Céline, si on commence par condamner rigoureusement sa position.
Philippe JAWORSKI : Il est impossible de dissocier l’écriture des romans et des pamphlets parce que l’écriture célinienne est à la fois l’écriture des romans et l’écriture des pamphlets. Il n’y a pas d’un côté des romans qu’on pourrait sauver et d’un autre côté un ensemble de textes à brûler... Son écriture romanesque deviendra de plus en plus résiduelle. À partir de Mort à Crédit, le phénomène s’accentue, la phrase se ramène au substantif, à l’injonction, à l’insulte, à une succession de petits éléments, de mots jetés... C’est une véritable écriture de l’insulte permanente, du mépris, de la haine, déjà présente dans le Voyage au bout de la nuit. L’antisémitisme en est la pointe extrême. Prendre le texte de Céline, c’est nécessairement se trouver dans une situation de grande compromission où l’on est amené à essayer de tenir à l’écart ce que lui n’écarte pas.
Gérard CALLIET : Qu’est-ce qui est le plus grave ? Quelqu’un au bord de sa propre folie personnelle, happé par l’invective, l’insulte et la haine, ou un bon bourgeois de son siècle qui s’en prend aux Juifs ? Céline est dans un rapport de fascination haineuse. Le témoignage d’écrivains installés qui, de temps en temps, laissent filer un truc contre les juifs, ne l’est pas moins.
Marcel COHEN : Il y a aussi la façon dont Céline produit ses effets. L’écriture de Céline n’est pas une écriture rapide, elle est très lente, très travaillée, très élaborée. Sans doute ce qu’on a écrit de plus littéraire dans le mauvais sens du terme depuis longtemps. Pourquoi, alors qu’il écrit laborieusement, veut-il nous laisser croire à une écriture rapide, haletante, au fil de la plume ? Proust ne cherche pas à nous faire penser qu’il écrit lentement ou rapidement, il écrit comme il écrit.
Philippe JAWORSKI : La légitimation va jusque dans les manuels scolaires. La consécration littéraire de Céline est liée à la réécriture de notre rapport avec la droite de l’entre-deux-guerres et avec Vichy.
Claude BIRMAN : Que diriez-vous des autres, publiés aujourd’hui à tour de bras ? Brasíllach ? Drieu ?
Marcel COHEN : Nous parlons de suspicion à l’égard des mots, nous devrions parler de suspicion à l’égard de notre culture... Si nous n’interrogeons pas le style de Céline, nous ne faisons pas notre travail. Un travail que font intuitivement des écrivains comme Emmanuel, mais qui ne semble pas relayé par les intellectuels. Par l’université notamment. On a l’impression qu’il y a une continuité, avec un paroxysme dans l’horreur, et qu’on peut refermer la parenthèse. On n’est pas naïfs au point de penser qu’il y avait les nazis d’un côté et un monde innocent de l’autre. Nous avons des questions à poser, y compris au style. Impossible de séparer l’esthétique de l’éthique.
Claude BIRMAN : Céline est un écrivain catholique, même si beaucoup de catholiques ne se reconnaissent pas en lui. Ce qu’il revendiquait... c’est l’idée de Satan prince de ce monde, et la crucifixion comme seule manière de se sauver dans un monde apocalyptique : incarner la charité et avoir tout le monde contre soi. Céline était fier d’avoir « l’article 75 au cul et des ennemis « hypocrites » qui le persécutaient parce qu’il était un saint. Isoler Céline de toute la culture chrétienne est difficile, mais rejeter la culture chrétienne en bloc paraît très difficile aussi.
Emmanuel HOCQUARD : Pourquoi ?
Claude BIRMAN : Parce que j’aime bien les cathédrales.
Emmanuel HOCQUARD : Il faut arrêter d’aimer les cathédrales…
Gérard COHEN-SOLAL : Il semblerait qu’on ait oublié qu’une parole écrite devient vivante quand on en parle. Discuter sur Céline, c’est lui donner de la vie. Je n’ai pas de commentaire à faire sur Céline. Je le laisse là où il est. Moins j’en parle, plus je l’enterre. Je me refuse à trouver de l’esthétique chez lui. C’est laid, comme ce qui est horrible.
Claude BIRMAN : Si tu ouvres Mort à Crédit, tu y vois la critique du scientisme. Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises dans les livres de Céline, qui me permettent de comprendre le monde contemporain.
Gérard COHEN-SOLAL : Sur le plan social, en groupe, avec les gens qui le défendent, le mettent en avant, il faut répondre avec un marteau. Il ne faut pas décortiquer, analyser dans le détail. Vous lui donnez consistance. Vous l’écrasez ou vous évitez de l’écraser, mais il ne faut pas en discuter.
Marcel COHEN : Au contraire, il faut entrer dans l’esthétique du texte, pour savoir où est le danger. L’écriture de Céline nous est présentée comme un modèle. Mais il y a d’autres questions bien sûr, et on peut, par exemple, se demander si vouloir s’interroger sur l’identité, ce n’est déjà pas mettre le doigt dans un engrenage rouillé. L’université ne fait pas son travail, elle ne nous donne pas le bagage critique qui nous permet de lire les œuvres...
Emmanuel HOCQUARD : Ce n’est pas son rôle. L’université est le conservatoire de cette culture. Elle défend le corpus. Il devrait y avoir en dehors de l’université des gens avec des Grosse Bertha.
Philippe JAWORSKI : Le style n » est pas qu’un simple revêtement. Chez Wagner, le style n’est pas distinct de sa thématique. Le leitmotiv de la répétition, l’effet de fascination, d’hypnose, le jeu subtil sur les crescendo dans les moments où l’amour est exalté en même temps que la mort.
Marcel COHEN : Je déplore qu’il n’y ait pas un travail critique sur le style de Céline. Nous commencerions à parler de choses sérieuses, si on pouvait le décortiquer, comme Nietzsche en son temps a essayé de le faire pour la musique de Wagner, comme Adorno l’a fait…
Claude BIRMAN : Quand je dis qu’il faut sauver ce qu’il y a de réussi dans le style de Céline, ça ne veut pas dire qu’il faut le suivre dans les dérives qui conduisent à la mort. C’est le problème de l’éducation... Je n’accepterais pas un texte antisémite dans un manuel de littérature. En revanche, je comprends qu’il y ait des pages du Voyage dans le Lagarde et Michard.
Éliane SCHEMLA : Au départ ton tri paraît fin et à l’arrivée, c’est enfantin. Tu enlèves ce qui est antisémite et tu gardes le reste.
Claude BIRMAN : C’est ce qu’on a fait pour Luther. Je crois qu’on en revient là.
Marcel COHEN : Il y a un petit texte d’une grande clarté, de Lacoue-Labarthe, qui s’appelle « le Mythe nazi », dans lequel il évoque le cas Wagner en disant qu’il est intéressant que Wagner ait eu besoin d’un mythe fondateur et de l’identité qui en découle...
L’histoire de l’Allemagne est la recherche de l’identité allemande. L’Allemagne recherche une identité dans la Grèce des présocratiques ; ce qu’il y a de plus confus, de plus inarticulé, de plus fragmentaire, de plus archaïque. Dans la volonté de l’Allemagne de se chercher une source, il y a la volonté de ne pas trouver la même source que celle qui inspire l’Europe.
Philippe JAWORSKI : Qui serait l’anti Céline ?
Éliane SCHEMLA : Kafka.
Gérard CALLIET : Artaud.
Philippe JAWORSKI : Raquel, quel sens le mot « éthique » a-t-il pour toi ?
Raquel LEVY : Je me méfie du mot éthique. Le mot paraît clair au premier abord, mais plus j’y réfléchis, plus la transparence première se trouble. Lorsque l’on fait appel aux dictionnaires, les notions de morale et d’éthique s’y trouvent amalgamées, sans définition précise, comme souvent quand nous voulons approfondir le sens d’un mot. Il semble que nous vivions la plupart du temps en surface et avec bonne conscience, sans mettre en question notre vocabulaire, par peur de trop creuser, de mettre à jour la complexité qui nous constitue. Dans la langue de la Thora, très souvent, un même mot est à double tranchant, et peut définir deux notions opposées. L’envers et l’endroit du même. Chaque élément surgit au contact de son contraire. Comme deux options possibles. Ainsi le mal et le bien, qui peuvent se retourner selon les circonstances ou les conduites.
Lorsqu`on en parle, il semble aller de soi que le mal, c’est l’autre qui en est porteur ; nous seuls serions possesseurs d’une éthique saine, « vraie ». Hitler lui-même n’était-il pas porteur d’un projet qui devait sauver le monde ? Mais ne sommes-nous pas pétris de bien et de mal mélangés ? « Et vous serez comme des Elokim connaissant le bien et le mal » (Gen. 3, 5). Par conséquent, le premier travail à faire sur soi, en matière d’éthique, devrait être un travail de discernement : quelle est la part du mal en nous et quelle est la part du bien ? Dans la mesure où nous pouvons savoir ce que recouvrent ces notions. Par ailleurs, tenter de démêler ce qui nous appartient en propre, nous constitue, et ce qui relève de la culture, la famille, le milieu social ; ce qui en nous est leurre. Les petits caméléons sont légion. Et discerner aussi en nous, ce qui est affaire de sentiments, humeurs, sensations, c’est-à-dire du domaine du fluctuant ; et ce qui est du domaine de l’intellect, l’intelligence, la pensée... Ou bien dans une autre dimension, plus vaste, indicible : qu’est-ce qui nous permettrait d’aller au-delà de la pensée ? Chacun de nous, lorsqu’il pense et se pose des questions, ne peut le faire qu’à partir de sa constitution de départ et de son acquis. À partir de cette évidence, chaque point de son parcours n’est qu’un constat personnel, unique. On ne peut parler d’éthique entre sujets qui sont encore informes, mais ne peut-on parler de liens à établir, de l’importance de ceux-ci pour constituer une solidité — liens nécessaires préalables à toute construction du sujet ; je ne me constitue pas spontanément sans la confrontation à l’autre, regard, miroir, jeux de reflets qui me vivifient. Nous ne sommes pas coupés mais liés dans le moindre de nos actes, pris dans un réseau constant d’interférences qui nous engagent tous. Nous sommes en devenir, tout autant comme sujets qu’en tant que relation à l’autre ; et c’est là que l’on peut parler d’éthique en train de naître, en train de se faire. Nous sommes requis sur tous les fronts à la fois. La vigilance doit être constante, lucide, intellectuelle. L’histoire de l’Hébreu est une suite de tentatives en vue de l’accomplissement du projet dont nous sommes porteurs. La chose importante est ce travail de décapage : lutte contre les idoles, destruction des images, sur tous les champs à la fois. Sans oublier que le premier champ à décaper est en nous. Il n’y a que des points de vue, qui varient sans cesse, en fonction des situations et selon les territoires traversés. Pour nous, la vérité ne peut être que partielle, plurielle, car je ne peux me connaître, me saisir, n’étant qu`une dynamique subtile, en devenir. Ce monde n’est pas lumière mais confusion, opacité, tohu-bohu. Le plus sombre, le plus désordonné, en apparence. Un monde où tout est fait pour nous empêcher d’accomplir notre vocation d’être à part entière. Responsable. Toute la création, semblent dire certains de nos sages, tend à l’accomplissement de ce point ultime : un monde opaque, voilé... où les évidences ne sautent pas aux yeux — c’est le moins que l’on puisse dire ! Nous ne pouvons que travailler, toute notre vie, pour affiner notre perception, la pousser à l’extrême limite de nos possibilités. Aller vers... l’être en moi que je cherche à faire émerger, pour y puiser une certitude que rien autour de moi ne laisse prévoir. Pari fou, qui nécessite une intention forte, intense. Car je suis à faire à chaque instant.
Emmanuel HOCQUARD : Il est difficile de parler d’éthique en général. On sait si on est en accord avec ce qu’on fait au moment où on le fait.
Gérard COHEN-SOLAL : L’autre viendra peut-être dans cent ans, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui est l’autre. Tu t’adresses à un autre, à qui tu proposes ce que tu es en train d’élaborer, et l’éthique apparaît dans la manière dont tu élabores. Et c’est pour ça qu’il me semble que l’éthique est forcément quelque chose de personnel...
Gérard CALLIET : Quand je vois tes tableaux, j’ai l’impression que tu confies à l’autre une très sérieuse énigme. Ta peinture provoque une sérieuse interrogation.
Raquel LEVY : En moi aussi. Quand je fais Notes, c’est le même acte que lorsque je peins. Le même questionnement.
Emmanuel HOCQUARD : On emploie le mot éthique, alors qu’on devrait parler de morale simplement.
Quand une commission se réunit, c’est pour mettre au point un certain nombre de limites, de règles, ça s’appelle un code moral. Je ne vois pas en quoi ça concerne l’éthique.
Gérard CALLIET : Une commission éthique, c’est le symptôme d’une inquiétude vis-à-vis d’une situation où des éthiques qui seraient efficientes dans un registre social sont absentes.
Claude BIRMAN : Est-ce que tout ce travail de défense et de critique préalable est nécessaire, ou est-ce qu’il compense le fait qu’autre chose ne surgit pas ?
Emmanuel HOCQUARD : Je ne vois pas aujourd’hui la nécessité de construire... Assez de constructions comme ça. On peut attendre de nous qu’on produise des « moins », pas des « plus », qu’on vide des baudruches de leur non-contenu. Pas besoin de construire de nouvelles baudruches à côté. Ça fera beaucoup de place et on respirera beaucoup mieux.
Marcel COHEN : Tu es censé apporter, dans le sens commun, quelque chose de plus.
Emmanuel HOCQUARD : Une brique de plus ? Les livres que j’écris, j’essaye de faire que ce soit une brique de moins.
Claude BIRMAN : Toute négation suppose un enjeu positif, un projet.
Emmanuel HOCQUARD : Vider le grenier est un sacré projet. Tous les Galilée ont eu une démarche négative qui a été drôlement positive... La finalité n’est pas de retourner dans le chaos, mais d’y voir plus clair. Et pour y voir plus clair, il faut chasser les ténèbres.
Marcel COHEN : Je voudrais renvoyer à la citation de Kafka de ce matin. Le travail d’un artiste, ce serait de rendre enfin possible une parole vraie d’homme à homme. Une parole vraie. Sans les poncifs...
Emmanuel HOCQUARD : On n’est pas naïf au point de pouvoir concevoir le « vrai » ou la « vérité » comme un objet à acquérir. Le « vrai » qui nous intéresse, c’est se débarrasser du « faux » en nous.
Marcel COHEN : Paul Celan comparait un poème à une poignée de main. Un geste vers l’autre, un don à l’autre, qui suppose une certaine forme de vérité, d’authenticité. On ne peut pas éviter l’autre.
Emmanuel HOCQUARD : « L’autre », ça fait aussi partie des gros mots... Je ne dis pas que la question ne se pose pas. Mais en affrontant cette question de face, peut-on la résoudre ? Je suis sûr que non. Si tu me dis qui est l’autre, je suis prêt à lui serrer la main.
Gérard COHEN-SOLAL : L’image de poignée de main est belle... (Rires)
.
Emmanuel HOCQUARD : J’ai du mal àvoir de la beauté là-dedans. Une poignée de main est d’abord un geste de non-hostilité,
pas un geste d’amitié ni même de sympathie. Bon, ici c’est une métaphore. La métaphore d’une intention ou d’un état d’esprit. Ça ne va pas plus loin. À tout prendre, je préférerais encore « coup de main » à « poignée de main ». Imaginez une personne âgée qui a du mal à descendre une valise sur le quai, en descendant du train. Je peux aller vers elle et lui donner une chaleureuse poignée de main. Ça lui fera, si je puis dire, une belle jambe. Je peux aussi prendre la valise et la descendre sur le quai. Ça s’appelle donner « un coup de main ». C’est quand même plus intéressant.
Marcel COHEN : S’il n’y a pas l’autre, pourquoi se poser le problème de l’éthique en art ?
Gérard COHEN-SOLAL : Dans le domaine de la recherche scientifique, le travail est abouti dès lors que, d’une question, on arrive à plusieurs questions plus fondamentales. Le progrès de la recherche, c’est la création de nouvelles questions. On pose une question, on élabore d’autres questions plus primordiales, qui montraient que la première était mal posée, qu’elle était à côté… Espérer trouver comme réponse à une question autre chose que des questions, c’est la mort de la recherche.
Philippe JAWORSKI : Poser une question ne suppose pas toujours un interlocuteur. I
Malakoff, le 8 janvier 1996
Texte établi pour la publication par Philippe Gumplowicz
NOTES
avec la participation de
Danièle Bailly
Francis Bailly
Claude Birman
Gérard Calliet
Gérard Cohen-Solal
Philippe Gumplowicz
Emmanuel Hocquard
Philippe Jaworski
Raquel Levy
Jean-Yves Rondière
Éliane Schemla
© revue Notes 1996 – Tous droits réservés
PUBLIÉES PAR RAQUEL
52, av. Pierre Brossolette — 92240 Malakoff __ N° 3 — Juin 1990
CHARLES BERNSTEIN
on

CHARLES REZNIKOFF
Du 29 septembre au 1er octobre 1989 se sont tenues les Ve Rencontres internationales de Royaumont, consacrées aux poètes objectivistes américains (1). Parmi les intervenants venus des États-Unis, outre Carl Rakosi, Michael Palmer fit la présentation générale du « mouvement » objectiviste, Lyn Hejinian présenta Louis Zukofsky, Michael Davidson parla des « silences de George Oppen » et Charles Bernstein donna, sur Charles Reznikoff, la communication que l’on lira ici, ponctuée par des traductions « sur le vif » de Pierre Alféri. La transcription de la bande enregistrée de cette intervention a été assurée par Judith Crews. Je remercie Charles Bernstein d’avoir autorisé sa publication dans NOTES. R.L.
 Royaumont, le 1er octobre 1989. De gauche å droite : Pierre Alféri, Carl Rakosi et Charles Bernstein.
Royaumont, le 1er octobre 1989. De gauche å droite : Pierre Alféri, Carl Rakosi et Charles Bernstein.
Fils d’immigrants juifs venus de Russie, Charles Reznikoff est né â Brooklyn, en 1894. Il est mort à New York, en 1976. La presque totalité de son œuvre poétique et romanesque a été publiée, aux États-Unis, par Black Sparrow Press, Santa Barbara. De Charles Reznikoff, on peut lire en français : Témoignage (États-Unis 1885-1890), trad. Jacques Roubaud, P.O.L./
Hachette, 1981. Le musicien (roman), trad. Emmanuel Hocquard et Claude Richard, P.0.L. 1986. Holocaust, trad. Jean-Paul Auxeméry, Dominique Bedou Éditeur, 1987. Des poèmes extraits de Testimony Volume 2, trad. Jean-Paul Auxeméry, in Banana Split, Numéro 36, 27, av. du Prado, 13006, Marseille.
Charles Bernstein est né à New York, en 1950. Il a dirigé, avec Bruce Andrews, la revue L=A =N=G=U=A=G=E. Poète, essayiste et traducteur (Claude Royet-Journoud, Olivier Cadiot), il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages publiés aux États-Unis. On peut lire, de lui, en français, des extraits de Stigma, trad. Claude Richard, in 21 + I poètes américains d’aujourd’hui, Éditions Delta, Université de Montpellier, 1986
Royaumont, 30 September 1989
Charles Bernstein: We’re going to play just a brief bit of a tape from 1974. This would have been a tape made of Reznikoff reading at San Francisco State when he was 84 years old. It strikes me, hearing Carl Rakosi last night, that this kind of remarkably exuberant reading, for these poets who continued right until right through their lives, to do their work… It’s too bad we don’t have a tape of any of these people when they were quite young and starting to work as far as I know … because you may be getting a different sense, because in this tape Reznikoff is reading work that he wrote in the 1920s and even before that, and presumably it has a different twist to it. On that tape, interestingly, George Oppen does an incredibly enthusiastic introduction to Reznikoff and so as an introduction, again, I’ll just also say a few words biographically about Reznikoff so we’ll have three introductions: but perhaps the Oppen is the most useful on the tape. Just let me a few brief facts about the life of Charles Reznikoff, because I realized, talking to people this morning, while I’m ready to plunge into a commentary on Reznikoff assuming extensive knowledge of his work, perhaps I have to pull back a little bit from that, assuming that for many of you it would be an introduction.
Pierre Alféri : Charles Bernstein annonce qu’il va passer une bande vidéo où on voit une lecture faite par Reznikoff : il avait 84 ans. C’est une lecture qui a eu lieu à San Francisco et il est présenté sur cette bande par George Oppen. Charles Bernstein préfère donc que cette introduction soit faite par George Oppen, mais il va nous donner quelques détails biographiques concernant Reznikoff.
Charles Bernstein: It’s worth noting that Reznikoff was born in 1894; compare that to T.S. Eliot who was born in 1888 we’re just past the centennial; Gertrude Stein, who was born in 1875; Pound was born in 1885. You have in the 1880s, essentially, with the exception of Stein in 1875, a whole group of what one thinks of – what I would call – the ‘radical modernists’, fitst generation, also painters and so on. Reznikoff is older than the other Objectivists that we’re focusing on here, and the kind of larger group of poets that Michael Davidson, Michael Palmer and I mentioned yesterday, and I think his role as being somewhat older is recognized by his colleagues. He was already working at the time – he in fact could be compared to Williams, as much as to Zukofsky, for example, both in terms of age and the nature of his work. Williams was born in 1883, only nine years different, and Zukofsky, who was born in 1903: he’s about midway in that sense between Williams and Zukofsky, and I think it’s actually a useful way to think about what he does, not that chronology is destiny. Now we’ll see if Pierre can get those dates right.
Pierre Alféri : Eh bien, c’est très simple : Charles Reznikoff est né en 1894.
Charles Bernstein: Reznikoff’s parents came from Russia, because of the pogroms, and they came to New York City – along with many, many other people, including my own grandparents. There’s one interesting biographical story which I think I’ll just relate, because it’s sort of an interesting thing that he relates a lot, which is that his grandfather, I think it would be his mother’s father, when he died papers came back – a box of papers, reams of papers – written in Hebrew verse, and the family was upset that this might be subversive material – and I say ‘sub-verse-ive’ with the pun intended – and therefore burned the work of Reznikoff’s grandfather – the Hebrew verse. And Reznikoff mentions this in a poem, in an interview, and in the poem he suggests that perhaps whatever is left of this Hebrew verse of his grandfather is transmitted through him. He self-printed all of his work, and this again differentiates him from most of his contemporaries, I don’t mean just simply the Objectivists, but in general. He bought a press himself, and – actually the books are beautifully printed, they’re lovely to hold in your hand – and he basically printed them all; then he founded the Objectivist Press with some of his colleagues, and they together printed a book of Williams, which was a remarkable success – they were all surprised about that, and a book of his own, and of course the other Objectivists. But throughout his life, even after that, a couple of times a bookstore printed one of his books, and the Objectivist Press printed one of his books – he basically continued to print his books himself, and to give them away for free. When there was an error he would painstakingly hand correct each one. He never – I always mention Reznikoff when people talk about self-publishing, because in many ways it’s the best way to get your work out, not to have to worry about dealing with a kind of nexus of what publishers think, or somebody else, just to simply put it out, and Reznikoff doing that throughout his life is a wonderful model of what that could be. Of course at the same time it does represent a disturbing neglect of his work, for many years. People ask what brought the Objectivists together, and of course there are obvious differences between them, in terms of their work, but the fact is they read one another and were, to some degree, even with some differences of opinion, as we know about, supportive of each other in the sense that they acknowledged each other as poets working together, and that was a small circle, a pool of light in a world of poetic darkness, I think, for some of them, in terms of the reception of their work. So he had the few people he would give these books to, and he would read the books in turn. Even Williams – in, again, to me an incredibly kind of disturbing letter that he writes to Reznikoff, late in his life, after his stroke, he says, ’You pressed on me – ’now this is Williams, whom he published, who is the person you’d think would be in close touch with him, and whose work, I would say, his work most resembles, I mean I think the two of them have an interesting relationship – wrote to him saying, ‘You know, I never before read the book that you gave me, some 20 or 25 years ago, and I just want you to know that it’s one of the most remarkable and amazing things that I’ve ever seen.’
Pierre Alféri : La famille de Reznikoff est venue de Russie au tout début du siècle pour fuir des pogroms. Après la mort de l’un des Grand-pères de Reznikoff ils ont reçu une malle remplie de poésie en hébreu, dont ils ne savaient pas quoi faire et qui les a un peu effrayés, parce qu’ils craignaient qu’elle soit subversive. Et Charles Bernstein dit que Reznikoff assuma une tâche un peu parallèle å cet héritage en commençant ã imprimer des livres, puis en continuant toute sa vie à s’imprimer lui-même. Les premiers livres de l’Objectivist Press étaient un livre de Williams et un autre de Reznikoff. Par la suite, il a lui-même édité ses textes ; il les a donnés, en général, plutôt que vendus, et il faisait même des corrections, quand il y avait des coquilles, à la main sur chaque exemplaire. C’est, selon Charles Bernstein, une sorte de modèle d’autopublication ; un des intérêts du groupe Objectiviste, en ce sens, était qu’ils se soutenaient mutuellement, se lisaient mutuellement et se publiaient mutuellement tout en restant largement inconnus. Et à ce propos il raconte
une anecdote, de la fin de la vie de Reznikoff et de Williams, où Williams a écrit ã Reznikoff pour lui dire qu’il n’avait pas lu un des livres que Reznikoff lui avait envoyé depuis vingt ans ; il venait de le lire, et qu’il trouvait le livre remarquable.
Emmanuel Hocquard : Je voudrais juste, pour l’anecdote, rappeler que les premiers livres de l’Objectivist Press ont été publiés en France, près de Toulon, et que ça avait posé des problèmes pour leur diffusion aux États-Unis parce qu’ils n’étaient pas reliés mais simplement brochés. C’est assez amusant. Et, à propos de cette histoire de malle contenant des poèmes en hébreu hérités d’un ancêtre (je crois bien qu’il s’agissait du père de la mère de Reznikoff ; et que c’est la mère de Reznikoff qui a brûlé ces poèmes de peur que les services de l’immigration, ou d’autres, tombent dessus), il m’est revenu en mémoire un poème, très court, de Reznikoff, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Voici.
Mon grand-père mourut, longtemps avant ma naissance
parmi des étrangers ; et tous les poèmes qu’il écrivit
sont perdus —
sinon ce qui parle encore à travers moi
comme si c’était moi. (trad. Jacques Roubaud)
Charles Bernstein: It’s been suggested, of course, that this image of the burning of the work, is one, as I said, of the motivations for his self-publishing his work. It should be emphasized, and Lyn can speak to this better than I can, that he learned to be a letterpress printer to do this. That means he handset each letter, and printed each page separately; this is a far cry from getting an Apple computer and printing it out on a laser printer.
To conclude ‘Charles Reznikoff, His Life and Work: an Introduction,’ he did go to law school. I pondered this for a while, to think how could his parents have been so successful – they were in the millinery business – that means hats – but in fact they didn’t contribute toward his going to law school, it was not expensive in those days, and he claims to have been walking by the NYU Law School, and remembered that Heinrich Heine had gone to law school, and thought that perhaps this was a good occupation for a poet. And I think Heine is a very interesting model for Reznikoff, in some ways. But he never practiced law. He was never interested in practicing law, he didn’t want to spend his life doing that: he was interested in the process. He did work as a legal abstracter, in fact his life-work patterns resemble that of my contemporaries more than many I can think of – he did editorial work for various publications, including one that his wife, a very-well-known-in-the-Jewish-community Zionist organizer, Marie Syrkin (who just died last year) edited. But he worked as the managing editor, not being allowed to intervene editorially in that work. So it was work he didn’t enjoy very much. He did not wish to work, but had to. And as to his leftism, again he was very much a loner, but he does say in his one poem about Marx – much of his work is about those left out of society, those whose lives were destroyed by things beyond their control or things very much within the control of the economic system that he lived under, and he has a poem to that effect entitled ‘Marx.’ But that’s about the closest he comes to any specific political comment. But it’s hard to read his work without an overpowering sense of the political, and his work, again, because Emmanuel did say that in the French, is collected not completely because there are plays and other things that he wrote, novels and so on, but the poems are collected in this two volume
set that Black Sparrow did, and the two-volume Testimony – taken from legal documents from 1885 to 1915, which he condensed and rewrote, often looking at hundreds of pages of documents to get one short poem. And certainly one of the great epic poems of the 20th century in America, widely unknown, because of that. Reznikoff, unlike Rakosi and Oppen, continued to write through the 1930s, and actually Testimony is written pretty much in the period where both of them stopped, and I think that has to do with his greater sense of solitariness and self-commitment to poetry and some of these other things I’m mentioning. But it’s interesting to note that if you think about that really remarkable lacuna in the work of Rakosi and Oppen, which I think anybody following this work has to think about, it’s interesting to think about Testimony as being Reznikoff’s response to that, and what he would do, to spend his whole day, really, in the library after working – he had a job, he worked, but he spent all his free time – he had a wife, he didn’t have children, his wife was not always living with him, she was teaching at Brandeis for a while, and this is really what he spent his life doing. And then after the translation go right to 0ppen introduction on that tape.
Pierre Alféri : D’abord Charles Bernstein a ajouté qu’il pensait en effet que la peur, le souvenir de l’œuvre du grand-père brûlée expliquaient en partie le désir de Reznikoff de se publier lui-même. Puis, pour en terminer avec les indications biographiques, il a rappelé que Reznikoff a fait des études de droit, là il y a eu une anecdote que j’ai pas.... que j’ai pas bien comprise... (Aparté inintelligible concernant le commerce de chapeaux des parents de Reznikoff.) Ensuite il a fait des travaux d’édition, en particulier pour une organisation sioniste que sa femme dirigeait, je crois, ou bien où elle travaillait, mais ces travaux ne l’intéressaient pas beaucoup, c’était seulement pour gagner sa vie. Il était très à gauche, politiquement. Charles Bernstein a donc montré les principales publications, les Collected Poems d’abord, dans l’édition Black Sparrow, et Testimony. À propos de Testimony, il a expliqué que Charles Reznikoff a fait un travail énorme pour cette œuvre, puisque chaque poème suppose en fait une lecture et une compilation préalables de documents, et il y consacrait tout son temps en dehors de son travail dans une biblio – thèque, pendant de très longues années. Charles Bernstein a suggéré que, au moment même où Carl Rakosi et George Oppen s’arrêtaient d’écrire pour des raisons dont on a parlé hier, en particulier politiques, qui tenaient à leur rôle dans la société, le travail de Testimony était, d’une certaine manière, une réponse à ces difficultés mêmes, puisqu’il était à la fois, puisqu’elle touchait l’histoire de la société américaine directement, et que c’était à ce titre une véritable épopée américaine, particulièrement saisissante et justement pour cette raison, très peu connue en Amérique.
Charles Bernstein: David Bromige is asking was he not in Hollywood, and that, of course, is fascinating – he wrote The Manner Music about that. He had a friend who was a very successful Hollywood producer, and brought him out to Hollywood and it’s again a boggling thing to imagine him in Hollywood – nothing about him suggests that he could have done this. I-le’s not like F. Scott Fitzgerald, drinking away, and trying to make it. He had great ideas, none of which were acceptable to the studios, he kept thinking you could rewrite these films in ways that would be more interesting, and he was right, I’m sure! One of his most famous poems about that is sitting in his office, watching a fly buzz around, suggesting that he had little to do there … but he was well paid. He also worked as a sales person in his father’s millinery business, which he liked actually, because he used to have to sit around waiting for the buyers … which gave him time to think. He preferred that to working as a lawyer.
Pierre Alféri : David Bromige a rappelé que Charles Reznikoff avait aussi travaillé à Hollywood. Charles Bernstein raconte en effet qu’il avait un ami producteur, qui avait beaucoup de succès à Hollywood, et qu’il avait beaucoup de travail là-bas. Il eut d’abord beaucoup d’idées de scénarii, très intéressantes, très bonnes, mais aucune n’a été retenue. Il passa donc beaucoup « de temps à ne rien faire en étant très bien payé. Il y a un poème qui fait allusion à une scène où il est à son bureau en train de regarder voler une mouche. Il a aussi travaillé chez son père, dans une entreprise de chapeaux où il prenait des commandes, et ça lui convenait très bien parce qu’il se contentait d’attendre les clients.
Emmanuel Hocquard : J’aurais juste à ajouter un mot à l’appui de ce qui vient d’être dit. Dans son roman posthume, Le Musicien, il y a justement l’évocation de ce passage à Hollywood, une satire extrêmement féroce de ce milieu superficiel et épouvantable d’Hollywood. Le Musicien, qui est en partie autobiographique, se situe dans la période de la Grande Dépression américaine. C’est un témoignage extrêmement précieux non seulement sur les difficultés, la pauvreté, le chômage, etc., mais également sur la montée de l’antisémitisme aux États-Unis, chose qui est quand même assez peu connue à l’extérieur.
THE TAPE BEING PLAYED: George Oppen is speaking: ‘That poem by Charles that begins, “As I, barbarian, at last, although slowly, could read Greek/ at ‘blue-eyed Athena…’ and it goes on, is Charles” reading of that lithograph portrait on the wall of Athena. Just take that poem, it’s a beautiful poem, with a great cadence, and it moves on into that strange feeling of visiting famous times and famous places, in the midst of one’s own affairs through books. There doesn’t seem any reason… That poem was written at least 40 years ago, since I read it 40 years ago. I’m complaining about the length of time it has taken to notice Charles Reznikoff. Not that Charles Reznikoff so far as I know cares. The last time I tried to praise Charles to himself he at once interrupted to say, “George, I’m sure we both do the best we can.” A difficult man to praise, and this is my opportunity. And all the same that isn’t just random eccentricity on Rezzi’s part, and if it was modesty, it was modesty of extraordinary force. Rezzi wouldn’t listen to praise because he intended to disregard condemnation, and this was… Some of his poems in the Collected were written in 1918, some of them earlier, I think. There was the issue of free verse, to begin with, and, of course, Reznikoff couldn’t make use of the Whitmanesque breadth of the Midwest poets, and he didn’t have the authorization of the New England scene. These were poems of the city. Instead, a small man starts to climb the stairs out of the subway, and he sees the moon shining through the entrance, whereupon the world stops, and is illumined. Poem after poem of the city, which is experienced as the narrow end of the funnel: there are poems of the metaphysical dimension, actually; the “metaphysical dimension” being the absence of terror, or the disregard of it down to the very chewing gum stuck to the pavement which is in that poem. The narrow end of the funnel in the poems. The proofs in these poems are images, and the images are proofs, and the proofs are overwhelming. But Rezzi, who didn’t permit praise and disregarded condemnation, had bought a letter – press, every evening after work he set two lines of verse, teaching himself to set type as he worked – I said, Rezzi wouldn’t listen to praise because he intended to disregard condemnation or neglect. He had bought a letterpress, and every day, every evening after work Reznikoff set two lines of verse, teaching himself to set verse as he worked at it, and this way he printed all of his first books by himself. We, Mary and I that is, have carried these poems in our minds through everything that has happened to us since we were 19 or 20 years old. I don’t know of any poems more pure, or more purely spoken, or more revelatory. As I’ve confessed before, I think the young of my generation were
luckier than the youngest in this audience, in that we had to go searching for our own tradition and our own poets. What we found was Reznikofffl’ and he’s played – I cannot say how important he has been to us, and I think he will be to you, and this is what I wanted to say to Charles Reznikoff when he said, ‘George, I think we all do the best we can.’ (applause)
Reznikoff: If I’m not loud enough, tell me, I’ll try to be louder. To begin with, I thank you very much, George, for your introduction, except that it embarrasses me, now I have to deliver. If you had been very hostile, I think it would have been stimulating. Thanks, anyway!
I think I’ll begin in a way I usually do, with my platform, to use a political expression, my platform as a writer of verse.
Salmon and red wine
and a cake fat with raisins and nuts:
no diet for a writer of verse
who must learn to fast
and drink water by measure.
Those of us without house and ground
who leave tomorrow
must keep our baggage light:
a psalm, perhaps a dialogue –
brief as Lamech’s song in Genesis,
even Job among his friends –
but no more.
Like a tree in December
after the winds have stripped it
leaving only trunk and limbs
to ride and outlast
the winter’s blast.
That’s one, and now I’ll read you another one:
I have neither the time, nor the weaving skill, perhaps,
For the intricate medallions the Persians know;
My rugs are the barbaric fire worshippers:
how blue the waters flow,
how red the fiery sun,
how brilliant a green the grass is,
how blinding white the snow.
That’s the platform! (applause)
Please don’t applaud! Because I won’t be able to say all I want to say, and that’ll stop me! Well, anyway, let’s go on from here. I – of course most of the poetry of the last century and of this century too, has been properly called ‘nature poetry’. And the last great poet was Robert Frost, in that class. But for us who are born in cities – at least I was – and lived there all our lives – well, that’s a very appropriate comment, but I’ll have to wait a while – END OF VIDEOTAPE).
That’s a wonderful reading. Those who wish to listen to the whole thing, it’s about 45 more minutes, and really in a certain way the best introduction to his work, better than what we might add or detract here. Listening to this reading and being struck by what he had done I went back and created this text, and to create this text, I had to go through the two volumes, following from the first lines, and Xerox the page and cut out the little bits and strips, so that I had a whole series of little tiny papers and bigger papers numbered with the page numbers where they were and reconstruct the reading that he gave, which would go from 1918 to 1950 to 1920 to 1935, back and forth, through this intricate weave, not as the Persians make, as he says, but as Reznikoff makes, and by doing that, by cutting these strips out, I was struck with what exactly was the process of serial composition that he was engaged in all his life, which I think, needs to be said almost first, when reading the work. And what I mean by that is, this is a process of collage, of disjunctive collage, of different pieces and bits, ordered in a particular sequence and numbered, from the very first work that he did, Rhythms, in 1918, we have here – and you can see it on this page, sometimes it’s just two lines, then four lines, poems, very tiny poems often, numbered, numbered, to give a sense that there is a sequence, but the sequence is not constructed by some type of ordering principle outside of the compositional process, not by narrative, not by historical sequence, not by any type of logical or causal progression, at least overall. Sometimes one poem will deal with the subway, and the next one will deal with the subway, and then there’ll be something else. There’s different types of thematic, musical and other kinds of juxtapositions, tonal, going on, but it’s a musical working with collage and juxtaposition, a kind of montage of various sorts of elements that are put into sequence that bring to mind many subsequent workings with the idea of seriality and sequentiality that we have in American poetry, which in many ways at a formal level do not transcend the actual innovation that Reznikoff worked on right from the first, which was this type of disjunctive, serial collaging, and I would think if one thinks of the idea of the serial poem in Jack Spicer, or Robin Blaser, one gets one instance of that; if you think of what Ron Silliman has called ‘the new sentence,’ you get another instance. Silliman taking individual sentence units and finding different ways to permutate them, based, in his case, on mathematical formulas and so on, but the basic impulse towards collage, and therefore the issue of the relation of the part to the whole, the shot to the sequence, surface to depth, becomes apparent here. So this again, is an example of one of the most innovative realizations of parataxis in radical modernism, and brings to mind his great contemporaries Stein and Williams.
Pierre Alféri : Charles Bernstein remarque surtout, dans cette lecture et dans le reste, puisqu’on en a entendu seulement une toute petite partie, que Charles Reznikoff lit des poèmes de périodes très différentes sans respecter l’ordre chronologique et que cette technique, cette opération est constante chez lui : une opération de collage, si on fait une analogie avec les techniques visuelles du collage ou du montage ; et il le fait également dans la façon dont il publie ses poèmes, puisque il lui arrive de publier des poèmes extrêmement courts qui sont simplement numérotés et dont la suite ne répond pas, à une première lecture, à un ordre causal, ou thématique, mais simplement à un numérotage, donc à un montage. Et c’est toute la question d’une écriture en série, en séquence, c’est-à-dire d’une écriture où les éléments peuvent se redistribuer dans un ordre différent, comme dans cette lecture, où ils sont soumis à des permutations. Charles Bernstein suggérait que beaucoup de choses qui avaient été faites ensuite autour de ces techniques n’étaient pas fondamentalement novatrices par rapport à ce que faisait déjà Reznikoff ; il pense, par exemple, à Jack Spicer et à Ron Silliman, qui a produit une théorie de la phrase où des permutations sont possibles selon des formules mathématiques. C’est tout un jeu sur l’opposition à la fois de la partie et du tout, de la prise de vue de l’image et
de la séquence, de la surface et de la profondeur, donc un jeu sur la juxtaposition ou la parataxe qui correspond à la juxtaposition dans la phrase.
Charles Bernstein: Because of limited time, I simply will have to suggest a series of possible ways to look at these things further, so just take them as thoughts to fill in yourself later. By surface/depth, I think Reznikoff was not interested in a certain kind of realist or mimetic depth that would occur if you thematically linked all of these different items, and I think one of the reasons that his work could not be understood so easily, even compared to ‘The Waste Land,’ and I would compare ‘The Waste Land’ to Testimony in many ways – the radically different ways of dealing with dystopian material – is that by constantly intercutting and jump-cutting between the materials, the status of the detail and the particular gains primacy as opposed to some level of rhetorical depth and narrative closure, which is added to even within the kind of larger collage formats that were articulated by some of the ‘Cantos’ and by ‘The Waste Land.’
Pierre Alféri : En comparant ces techniques avec celle de « The Waste Land » d’Eliot, qui était un exemple qui avait beaucoup frappé à l’époque, de juxtaposition, de passages apparemment très hétérogènes, ou même avec les techniques utilisées par Pound, Charles Bernstein remarque que ce que cherche Reznikoff, ce n’est pas, comme dans ces exemples, ã obtenir une profondeur thématique par la juxtaposition de passages qui sont analogues ou qui ont un rapport thématique. Ce qui l’intéresse dans cette technique c’est plutôt le statut du détail qui lui est associé et qui est tout à fait particulier à son écriture.
Charles Bernstein: There’s no one who was more forceful in poetic work in foregrounding the detail and the particular over and against the blending of those details into some larger form. And that’s what I think those numbers represent in those poems. It’s not that they don’t add up to some larger form, but that the detail has an integrity and a particularity to itself. This is an idea that exists in many of Reznikoff’s contemporaries, but I think in many ways he was the most militant about it, in his own, in some ways very non-didactic way. It’s the combination of militance and extreme non-didacticism that’s one of the’ great characteristics of Reznikoff – and I would call that just for the purpose of tin – ding a term, the invention of literary cubo-serialism in American poetry. In this sense, the subject matter in Reznikoff is literally beside the point of this formal innovation, which would be possible even with different subject matter, and even without explicit subject matter. And this is a point that would of course offer a different reading than some of the readings of Reznikoff which like to take him as the most conservative and accessible of the Objectivists, and in fact as a kind of literary realist, which would – if that’s taken, be very much outside of the context that anyway some of us are presenting for the Objectivists here. I’m suggesting that to understand Reznikoff you can’t take one of these little poems as if they existed in isolation and say that this is what it’s about. You must consider the seriality of the work, and that that is fundamental, even more fundamental, if one has to make the distinction at all, than the subject matter, as impossible as that is to say in some way.
Pierre Alféri : Le statut du détail est extrêmement particulier chez Reznikoff, et il prend un relief tout à fait unique, qui fait que la mise en série des poèmes et leur numérotation ne correspondent pas du tout à la volonté d’intégrer les détails dans un tout ou dans une grande forme, mais au contraire de les isoler et de les maintenir séparés. Par opposition à un simple réalisme littéraire, Charles Bernstein préfère appeler cette technique une sorte de « cubo-sérialisme » ou de » sérialisme cubiste, » qui serait une innovation. De ce point de vue, selon lui, le sujet du poème, le propos, n’est pas véritablement l’essentiel, bien qu’il soit très important, mais, aussi difficile à penser que cela puisse paraître, l’essentiel
est ici dans la série elle-même et dans la forme sérielle ou séquentielle que prennent les textes.
Charles Bernstein: To pursue a little bit what I was trying to suggest last night about perhaps not the Jewish themes in Reznikoff but a Jewish sense perhaps of the holiness of the everyday, the holiness of witness, I think, what exactly is the status of the particular and the detail in Reznikoff? What is the status of the particular? Why is that important? You have that in Williams, you have that in Zukofsky, you have it in Rakosi – and I’m not meaning to suggest that any of the things I’m saying about Reznikoff doesn’t apply to other people by the way, I think it does – but, focusing on Reznikoff, it seems to me one has the idea, for example, in Baal Shem Tov, certain Hassidic notions of the holiness of the everyday, the holiness of the most common acts, the most base acts, the most vulgar acts, the holiness of walking, the holiness of drinking, the holiness of sitting, the holiness of talking, the holiness of looking, the holiness of touching. If you listen to the epilogue of Allen Ginsberg’s great poem ‘Howl’, where he has a litany just like what I just gave you: ‘holy asshole, holy armpit, holy nose,’ etc. (I would argue that Ginsberg’s three major influences are Reznikoff, Whitman and Blake, an interesting trio), is I think getting this from a close reading and understanding of Reznikoff in the sense of making those details – in other words I’m just trying to suggest what the status of the data is, and raise this way of looking at it. Blessedness would be another term for that.
Pierre Alféri : Il faut mettre en rapport avec ce statut du détail les thèmes juifs de l’œuvre de Reznikoff et, avant tout, l’idée de sainteté juive, par exemple dans la conception de Baal Shem Tov qui est liée à la quotidienneté, c’est-à-dire, la sainteté des actes les plus quotidiens, manger, parler, s’asseoir, etc., ou encore, à ce qu’on peut dire en anglais : « blessedness. » On ne peut pas traduire ça en français, le fait d’être béni. À ce propos, Charles Bernstein rappelait la fin de « Howl, » le poème de Ginsberg, où il y a justement une série d’affirmations, de sanctifications de choses basses, vulgaires, ou habituellement perçues comme telles. D’ailleurs, une des influences de Ginsberg est Reznikoff, avec Whitman et Blake.
Charles Bernstein: This idea of blessedness or holiness of the everyday is a sharp contrast to an orthodox religious view – orthodox Jewish and otherwise – that ritual and certain types of ritual acts are separated out, such as today, Roch Hachana, being one of the holiest days of the year, from a Jewish point of view, would not be separated out, from last Monday, which would not have been a particularly hierarchical day. So all the more appropriate to hold an occasion like this on a day like this to emphasize the everydayness of every day. For Reznikoff, the relation of the observer to the observed it not static, with the observer on one side and the observed on the other, but is one of nearness. Reznikoff’s relation to the world through the use of the detail, through the use of the particular, is one of nearness to and dwelling within the world, and this concept of witness, then, is not a static legal conception of witness, the concept of testimony is not a static legal conception of testimony, but in fact a full-scale critique of juridical and authoritarian modes of control of witness and testimony that distance you from the world, and is in that sense a critique of the whole movement of distanciation and high irony that you see and is often associated perhaps in some ways simplistically with T.S. Eliot, but certainly with aspects of Eliot’s theories and Eliot’s followers.
Pierre Alféri : Cette conception du quotidien et de la sainteté du quotidien s’oppose aussi par exemple à la conception religieuse orthodoxe qui hiérarchise et marque le plus fortement possible la différence entre un jour sacré comme aujourd’hui, le jour de Roch Hachana,
et d’autres jours, alors que ce que fait Reznikoff suggère au contraire une conception non-hiérarchique des détails et de la quotidienneté de chaque jour. De ce point de vue, Charles Bernstein distingue cette conception du détail ou de la singularité de celle qui a pu être mise en relief par Pound et par l’Imagisme, la notion de « singularité lumineuse » chez Pound qui au contraire met en relief, exhausse, hiérarchise, pour les célébrer, les détails et les singularités. La conception qui se dégage de l’écriture de Reznikoff est plutôt celle d’un regard sans distance, sans distanciation active en tout cas, sans ironie, et qui s’oppose en ce sens à la distanciation mise en œuvre par Eliot dans sa poésie. Et là aussi il rappelait l’idée évoquée hier par Michael Davidson, qui vient de Whitehead, d’un rapport entre l’observateur et l’objet qui soit inextricable, où l’un n’a pas de véritable privilège par rapport à l’autre et où ils ne soient pas véritablement séparés.
Charles Bernstein: We can’t say ‘quotidien’ when we’re talking about this in English be – cause ‘quotidien’ is too French, too extraordinary a word to talk about the everyday, but it’s interesting to hear it translated as quotidien, which is a word that exists in English as well, because there’s been so much interesting written about the status of the quotidien in French philosophy, which I think is quite relevant to the practice of the Objectivists. I’m thinking of course of Lefèvre, but equally of Michel de Certeau, whose most recent work translated into English, Arts de faire, in French, is called The Practice of Everyday Life, in English, although arts de faire is in fact a better term for what Reznikoff is doing.
Pierre Alféri : D’abord, j’avais oublié une chose importante, je crois : à propos de l’idée de témoin, de l`idée du témoin juridique, du témoin légal, Charles Bernstein voulait faire une mise au point en disant que selon lui ce n’était pas du tout une conception statique et passive du témoignage légal, l’idée qu’on associe le plus facilement à cette situation, mais au contraire une conception active. Et il faisait la différence entre le terme « quotidien » en français, et le terme « everyday » (« de tous les jours ») qu’on utilise en anglais ; et il disait qu’à son avis ce qui avait été écrit par des Français, en particulier par Lefèvre, La critique de la vie quotidienne, et par Michel de Certeau récemment sur le quotidien, pouvait tout à fait aider à comprendre ce dont il s’agissait chez les Objectivistes.
Charles Bernstein: To give you a sense that I’m not totally imagining this in Reznikoff, I point out the top of the fourth page of the Xerox, the poem about paradise, where I think Reznikoff is suggesting that the paradisiacal, the dimension of paradise is to be found in the detail, in the everyday, in the common. And since Lyn Hejinian has actually written so much about this topic it actually fits in nicely with both her sense and also the Ron Silliman book Paradise, and I relate this view in fact to work of my own contemporaries. So this is the poem that’s number 20 on the top of page 4, and you’ll hear Reznikoff read it.
As I was wandering with my unhappy thoughts,
I looked and saw
that I had come into a sunny place
familiar and yet strange.
‘Where am I?’ I asked a stranger. ‘Paradise’
‘Can this be Paradise?’ I asked surprised,
for there were motor-cars and factories.
‘It is,’ he answered. ‘This is the sun that shone on Adam once,
the very wind that blew upon him, too.’
So here I’m suggesting an idea that for first-generation immigrants, such as Reznikoff, the entry into English, like the entry into the world, was not to be one of exile, and here I want to make a sharp contrast, although I think it’s a useful comparison, between the great French poet, or poet in French, I think would be better to make my point – Edmond Jabès, whose sense of exile marks a sharp contrast from the sense of inhabitation that Reznikoff worked with. And I think the fact is that America suggested to someone like Reznikoff a possibility for inhabitation in a way that France did not suggest for Jabès. For Jabès, presumably, Europe was already inhabited. For Reznikoff, America was not yet made. Was not yet made. And I would say, is still not yet made in his sense; that is to say, that’s the task, and, I would say to Carl Rakosi, that is the social function of poetry. Per – haps simultaneous that its esthetic function IS that social function. So, for Reznikoff, the task is to found America, to found an American English, and he becomes a finder in order to found, and so the use of found materials, which so pervades his work, and which is the basis of Testimony, his largest collection of work, his largest single project, composed simply of found materials, that he becomes a finder as founder to inhabit, one who makes a new language, a new world.
Pierre Alféri : Le poème qu’a lu Charles Bernstein, que je ne peux pas traduire, concerne le paradis, et il l’a lu parce que justement c’est une conception du paradis extrêmement quotidienne, il l’a rapproché des textes de Ron Silliman et d’autres. Dans ce poème, le paradis est un lieu qui comprend des camions et des usines. Quant au statut d’immigrant de Reznikoff, Charles Bernstein le distingue de la façon dont ce statut peut être vécu, mis en scène, par exemple, dans l’œuvre d*Edmond Jabès. Il ne s’agit pas vraiment d’un statut d’exilé pour Reznikoff, peut-être simplement en raison de la différence entre l’Amérique et la France pour un immigrant ; l’Amérique, pour Reznikoff, n’est pas un lieu déjà habité au même titre que l’Europe peut l’être ; c’est un lieu qui n’est pas encore fait, qui n’est pas encore achevé. Et donc le rôle du poète immigrant est un rôle de fondateur ; il s’agit de fonder l’Amérique elle-même et de la fonder justement à partir d’un matériau découvert. Le rôle du matériau textuel, du « témoignage », des documents qui sont utilisés dans l’œuvre de Reznikoff, peut se comprendre ã partir de là.
Charles Bernstein: Now, because I must stop now, I’ll just briefly summarize some of the other points that I would make, without elaborating. I think, therefore I read Reznikoff not in terms of the flatness or absence of rhetoric but in terms of a nearness to the world not seen as nature but as social, urban. The materials of the world at hand as found, words – and world – but words as materials, not, that is, reports of things seen, narrow definition of the Objectivists, but bearing witness to things not seen, overlooked, entering into the world as a dissent/descent, not an idealized assent/ascent. Testimony as witness in court, as opposed to what? Reznikoff says, not a statement of what he felt, but of what he saw or heard. The witness can’t say in a trial a man was negligent, which is a conclusion of fact, but how that man acted, says Reznikoff. So maybe less however a matter of sight, of occular sight, than of action, not static but dynamic, as opposed to a pre-processed conclusion. The active witnessing of Reznikoff is an unfolding, a reference to process, not of a static occular seeing. Nearness is an attitude of address, not isolated, de-animated, images of distantiated occular evidence, as in the subway poem, and that’s just this four – line poem on page 3:
Rails in the subway,
what did you know of happiness,
when you were ore in the earth;
now the electric lights shine upon you.
What I’m suggesting by the difference between a certain idea of flattened occular imagism and what Reznikoff is doing is particularly the address to ‘you.’ If it was to be a certain idea of what we might think of as an objectivist poem, he wouldn’t have – he would just say ’rails in the subway, WHO were once ore in the earth, ‘flat. But he’s addressing it and bringing himself close to it, and I think this address, this nearness, is what Michael Palmer was talking about yesterday by talking about an intervention, what I say is a witness that intervenes. I think if you read this work of these individuals, in the extended group, you see that it is not a fl at, occular kind of objectivism, of witnessing which would allow for a certain kind of binary opposition between the thing seen and the seer, or between words and things, that there’s a collapsing of that at a very sophisticated level, and I think my sense of nearness is to suggest that. The intimacy of address, the “foundling,” the “founding,” the FONDLING! that is to say the handling of the materials, the fondling of them, as if they were precious, the comment, the intrusion into the materials, is a nearing toward a dwelling, making a habitation. So again, the part of Reznikoff which is specifically not like haiku, and which he specifically distances himself from in terms of haiku, is the fact that he will add these comments, which in some ways people would say, seem to spoil the poems. He adds a little twist at the end, and I think this is this nearing toward the world, and not an attempt to put it at a distance, and again I contrast that with the distanciation and irony and so-called “high modernism”, or what I call “high anti-modernism.” Being apart – “a-part” – distance from language – taking back the language from its metaphysical, its symbolic distortions, yet swings back to the question of exile, as exile from Hebrew. Reznikoff says
how difficult for me is Hebrew:
even the Hebrew for mother,
for bread, for sun
is foreign.
Which is a Jabesien comment, in fact. “How far have I been exiled, Zion.” So some type of hidden language – he also talks about having married the language of strangers – there is that tension but it’s a tension that he wishes to collapse, not to accept, not to reify. So witness as care, as involved, as care taken, caretakers, care in the language, for the world; language as caretaker of the world: witness-testimony as self-cancellation, and that’s a term he takes from Zen, that he likes, Reznikoff himself: witness-testimony as self-’ cancellation so that the language event speaks of and for itself, suggesting a modernist autonomy, a forgetfulness of self, as Reznikoff quotes a Zen article. Testimony I see in terms of the structure of event, the constellation of detail, composed of details, so that the picture is produced by this method, not presumed; the nearness-unfolding of event breaks down the subject-object split; subject-object, observer-observed; the paranoia (next to the mind) of the objective depersonalized gaze. Here the dualities collapse onto one another; the distanciation-irony is collapsed; the observer enters into the observed through a process of participatory mourning. Thrown into the world through event as testimony, testimony as event, the poem merges objective-subjective, those two things. Event emerges as the world-word materializing process takes place. Testimony: to found America means to find it, which means to acknowledge its roots in violence, to tell the lost stories, because unless you find what is lost you can found nothing. ’We are a lost generation) says Reznikoff’s mother, about her generation. The founding gesture of the parent-immigrant generation: against the indifference of the juridical gaze, the paradigm of distanciation. Founding means giving witness to what is denied at the expense of the possibility of America. Testimony as memorial, an act of grief, grieving, of mourning, the cost of life, the cost of lives lost is poetic, psychic economy, of which this work is an account, an accounting. No
one to witness and adjust; no one to drive the car except here; calling the lost souls: O earth O earth return.
(Pierre Alféri : on va aller vite ! From Charles Bernstein: He has the text, by the way, so at least he doesn’t have to do it spontaneously!)
Charles Bernstein voit la poésie de Reznikoff non pas comme une poétique de la platitude, de l’absence de rhétorique, mais plutôt de la proximité — en fait le mot en anglais veut dire à la fois proximité et approche, à la fois actif et passif ; proximité du monde qui n’est pas vu comme une simple nature, mais comme un monde social et urbain. Et il s’agit de traiter un matériau du monde qui est à portée de main, donc dans le quotidien urbain tel qu’il est découvert, et les mots eux-mêmes sont le premier matériau. Il ne s’agit donc pas de reportages ou de comptes rendus de choses vues, ce qui serait une définition étroite de l’objectivisme, mais plutôt d’un témoignage concernant des choses non vues ou mal vues. L’entrée dans le monde se fait alors comme une descente (ou différence) et non pas comme une ascension (consentement) idéalisée ou idéaliste. Ainsi Testimony, où il s’agit de témoigner comme à la cour, comme dans un procès. Charles Bernstein se demande à quoi s’oppose cette position du témoin à un procès. Le témoin à un procès, selon le texte de Reznikoff qu’on a lu tout à l’heure, ne peut pas dire qu’un homme était « négligent », ce qui serait une conclusion, mais seulement comment cet homme s’est comporté. Et donc il s’agit moins de l’action de simplement voir, que d’une véritable action, non pas statique mais dynamique, qui serait opposée à l’exposé d’un simple préjugé, de quelque chose qui a déjà été jugé, déjà conclu ; il s’agit d’un acte de dévoilement actif dans le témoignage. La proximité ou l’approche est alors une attitude d’adresse, non pas une attitude isolée, qui se consacrerait à former des images statiques à distance dans une évidence simplement visuelle, optique ou oculaire, mais de quelque chose d’actif. Par exemple, Charles Bernstein a cité des poèmes concernant le métro, qui se distinguent nettement des poèmes imagistes qui constituent une image à distance, une image simplement contemplée, oculaire, et opposent donc le sujet, qui est en fait omis, qui est mis entre parenthèses, à l’objet ; tandis que dans les poèmes de Reznikoff il y a un rapport beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif entre l’observateur et les objets. Il s’agit donc d’une sorte d’intimité dans l’adresse, d’une entrée, d’une intrusion violente dans le matériau lui-même. Cela constitue une forme d’habitation, dit Charles Bernstein. Il oppose aussi cette position du poète à l’ironie, par exemple celle d’Eliot, â la distanciation par rapport au langage lui-même. Ce que fait Reznikoff c’est défaire, dépouiller le langage des distorsions symboliques et métaphysiques qui peuvent lui être imposées par la rhétorique, comme par exemple, chez Eliot. II essaie de le retrouver dans la plus grande neutralité possible. Et pour en revenir à la question de l’exil, Charles Bernstein note que, dans un poème, Reznikoff parle de la distance, de l’éloignement de la langue hébraïque. Le poème dit :
comme l’hébreu est difficile :
même les mots hébreux pour mère,
pain, soleil
sont étrangers.
« Comme j’ai été exilé de Sion. » Et cette distance, dit Charles Bernstein, n’est pas simplement quelque chose de constaté ou d’accepté, mais constitue au contraire un défi pour la poésie de Reznikoff. Le témoin en ce sens est donc quelqu’un qui est impliqué, qui prend soin, qui est en charge de quelque chose, qui est responsable. Il est en charge du langage et il est en charge du monde lui-même. Et le langage lui-même peut être considéré comme ce qui doit prendre soin du monde. À ce propos, Reznikoff aimait une formule Zen
concernant le témoin, qui définissait le témoignage comme « autoannulation, » « auto-effacement, » de sorte que le langage lui-même, l’événement lui-même parle seul, parle de lui-même. Et il appelle cela une autonomie moderniste du langage. Dans Testimony, ce qui intéresse beaucoup Charles Bernstein, c’est la structure de l’événement. La structure de l’événement, c’est une sorte de constellation faite de ces détails, une image composée de détails ; c’est-à-dire qui est produite par cette méthode, donc, de mise en série de détails, et qui n’est pas présupposée (par opposition, je pense, à l’esthétique imagiste). L’image est produite, elle n’est pas présupposée. C’est donc l’opposition même du sujet et de l’objet qui est remise en cause, ou qui est effacée par cette poétique dans cette proximité. Si bien que les autres formes de cette opposition observateur/observé, etc., toutes ces dualités disparaissent ; la distanciation et l’ironie s’effondrent, et l’observateur entre dans le monde observé lui-même à travers un processus de deuil participatif — c’est la formule de Charles Bernstein. Il est donc jeté dans le monde, dans l’événement comme témoignage, ou dans le témoignage comme l’événement lui-même ; et le poème, qui est donc ce témoignage comme événement, cet événement comme témoignage, dissout les polarisations objectif/subjectif, etc. L’événement émerge alors comme le processus de matérialisation du monde et du mot à la fois. Fonder l’Amérique elle-même, comme le disait au début de son exposé Charles Bernstein, par le texte de Testimony par exemple, cela veut dire : la découvrir, c’est-à-dire reconnaître ses racines et les reconnaître dans la violence, parce que Testimony est particulièrement consacré à des faits divers extrêmement violents ; retrouver ses racines parce que si ces histoires oubliées ne sont pas rappelées, on ne peut rien fonder. Une phrase de la mère de Reznikoff est citée à ce moment-là, qui disait : « Nous sommes une génération perdue. » C’est justement le geste des parents qui en appellent à une fondation, qui exigent une fondation en immigrant. Il s’agit donc de s’opposer plutôt que de se plier à l’indifférence d’un témoignage simplement juridique, et de s’opposer ã la distanciation qu’il suppose dans l’idée qu’on s’en fait habituellement. Fonder, cela veut dire donner un témoin à ce qui a été nié, oublié, au prix de la possibilité même de l’Amérique, c’est-à-dire de la possibilité même de fonder l’Amérique. Testimony est donc un monument aux morts, pourrait-on dire, ou un monument au sens littéral du terme, c’est-à-dire un acte de deuil et de souvenir. Le prix de la vie, le prix de toutes les vies qui sont rappelées dans Témoignage constitue une sorte d’économie poétique et psychique, dont le livre est, en quelque sorte, la comptabilité. Il s’agit de tenir une sorte de livre de comptes des vies. Il n’y a personne — je pense qu’il s’agit là d’une citation, il dit, « Il n’y a personne pour témoigner et pour s’ajuster à ce monde, sauf ici même. » Et encore : « Appeler les âmes perdues, Ô terre, Ô terre, reviens. »
(1) Il y a un paradoxe dans l’histoire de la poésie objectiviste : elle ne fut vraiment reconnue que plus d’un quart de siècle après sa naissance et l’influence décisive qu’elle eut alors ne suffit pas à dissiper le mystère qui l’entourait. Son acte de naissance est la parution, en février 1931, dans la revue Poetry de Chicago, d’un choix de poèmes présentés par Louis Zukofsky ; sous le patronage d’Ezra Pound, des poètes alors inconnus étaient rassemblés sous l’appellation d’objectivistes. Ils fondèrent une maison d’édition, l’Objectivist Press, où ils publièrent leurs œuvres. Ils étaient quatre : Louis Zukofsky (1904-1978), chef de file et théoricien du
mouvement, auteur de A, cycle poétique dont l’importance est comparable à celle des Cantos d'Ezra Pound ; Charles Reznikoff (1984-1976), auteur de Testimony, de nombreux autres livres de poésie et de romans ; George Oppen (1908–1984), auteur de Discrete Series, On being numerous, etc. ; enfin Carl Rakosi (né en 1903), auteur de Amulet, Ere Voice, etc.
Bien qu’ils n’aient pas signé de véritable manifeste, ces poètes se reconnaissaient dans une « esthétique » cohérente, résolument américaine, qui rompait avec l’imagisme. L’objectivisme met d’abord l’accent sur « l’objectification » du poème : « une appréhension complètement satisfaite eu égard à l’apparence de la forme artistique comme objet » « une écriture qui est un objet ou affecte I'esprit comme tel » (Zukofsky). Mais l’objectivisme propose aussi une attitude nouvelle devant la réalité : face aux « choses telles qu’elles existent », il prône l’abstention de tout jugement esthétique ou moral explicite. « Je vois une chose. Elle m’émeut. Je la transcris comme je la vois. Je m’abstiens de tout commentaire. Si j’ai bien décrit l’objet, il y aura bien quelqu’un pour en être ému » (Reznikoff). La poésie doit ainsi créer des objets, « choses parmi d’autres choses » pour qu’ils « existent dans le monde, l’affectent et se soumettent à son jugement » (Zukofsky). « L’important est que, si nous parlons de la nature de la réalité alors nous ne parlons pas vraiment de notre commentaire à son propos ; nous parlons de l’appréhension de quelque chose, disant si elle est ou non, si on peut en faire une chose ou non » (Oppen). La poésie doit rejeter les symboles et les images où elle se complaisait, elle doit rompre avec la métaphore, « dont le défaut est d’emporter l’esprit vers un “partout' diffus et de l’abandonner nulle part” (Zukofsky). À ce parti pris poétique sans concessions fait écho le célèbre slogan de William Carlos Williams : “No ideas but in things” (“Pas d’idées sauf dans les choses”).
Malgré leur radicalité (qui allait de pair avec leur engagement politique), ou peut-être à cause d’elle, les Objectivistes furent largement ignorés pendant trente ans, à tel point que deux d’entre eux (Oppen et Rakosi) cessèrent d’écrire. Ce n’est qu’à la fin des années cinquante qu’ils furent redécouverts. Ils furent une source d’inspiration décisive pour le courant de Black Mountain (Charles Olson, Robert Creeley, Larry Eigner, Robert Duncan), mais ils nourrirent aussi d’autres recherches poétiques aux États-Unis et ailleurs — en France, par exemple. Cette seconde vie de l’objectivisme est loin d’être terminée. Constater son influence sur la poésie contemporaine ne dispense pas de l’aborder directement, et l’on commence à peine à mesurer son importance : l’objectivisme fut peut-être la réponse poétique la plus intransigeante à tous les avatars du Romantisme.
Pierre Alféri
Le 3e numéro de NOTES a été publié par Raquel Levy
dans le cadre de l’atelier cosmopolite å Royaumont
en juin 1990.
 Charles Bernstein. Octobre 1989, à Royaumont.
Charles Bernstein. Octobre 1989, à Royaumont.