Édition
ORANGE EXPORT LTD
Publié par Raquel, au 52 Av. Pierre Brossolette à Malakoff (92240)
_______________________________________________________
Sponte sua forte LUCR.
_____________________________________________________________________
Juin 1977 N° 9
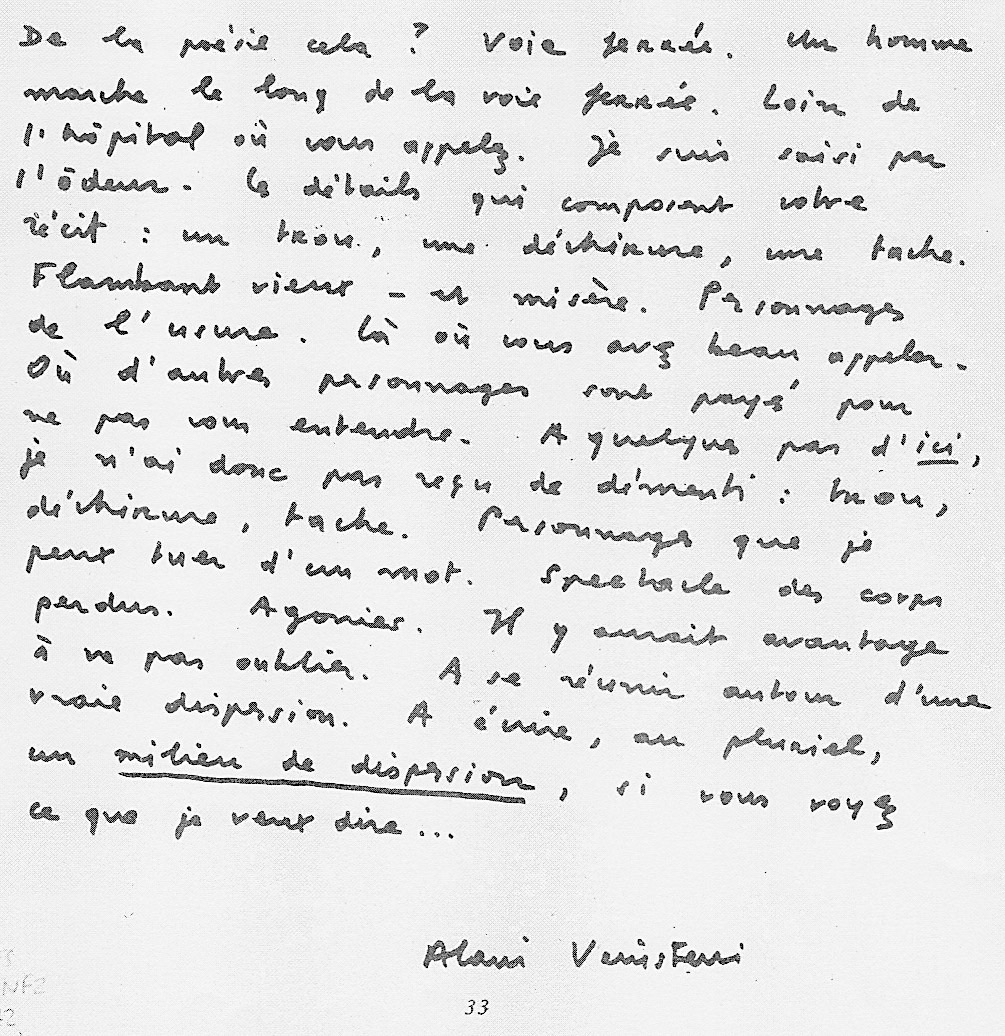
De la poésie cela ? Voie ferrée. Un homme marche le long de la voie ferrée. Loin de l'hôpital où vous appelez. Je suis saisi par l'odeur. Les détails qui composent votre récit : un trou, une déchirure, une tache. Flambant vieux – et misère. Personnages de l'usure. Là où vous avez beau appeler. Où d'autres personnages payés pour ne pas vous entendre. À quelques pas d'ici, je n'ai donc pas reçu de démenti : trou, déchirure, tache. Personnages que je peux tuer d'un mot. Spectacle des corps perdus. Agonies. Il y aurait avantage à ne pas oublier. À se réunir autour d'une vraie dispersion. À écrire, au pluriel, un milieu de dispersion, si vous voyez ce que je veux dire... Alain Veinstein
TOUTE UNE LONGUE ET LONGUE NUIT 1
Ostende, mercredi 24 novembre
et les mots : l'ombre du dernier arbre. Bleu au-dessus, d'un bord à l'autre. Tout nom gisant dans la boîte d'écriture. Tout amour au fond des cases. Ni contours accusés ni la couleur : ce qui ne fait passer que des teintes plus claires. Peu de chose et comme à moitié chemin. Sous ce bleu inhabitable où l'air brisé ne contient pas. D'indivisible façon toute séparation : déjà la langue dont la note unique « et pleure dans le désordre de ». Ne restât-il, pour dehors, qu'une rue. L'hiver dans l'ombre insensiblement. Un lieu.
Brighton, samedi 27 novembre
avec le jour cette. Et l'attente qui dure. Impénétrable aux choses. « Ce qu'elles vécurent cette année-là devant la mer. » Deux. Ni point d'appui ni l'arête d'un mur. Les heures du jour. Épaissies du tumulte de l'air et des paquets de corde. La mémoire exposée en vain.
Je ne sais si l'hiver ou plus loin. De plus loin encore le regard. De « dos »
Londres, jeudi 2 mars
de là-bas. Ni croît ni perte de mémoire depuis. Or l'addition des images. L'envers d'une robe. Les plis. Ne gagne ni ne tombe de ce côté-ci : mais une étreinte fixe.
Emmanuel Hocquard
- Franck Venaille/Jacques Monory: Deux, roman photo, 1973.
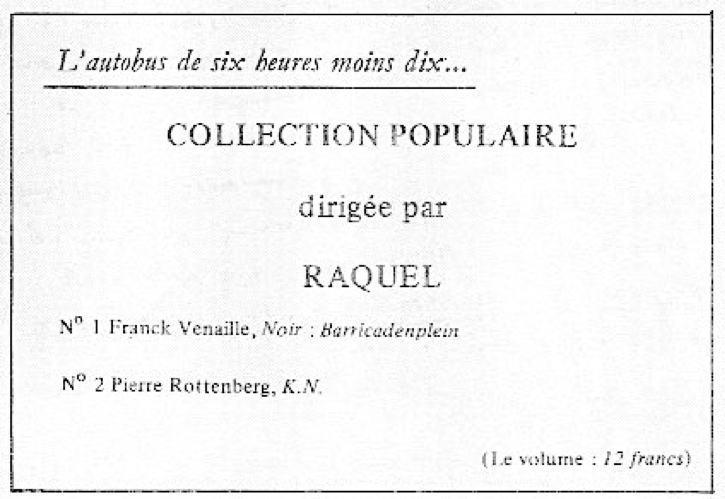
PALUDES 1
Mettons que je conjugue, à la première personne, et au présent, « j'ai des larmes dans la voix ». Est-ce que je n'échoue pas d'avance à faire entendre ce chevrotement que je dis ?
Et maintenant la même question, troussée autrement : peut-on assembler des figures, colliger ces bris du discours amoureux ? Ou bien : comment ne pas imiter ?
Quelle voix faut-il, dans la langue, pour que l'amour n'y dégouline, mais bruisse, au point que lecteur, j'aille dire du « je » supposé de ce discours : « il a des larmes dans la langue » ?
Passage de « una làcrima sui viso » à la larme ou l'alarme du Livre. Si je beugle, il va en sortir guimauve ; si je mâche la syntaxe dans ma bouche : la « fruition ».
L'amoureux « accepte de retrouver le corps enfant » ; il a reçu le don des larmes.
Mais celui qui des larmes écrit : « elles lui semblèrent si savoureuses et très douces, non pas seulement au cœur mais à la bouche », qui est-il ?
Et si je pose déjà la question autrement : Alors ? que dire à aimer Mallarmé ?
Celui-là retrouve dans la langue le corps enfant. Qu'il scrute les sangs de sa bien-aimée, qu'il hume l'urine des pissoirs, ou bien encore qu'il dépouille de leurs collections d'angelots les cimetières, toujours il est « Malgré la défense de sa mère allant jouer dans les tombeaux. »
Il retrouve le corps enfant : c'est dire qu'il écrit, « là où il 'n'est pas ». Où va-t-il ? Il va faisant l'apprentissage du bégaiement, épelle, commence de balbutier (« Quand les dés heurtent les dents la guerre commerce... »). Car « Dans les langues les plus anciennes, les mots qui servent à désigner les peuples étrangers se tirent de deux sources : ou de verbes qui signifient bégayer, balbutier, ou de mots qui signifient muet... »
Ce n'est pas dire qu'il « régresse ». Il porte l'étranger dans « sa » langue, brise « l'expansion illimitée du moi ». L'enfant-je dit « il » : pas dans la vie, dans la langue.
Mallarmé,
____________________________« Mère, pleure
____________________________Moi, je pense »
______________________alors, que dire à aimer ?
« Que dit-elle longtemps elle pleure longtemps elle tient contre son corps l'enfant serré longtemps elle lui écrase les lèvres salissant la bouche-enfant. »
Et ainsi de suite va, parce que l'amour, la larme, le livre (humecté) : un branlement de langue, une épiphora épongée dans les marges.
Livres :
Roland Barthes, Michelet par lui-même, Le Seuil.
Mathieu Bénézet, Dits et récits du mortel, Flammarion.
Mallarmé, Igitur ; Scolies ; Tombeau pour Anatole.
Michelet, Journal, Gallimard.
Renan, cité par Gérard Genette, Mimologiques, Le Seuil.
Dominique Laporte
1 Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Le Seuil,
Inexprimable amour,
Eloge des larmes,
Union
Mathieu Bénézet, La guerre commence, collection Figurre, Orange Export Ltd.
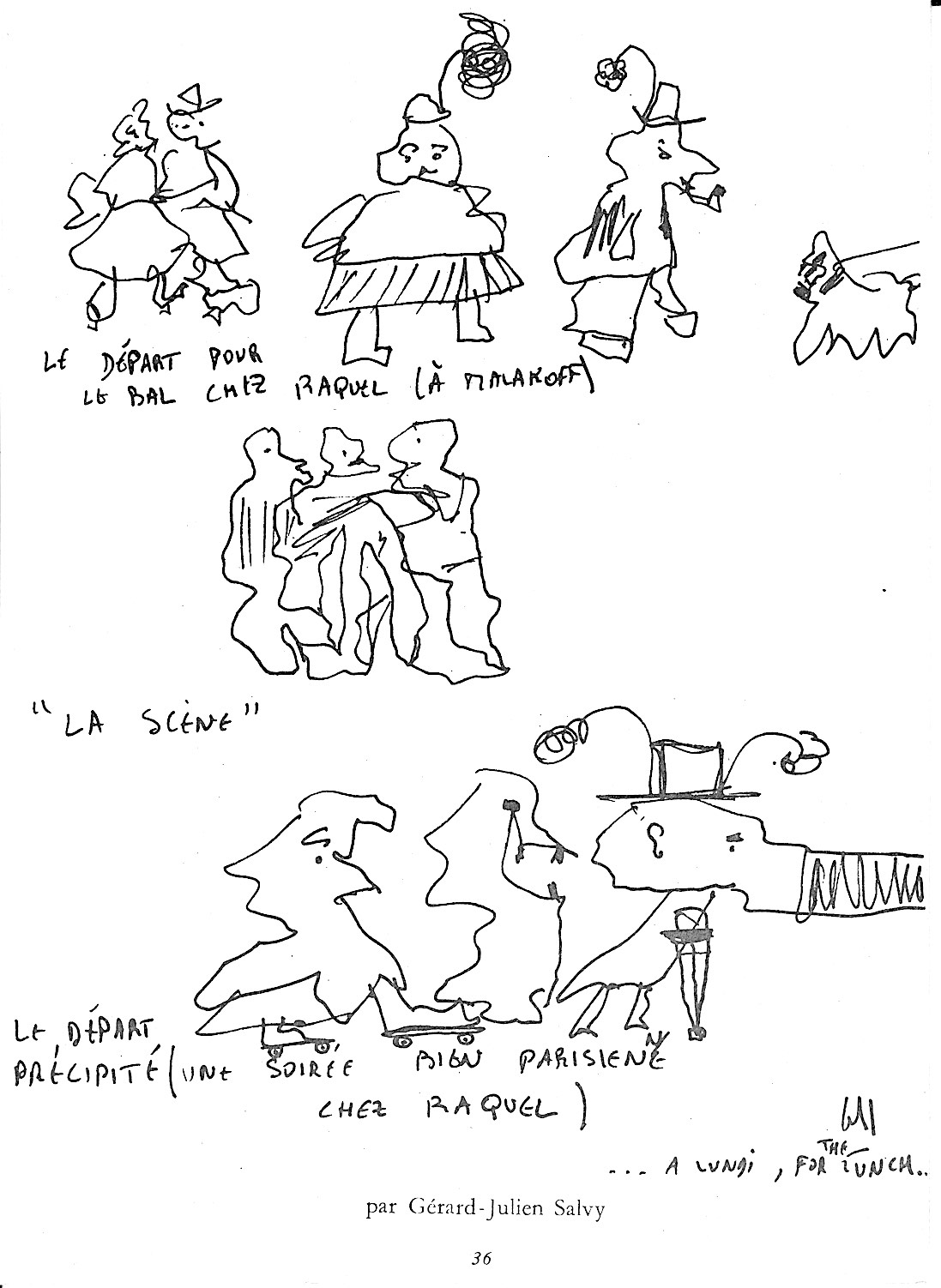
Retour à la liste des bulletins
ORANGE EXPORT LTD
Publié par Raquel, au 52 Av. Pierre Brossolette à Malakoff (92240)
_______________________________________________________
Sponte sua forte LUCR.
_____________________________________________________________________
Février 1977 N° 8
Le livre achevé est le lieu d'une rencontre différée entre « écriture » et « lecture ». Lorsque le livre est terminé, pour l'« auteur » les jeux sont faits. Le rideau est tombé sur la scène de l'écriture. Alors seulement entre le « lecteur ».
Le jeu, le risque partagé du feuilleton, c'est de réduire cet écart. De donner à l'auteur et au lecteur à découvrir le texte au fur et à mesure de son élaboration, séquence par séquence, dans un même temps, sur la même scène. Sans que personne sache par avance quelle sera la suite ; si même il y aura une suite. Tel est le projet dont la mise en œuvre commencera avec Suite de Roger Laporte. Suite donnera lieu à une série de cahiers de longueur variable dont la publication s'échelonnera, sans périodicité fixe, selon le rythme propre de l'écriture. Il en ira de même des autres séries de la collection Feuilleton 1
RAQUEL
FEUILLETON
« … comme il est donc difficile de vivre sous la menace d'une interruption définitive, d'écrire, de tenter d'écrire sans aucune certitude même sur l'avenir immédiat ! Parviendrai-je du moins à poursuivre, à achever cette séquence? Je n'en ai point l'assurance ». Arrivé à ce point de mon travail, ou plutôt une fois de plus arrêté dans mon travail, mais ignorant cette fois-ci non seulement ce que j'écrirais mais si je pourrais continuer d'écrire, j'eus du moins une certitude : la phrase sur laquelle je venais de m'arrêter deviendrait illisible, ne pourrait plus être lue telle qu'elle avait été écrite si elle devait par avance être périmée par son contexte : la rassurante épaisseur d'un volume. Il y avait depuis longtemps incompatibilité, il y avait maintenant rupture – il devait y avoir rupture – entre le texte et le livre, car celui-ci, fait pour recueillir, rassembler, relier, fait pour nous donner le tout à relire, trahit inévitablement la discontinuité, la fragmentation, l'inachèvement, c'est-à-dire l'écriture. Longtemps j'ai déploré cette situation, mais cette plainte, même devenue thème, est demeurée vaine parce qu'elle prenait place dans un livre qui la « relevait », livre qu'elle contribuait donc à renforcer; bref, l'interruption n'est qu'un signifié sans force et sans vérité, une idée vague, si elle n'invente pas son lieu, si elle ne trouve pas sa matérialité signifiante.
Faire en sorte que le lecteur n'en sache réellement pas plus que 1'« auteur» ; faire en sorte que celui-ci n'ait pas sur celui-là l'avantage immérité et trompeur de se croire « Auteur d'un Livre » : comment réaliser ce désir, ou mieux, comment répondre à cet impératif ? En publiant le texte selon son rythme propre, au fur et à mesure de son avancement (dans mon cas, séquence par séquence), c'est-à-dire avant qu'il soit achevé, forme un livre et prenne un sens définitif. Le feuilleton, mais un feuilleton qui ne comportera pas nécessairement un dernier numéro, dont la rituelle mention finale « à suivre » n'engagera ni la responsabilité de l'auteur, ni celle de l'éditeur, tel est l'instrument qu'« Orange Export Ltd. », cette fabrique de formes nouvelles, met par chance – par amitié – à la disposition de l'écriture.
Roger Laporte
_____________________________________
1 Roger Laporte, Suite (biographie). Premier cahier, 8 pages. 10 F. Abonnement pour les 5 premiers cahiers: 50 F. À partir du 1er mars 1977. Il ne sera pas fait de service de presse.
CONSTRUCTION D'UNE IMAGE : 2
À un comptoir. Cela se passe toujours à un comptoir ! Murmures. Lumière jaune. Paroles et autres. Tout se joue surtout dans le regard et la scène que je dis s'inscrit prend sa place à la suite d'une marche nerveuse. Les mains sont devenues blanches. Quelque part dans l'estomac : mais cela hurle ! On s'installe. On prend l'air de celui qui s'absente. En fait cela vibre, se tend : le corps. Oui, après une longue marche d'un néon l'autre. Minuit trente ou plus. Ségrégation joue à plein : les rues se vident. Ne restent que les. Donc on est là. On attend. C'est inouï ce que l'on peut entendre : paroles – langue – oui tout se dit. On attend. On est là, immobile. On est un trou. Une fente. On entre même à l'intérieur de soi. On et on. Immobile devant ce comptoir le mec se raconte la énième version de l'histoire qui l'a conduit là. Il n'a pas toujours le beau rôle non, il peut hésiter avant d'aller provoquer le tueur. Il peut fuir même ! En attendant il est venu ici d'un pas égal. Ses papiers sont classés manuscrit et le reste. On vient ici toucher ce que l'écriture ne pourra qu'ensuite la la la. Immobile le mec. Et comme absent ai-je dit. Pourtant des mots galopent qu'il va travailler jusqu'à ce que d'angoisse et de fatigue il en. Dégueule. 18 lignes par jour. Après cela vous vous étonnerez que cela se passe toujours à un compt. En face, il – elle vient de le repérer mais ne se déplace pas tout de suite. Son seul luxe c'est de se faire attendre. Alors ça se contente de rire plus fort, de montrer davantage son puis, soudain, de sourire. Marie-France voulez-vous ! Cela pourra durer une heure le jeu de l'attente du vide du trou de l'absence – quoi. Cela pourra le mener. à la frontière de la dingomanie. Tout cela devient blanc neutre flou froid. Le rien. L'éternité du vide. En lui les mots qui montent. La langue qui / demain / s'écrira. Tension. Fragment. Fragrance. Énonce. Ranstar. Ivo-la langue. Sur l'écriture. De l'écriture. Après : toujours !
Franck Venaille
CUM BABYLONICA MAGNIFÏCO SPLENDORE RIGANTUR
« Un amas d'eau qui n'a pas un doigt de profondeur entre les pavez des ruës donne un regard aussi enfoncé au-dessous de la Terre, comme il semble qu'un abysme profond s'entr'ouvre de la Terre au Ciel, pource que l'on y voit les nuages et le Ciel de haut en bas, et que l'on diroit que les corps sont cachez sous la Terre par un Ciel merveilleux.
« Les enfans assoupis d'un profond sommeil, s'imaginent souvent trousser leur vêtement près de quelque petit vaisseau, pour y décharger l'eau qui les presse, et moüillent ainsi en rêvant des lits magnifiques (1685).
« Les enfans liez d'un profond sommeil, croyent bien souvent qu'ils se troussent devant une cuvette ou quelque petit bachot, pour y tomber de l'eau, quand ils moüillent des robes éclatantes de couleurs diverses, apportées de Babylone (1650).
« Car tout ainsi que les enfants sont effrayez, et qu'ils ont peur de toutes choses dans l'obscurité, de mesme nous craignons quelques fois pendant la lumière des choses qui sont moins à craindre que celles qui font peur aux enfans, et qui leur figurent des spectres affreux.
Pour avoir long-temps tourné dans une sale, il semble aux enfans que les murailles de la sale, et toute la maison tournent pareillement : si bien qu'ils ont peine à croire qu'elles n'aillent point fondre sur eux pour les accabler de leur ruine.
« La porte de la mort n'est donc point fermée au Ciel, ny au Soleil, ny à la Terre, ny aux vagues profondes de la Mer : mais elle demeure ouverte à tous d'une énorme et vaste ouverte.
« De même que parmy la douceur du sommeil, celuy que la soif contraint de chercher de quoy éteindre l'ardeur qui l'afflige, demande à son imagination des simulacres de quelque ruisseau, et que travaillant en vain à se satisfaire, il sent toute la violence de la soif dans le même fleuve qui luy fournit l'abondance de ses eaux. »
Lucrèce
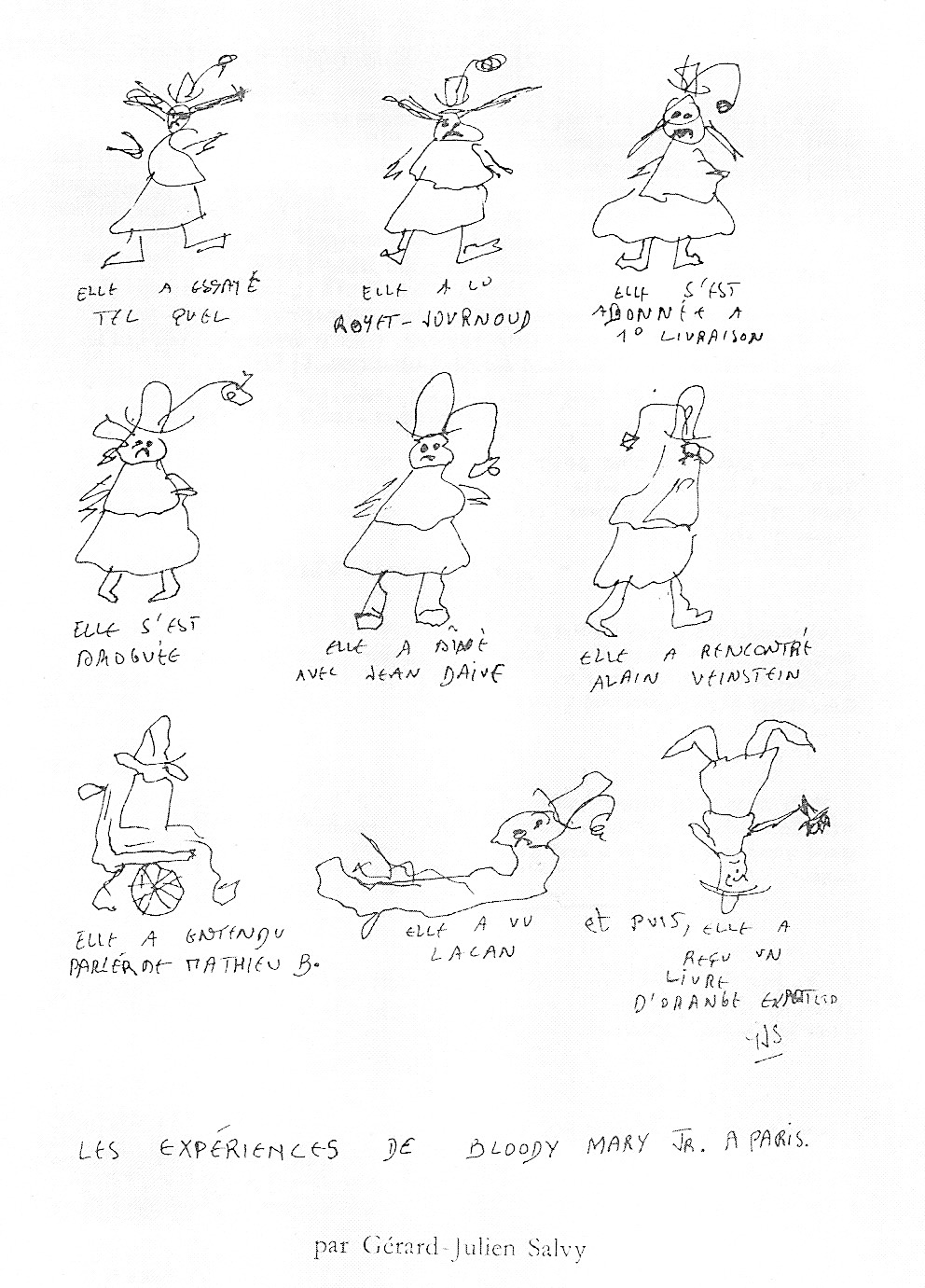
Retour à la liste des bulletins
ORANGE EXPORT LTD
Publié par Raquel, au 52 Av. Pierre Brossolette à Malakoff (92240)
_______________________________________________________
Sponte sua forte LUCR.
_____________________________________________________________________
Décembre 1976 N° 7
L'AJUSTEMENT DISSOCIATIF1
Un beau livre éclaté et brûlant, difficile à capter, à tenir... Remarqué, déjà, par Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, Philippe Boyer. Un livre qui dépasse la coite obédience du récit « psychologique à affabulation romanesque » (Breton) pour nous entraîner, nous contraindre « au bord de cette page qui n'est ni page, ni papier, ni blancheur, ni réflexion, ni folie, ni sagesse, ni sens, ni livre, pas ta main, pas ta tête, mais commencement éclaté d'une expérience, sorte de présent qui se double sans cesse, sans jamais se pourvoir en suite-avenir, cassation, absence de grâce... »
Commencement éclaté d'une expérience, tel apparaît, en sa pratique disruptive le livre d'Agnès Rouzier, à propos duquel on pourrait parler aussi d'« ajustement dissociatif » tant y est manifeste ce que Daniel Wilhelm appelle le « travail de la séparation »2, séparation (qui) produit l'ébranlement du récit.
Ici, en même temps que le procès du livre, s'effectue le procès du corps un(it)aire. Le « corps », comme le livre, n'est pas une réalité donnée. En tant que concept totalisateur il n'est qu'un fantasme comme l'« auteur » ou le « couple »· Le « corps » dans Non, rien, ne se manifeste que comme absence, dispersion, chute. Il tend à s'identifier à la pluralisation et à l'in-différence des sexes, « ses seins gonflés comme une bite » hors (il faut le souligner) de toute réduction égalitariste mais en marquant que le désir, ce coupeur de parole, érode et disperse le corps ainsi qu'il contribue à la segmentation du récit ; à son atomisation et interruption : « Phrases rompues. Membres discontinus. Et le vide alentour... »
Le délitement du récit et sa dissolution-ouverture nous amènent à ce point sans identité et d'éclatement où se situent les livres d'Edmond Jabès. Là où la brisure fait loi et marque l'émancipation du livre. Également, l'instabilité pronominale à l'exemple de l'in-différence des sexes, des organes, confère au texte un statut d'inépuisabilité. Le sens est toujours « sans (qu')aucun point où s'accomplir... » Tout, ici, dérape et décroche... Sans origine ni achèvement, le mouvement spasmodique et haché de l'écriture semble s'acharner surtout à défigurer, à violenter, par l'effet d'un immense désir, l'intégrité du personnage-sujet, à pulvériser l'idée du moi-privilège en regard de l'animalité, l'organique, le bas, la merde. Ici, le fonctionnement du « récit » destructeur compromet le récit classique, fait sauter les catégories et barrières identificatrices, contourne et abolit le petit marché entre le vécu et le narré...
« Je sens sous ma pensée le terrain qui s'effrite » écrivait Artaud. Agnès Rouzier participe du même type d'effondrement. Elle s'aventure jusqu'à l'extrême danger, là où la chair se déracine et se coupe, où l'extrême ouverture menace à la fois avec la ténèbre engloutissante et avec l'aveuglement du sens toujours nouveau, où se joue dramatiquement dans l'errance-béance la dissolution de l'unité du moi et de la conscience... Toujours sous le fouet coupant du désir.
« ... suspendue au fil du rasoir... » sous le coup (la coupe) de « l'acier véritable » se poursuit la quête orgastique. Cependant, les vulves phalliques, face à la coupure castratrice, peuvent se tourner vers l'encre de la puissance et de la mort, le sperme noir dont le crachotement mythique scande les traces écrites, la grille procustienne contre quoi la pulsion s'écartèle et s'encrypte.
Joseph Guglielmi
______________________________
1 Agnès Rouzier, Non, Rien, Éditions Seghers/Laffont, collection Change, 1974.
2 In Maurice Blanchot, La Voix narrative, Christian Bourgois, collection 10/18, 1974.
______________________________
PHRASE 1
(Commencée, terminée par un coup de force, sans doute le même et qui s'est inversé au cours d'un trajet qu'elle suscite mais qui la domine, placée à la jonction de deux concurrences divergentes au départ mais qui se rapprochent sans cesse en vue de la former, celle du désir et celle de l'objet, la phrase nœud, se dénoue elle-même dans son déroulement tantôt route rectiligne aux bordures trop visibles pour ne pas conduire à l'impasse, tantôt méandres, l'anacoluthe traverse porteuse de fleurs bleues, qui se croisent de plusieurs manières et comme si le jeu avait été déjà préparé pour répandre des réponses claires parmi les zones d'ombres jusqu'à ce que, le fil cassé: mutisme, ou bien (objet, non objet, de la nuit), l'aveuglement duquel elle s'inspire, mais : jalonnant son trajet, sans cesse inquiète de se perdre en même temps qu'elle respire, comme au soleil retrouvé, à chaque niveau qu'elle atteint, joue toujours entre les deux points et la virgule, entre certains éclats sonores et leurs assourdissements qu'elle répète ou qu'elle oublie, (recèle ainsi une faute inconnue) parcourt son labyrinthe, les voiles soulevés, aisément ou trébuche; la nudité, le velours, la montre, le secret, l'humidité, l'ouverture, l'obscur à tête de Cassandre, chemine à travers ces plusieurs obscurités dont la sienne propre et de temps à autre ou selon son inclinaison reçoit un coup de clarté qui l'étourdit et l'arrête, future.)
Jean Tortel
______________________________
1 Jean Tortel, Le Discours des yeux, inédit.
______________________________
PROSOPOPÉE DU « LECTEUR » 1
__________________________________________________Pierres : Je n'ai pas à les retourner pour entendre, étant toujours – paroles ou pierres, de l'autre côté.
Soif : comme une pierre. Oubli de la soif : comme une pierre aussi. Les quartiers d'obscurité, comme aveuglément je les longe, ne retiennent pas, mais se diluent... par blocs qui, aussitôt dressés, distinctement se diluent... Est-ce là appareiller, bâtir, ou jeter bas ?
( où suis-je ? dans l'emportement... et immobile : occupé à lire... comme endormi, sans qu'ici le sommeil en suspens tempère mon insomnie...
Lire : je suis de l'autre côté des mots qui, lorsqu'on a ouvert la bouche, sont proférés – ici, comme immobile ou muet.
Mais les pierres muettes sont roulées – immobiles aussitôt avisées.
Gangue jusqu'au centre : voilà le muet... ( et roulant, tout de même...
... immobile, lecteur aussi immobile que parole ou pierre aussitôt avisée...
... avoir parlé amortit... amortit ou freine quand cela doit s'inscrire en mots... Ainsi parfois la nomenclature des chutes d'eau atténue : soit que le lieu-dit, dramatisé outre mesure, se volatilise, soit que la précipitation avec enjouement s'alentisse sur un bon mot (il n'y a pas lieu de citer à ce propos des désignations de rapides qui viennent à l'esprit...
… me viennent, lecteur sur la cassure, à l'esprit... là même où la parole ré-pétée minimise... moi qui ai lu et lirai... et de nouveau lirai, n'étant en rien matière lisible ou à déchiffrer... oubliant ce qu'au travers des mots j'ai pu un instant – rien qu'un instant ( quand même il se répéterait à l'infini ) sans atténuation, et dans sa crudité, percevoir... Mais ces mots qui modèrent, mots de l'oubli, eux-mêmes et sur le champ les oubliant... lecteur au passé, continuellement – et, dans sa lecture, qu'il lui en souvienne ou non, comme volatilisé... fantôme feuilletant... vaporisé... feuillolant...
( quand même cela serait allé sur le sang : rien de moins personnel que le sang.)
« Son nom est perdu dans les temps qui se sont perdus eux-mêmes et sont dans la nuit, le silence, les ténèbres et l'oubli. » (Montesquieu) J'ajoute : le fracas... j'y ajoute le fracas sur lequel silence se fait, jusqu'à ce qu'au travers des noms et des mots il se révèle silence et fracas de nouveau...
... moi, lecteur... moi : qui ne suis en rien matière à lire, matière lisible, ni à déchiffrer... Lecteur au passé, toujours... pour être là je décroche...
(... demeurer, comme l'eau dans son débit, ou la parole, demeurent, ne com-porte aucune atténuation... )
Montesquieu, encore : « Nos pensées roulent toutes sur des idées qui nous sont communes ; cependant, par leurs circonstances, leur tour et leur application particulière, elles peuvent avoir quelque chose d'original à l'infini comme les visages. »
Ce qui est beau dans une maison de rivière – maison rivulaire – c'est que la régularité du galet aligné à la verticale n'a pas été produite en vue d'une construction... Régulier, parce que roulé, voilà tout : que je m'en saisisse ou non – et le roulement proposé à la lecture debout reste, dans l'opacité même des gangues égalisées aux points de rupture, perceptible où il aura pris hauteur sur les eaux.
Là j'entends grandir. Comme augmenter – gagnant sur moi, l'écoute de mon vivant. J'ai lu. « J'ai regardé croître les pierres. »
ANDRÉ DU BOUCHET
______________________________
1 Pascal Quignard, Le Lecteur, Gallimard, 1976.
ORANGE EXPORT LTD
Publié par Raquel, au 52 Av. Pierre Brossolette à Malakoff (92240)
_______________________________________________________
Sponte sua forte LUCR.
_____________________________________________________________________
Juin 1976 N° 5
COMMENT J'AI ÉCRIT UNE 1 (chronique)
J'ai appris, trop tôt, à lire et à écrire à l'aide d'un alphabet dont le dessus des lettres, découpées dans du carton fort, était peint en rouge vernissé. D'une lettre à l'autre le rouge n'était pas exactement le même ; il faisait chaud. J'apprenais le tracé de chaque lettre en promenant l'index sur sa surface lisse ; puis j'en reproduisais la forme, pat lignes entières et aussi régulières que possible, sur des pages de cahier, au crayon. C'était l'après-midi.
Le matin, il y avait la plage. Et pour commencer : courir au bord de l'eau afin d'y découvrir, pour les rejeter à la mer s'il n'était pas trop tard, de menus poissons que le reflux avait surpris et qui se trouvaient retenus prisonniers dans les rides du sable, à quelque distance du rivage.
De l'association quotidiennement répétée des poissons mourants et de l'alphabet rouge de mon apprentissage, j'ai retenu ceci : que sous l'allure de sens (métaphore) qu'il charrie pour conjurer une oppressante menace, un mot, un texte, un monde serait toujours d'abord un assemblage de lettres, ce que traduit assez bien le passage latin de littera en litteræ, d'où littérature dérive.
Un matin, la plage fut toute rose des corps informes et visqueux de milliers de méduses mortes. Il n'y eut plus de clous ni de bouts de ficelle dans le pain ; la guerre prenait fin. Je devins écolier. La mauvaise qualité de mes premiers résultats m'inspira mon premier poème que je signai : Jule ; par peur de mon Nom.
Cette peur du Nom m'a longtemps accompagné. Elle n'a commencé à disparaître, beaucoup plus tard, qu'à compter du jour où les seize lettres qui le composent purent être prises en charge par un texte qui les signât. Comme si écrire permettait un renversement grâce auquel son propre nom pourrait faire basculer le signataire dans la nudité de l'anonymat et que, contrairement à Ulysse qui, pour abuser le Cyclope, déclarait se nommer personne, le texte proclamait qu'il y a quelqu'un, dans une caverne vide.
C'est de ce faux silence (ou ce faux bruit) qu'est né une.
Et d'abord, quant aux circonstances. J'avais, comme d'aucuns savent, entrepris depuis quelque temps d'imprimer moi-même certains livres. Or l'outillage rudimentaire aimablement mis à ma disposition se révéla contredire la seule idée à laquelle j'aie jamais tenu en matière de typographie : à savoir qu'un « beau livre » est un livre où papier, impression, mise en page, format et volume s'effacent au profit de la lisibilité du seul texte. Et que par conséquent tout ce qui, par trop de laideur ou surcroît de beauté, viendrait gêner, distraire ou fausser sa lecture, est purement et simplement à écarter. A cet égard, l'Anacréon de Bodoni me paraît un modèle exemplaire.
Il est arrivé que l'on me reprochât l'archaïsme du Garamond dont je fais un usage exclusif. Nul caractère pourtant ne me semble d'un emploi plus neutre : ayant couvert presque à lui seul trois siècles de littérature, il permet – en abolissant une fausse perspective – de faire surgir les vraies différences dans la répétition d'un espace de lecture où tous les écrivains de la langue sont des contemporains de fait. Neutralité de principe qui exige plus de tact que d'art, mais dont l'application, variant à l'indéfini avec chaque texte nouveau, requiert au départ une technique convenable. C'est là que le bât blessait ; car quel que fût le soin apporté au travail, les résultats que j'obtenais faisaient trop fréquemment apparaître, par défaut ou par excès, d'impondérables inégalités, notamment dans l'encrage des lettres. C'est ainsi que me vint la pensée, catastrophique, qu'à défaut de pouvoir contourner ces imperfections indécentes, il restait la possibilité de les utiliser, en écrivant un texte qui, se portant au devant de l'accident, l'intégrerait directement. Texte de pur opportunisme, livre de circonstance, une a été écrit sur le marbre, composteur à la main.
Quant au titre. Sur la ligne des crêtes qui sépare les versants de l'empire métaphysique des régions matérialistes – celles-ci aux frontières tellement imprécises et fragiles que les cas d'annexion par leur puissant voisin ne se comptent plus – le mot une occupe dans la langue une situation stratégique exceptionnelle. Position clef qui assure aux unes, par l'indétermination du référent, singularité, anarchie et mobilité, comme elle garantit à l'autre, sous le signe de la surdétermination, unité, ordre et stabilité. Mot à double sens, à double face, lui-même conformé dans un retournement le jambage auquel l'addition de la marque du féminin oppose, par la faussse symétrie des genres, le manque du masculin. Adjectif ne qualifiant aucun substantif, pronom ne renvoyant à aucun nom, article suivi de rien, usurpateur par excellence de toutes les fonctions, y compris la première, celle du sujet, une n'est qu'un signe vide autour duquel gravite le système des mots qui figure le livre.
Donc par une chaude après-midi de printemps. Alignés un à un les caractères de plomb, un texte. D'une lettre à l'autre le rouge n'étant pas exactement le même. Reflet de la forme inversée en feuille imprimée. Jet de lettres et pli des pages : un air de symétrie comme le renversement de une en nue. En milieu carré, horizon des mots, des espaces, des lignes ; ponctuation verticale. Ce qui prend sens et tourne court. Se déprend pour l'allure. Allure d'une nécessité : un livre. Ce qui a l'air. Vent. Paraître. Comme chevelure qui tombe, d'elle-même par son propre poids. Comme texte. Comme : un texte, une.
Pour finir. L'auteur de ces lignes (qui déclare ne correspondre à aucun personnage existant) se réserve le droit de soutenir, en privé comme en public, le contraire de ce qu'il a écrit ici sur une. Ou sur tout autre chose.
Aurais-je prétendu que une n'est pas un poème d'amour ?
Emmanuel Hocquard
_________________________________________
1 Emmanuel Hocquard, Une, Orange Export Ltd., collection Figurœ.
_________________________________________
L'ORDRE DU LIQUIDE 1
Face à la dispersion : le surgissement du nombre, le décompte de l'infime. Puis l'intervalle se dessaisit. La permutation des lettres engendre la disparition, nous restitue le mot de toutes les fins. La vue serait intransitive. La phrase, ici, accompagne le corps dans son inachèvement.
Claude Royet-Journoud
_________________________________________
1 Jean-Luc Parant, Les Yeux, CIII, CXXV, Fata Morgana, 1976.
_________________________________________
LE RIEN INSISTE 1
Le livre ne serait que le lieu de rencontre de nos fuites ; un lieu ayant fui son lieu... Nomadiser dans l'étendue infinie du verbe... Avancer dans le livre, comme on avance en âge, comme on acquiert des connaissances...
C'est toujours d'une séparation, d'une distance qu'il s'agit. Éprouvée ici comme relation, retour, répétition (Kierkegaard : la répétition proprement dite est un ressouvenir en avant...). Comme distance qu'il avale, rivé moins sans doute à une théorie de l'écriture qu'à la nécessité de s'en sortir ou de s'y retrouver. Aussi faut-il y consentir : celui qui dit JE, le choc en retour qu'est le Livre des ressemblances l'indique nettement, c'est bien l'écrivain, qui refait surface et cherche à se blanchir du narratif : Viendrai-je à bout de moi-même ; de ce blanc moi-même noyé dans tout ce blanc ? Premier coup de théâtre.
Ce n'est pas le seul. La scène demeure, mais le décor change. Se prépare l'agonie d'un livre. Déjà, il y a creusement, et imperceptible glissement. Juste ce qu'il faut pour donner un peu de terre à cette terre. Trouer. Reboucher. De sa ressemblance avec le livre au livre de sa ressemblance. Du livre des questions au livre en question. Sous couvert d'un retour aux sept livres du premier cycle. Edmond Jabès rompt le fil de notre lecture. De toute évidence il y a lecture d'un lieu étranger, d'un premier lieu. C'est le second coup de théâtre. Où le chemin est pris à rebours, le risque s'aggrave. L'illisibilité est au bout de la lisibilité perdante. Nous avons beau dire, nous avons oublié la langue de Dieu (mot étrange, du tout ou rien). S'abandonner alors au vertige de la perte, à la passion du dépouillement. Mise à nu du récit et des personnages. Être vierge à nouveau – innocence. Appel de l'inconnu – jusqu'à la tentation de ne plus vivre à l'écart, entre quatre murs de paroles.
On meurt toujours entre quatre murs de paroles, dont on ignore l'épaisseur, la hauteur... Mais aussi : Comment pourrait-on être mort et vivre jusqu'à la mort ? Ailleurs, Jabès parle d'une faim tenaillante, va jusqu'à écrire : Que notre amour nous soit rendu. Envisage même de cesser d'écrire pour aborder directement sa ressemblance. Comme si ce n'était qu'à l'écart des mots... Et cependant (troisième coup de théâtre), à travers la tentation de la perte du livre – sur lequel l'écrivain n'exerce aucun pouvoir – s'accroît le désir d'une histoire qui ne soit pas que l'histoire d'un livre, s'accroît le désir d'écrire...
Par un dernier coup de théâtre qui clôt le Livre des ressemblances, Jabès dresse son propre acte d'accusation. Il a voulu écrire le livre : il n'y a pas de livre. Il a trahi. Au livre de la vie, il a opposé le livre de la mort. Il a discrédité les sages et les rabbins, inventé, parodié. Il a faussé les règles du jeu, glorifié le vide, le Rien.
Mais sur ce Rien, il a édifié ses livres, cet écrivain que vous n'aimez pas. Cet historien de l'effort, du labeur, du harcèlement, de la peine que donne chaque phrase, à jamais aventurée. Ce que tu dis ressemble bien un peu à ce que tu essaies de dire ; mais n'est jamais que l'expression de cet effort... Tout semble en place et, soudain, rien n'est debout... C'est le vrai récit... Impossible, donc, de se reconnaître dans l'histoire ou de se mettre dans la peau d'un des personnages. Ce sont les mots qui parlent, dans l'espace de notre blessure... C'est ma façon de survivre à travers les quelques mots de ma vérité.
Alain Veinstein
_________________________________________
1 Edmond Jabès, Le Livre des ressemblances, Gallimard, 1976.
_________________________________________
BRÛLURE MENTALE 1
Une douleur --- l'éternelle blessure glorieuse
Un livre ------- qu'à la poésie ----------------- Le Travail du Nom
traversant l'expérience mentale pure, pour le lire.
----------------- ou mystère de se trouver exprimée déjà
il faut l'imaginer, fermé – plié, ou couché.
----- la pensée traversait les rôles
Faire abstraction --- même si près du silence – --- de toute vision
pourtant là -- quand le corps est une phrase à venir, préalable, nécessaire à la pulse
oui, il en presse les authentiques lèvres pour un jaillissement nouveau.
la main prise dans la page
en réponse à l'effroi : état du nom renversé de la déesse, des lignes grises, denses ou diffuses ou : écorchées
véritables empreintes mentales, ou encore,
VOCALES
VOIS CI, voix en registres, voix visibles
sur bandes magnétisées,
donnant en retour le son des langues
par l'action de la lumière
le corps noir dans lequel loger le nom...
Mitsou Ronat
_________________________________________
1 Claude Royet-Journoud / Lars Fredrikson, Le Travail du nom, Maeght Éditeur, 1976, collection Argile.
Retour à la liste des bulletins
ORANGE EXPORT LTD
Publié par Raquel, au 52 Av. Pierre Brossolette à Malakoff (92240)
_______________________________________________________
Sponte sua forte LUCR.
_____________________________________________________________________
Juin 1976 N° 4
UNE FEMME SOUS INFLUENCE
Le « passé » américain, le sol, ne travaille nullement comme ici ; et c'est pourquoi il revient sous la forme véritable de hiéroglyphes de la mémoire, de la perception, de l'ouïe. Le remarquable film de John Cassavettes, Une femme sous influence, met en scène une torsion, un S de feu, de charbon et de cendres, la torsion réciproque de cet homme et de cette femme l'un par rapport à l'autre. Tel film passant récemment à la télévision, avec son clivage – poésie des chevaux, des forêts, le mouvement libre – l'arrivée du machinisme d'autre part, la vie tassée, la vie enfermée, les libertés enfermées de l'autre – ce film lui aussi nous donne notre véritable mémoire, aussi bien donc une telle violence, un clivage, un Nord/Sud. Il n'en faut pas moins pour qu'en 100 ans donc se fonde un matériau qui va revenir dans une précision visuelle, sonore, une Lecture, celle du film de John Cassavettes. On ne peut manquer de penser aussi à ce très bon film Le Parc de la Punition d'il y a quelques années. De même dans le film de Cassavettes, quelque chose des données tribales (le repas autour de la table) se retrouve, le tribal dans son enchaînement, dans son déchaînement. Gena Rowlands probablement déchaîne à travers elle sa propre tribalité, son rapport au Père, dans la torsion d'une Danse, un S scintillant et dans lequel brille tout le feu, toutes les cendres. Ce qui nous semble très remarquable, aussi bien dans Le Parc de la Punition que dans Une femme sous influence c'est la bande sonore et visuelle, véritable ruban de Moebius, sur laquelle précisément tel point marqué n'est nullement un rapport arrêté, figé dans un présent fixe, mais tout au contraire l'ébranlement, le premier frisson (on ne peut manquer d'évoquer l'odeur du chèvrefeuille chez Faulkner). Le pharisianisme familial est dans le film de John Cassavettes présenté comme l'était le tribunal devant lequel passaient les réfractaires à la guerre du Vietnam, comme l'est cet autre tribunal des médecins dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Nous entrons, avec de tels documents, dans L'Histoire du clivage, le clivage du sol américain n'étant que de 100 années à peine, mais suivant de telles fractures, de tels déchirements qu'aussi bien la tribalité (cf. Freud) que les données hiéroglyphiques (là aussi cf. Freud) travaillent, sautent dans l'écran. Le machinisme présent dans le film de Cassavettes sous la forme de cette autre Danse, celle des camionneurs, ce machinisme reprend autrement comment, dans tel film récent, la machine à vapeur apparaissait à la fin de la guerre de Sécession, contre les chevaux. Dans le jeu de Peter Falk on retrouve le meilleur James Dean, ce côté arasé, cherchant ses prises (les prises du dialogue) plus bas, plus bas que la simple posture verticale, conventionnelle, de l'acteur américain. On se souvient de Dean dans toutes ses sueurs de son rapport au Père et à la Mère dans À l'est d'Eden. Ce retour en force nous semble être une école de travail tout à fait remarquable sur les postures du corps. On a envie de dire que La Mariée mise à nu de Duchamp y trouve tout à coup son sens, quelque chose en effet comme une géographie hiéroglyphique interne, une tache de couleurs. Une ironie, un humour renverse tout ce qui pourrait croire encore, ne serait-ce que par une seule fibre, aux nécessités, à la réalité de sa propre apologie. Gena Rowlands détruit l'image familiale, laquelle nous est donnée visuellement avec une précision dans le matériau : ce n'est pas pour rien si à la fin du film les chaises que rangent l'homme et la femme afin de pouvoir déplier le lit sont sans style, un style petit-bourgeois, et en effet tout le S, toute la bande de Moebius de cette femme c'est cela, c'est sa torsion autour, dans, à travers la laideur conventionnelle de sa parenté, c'est comment comme un stéréotype elle propose à manger, encore et encore des « spaghetti » comment elle donne ce surnom à l'un de ses trois enfants. L'Histoire du clivage en effet ira chercher là sa réalité. Elle saura non seulement comment, dans un matériau brassé, concassé, Nord/Sud reviendront, mais comment la petite-bourgeoisie ira inscrire en miroir, dans un miroir laid, son image, sa fin, sa retombée. C'est un autre Parc de la Punition que connaît, que traverse Peter Falk dans ce film, lui aussi court dans un désert et si ce ne sont pas les voitures des policiers qui le poursuivent, c'est le S scintillant, ce serpent, cet Autre, cette inquiétante étrangeté qui habite sa femme ; ce ne sera donc pas le drapeau américain qu'il voudra rejoindre en courant (puisque tel était le contrat entre le tribunal et les réfractaires), mais ce qu'il voudra rejoindre en courant ou en dévalant une pente qu'on dirait être celle d'un volcan, c'est à la fois la partie la plus interne de ce S scintillant, et le point de non-tourbillon de ce S, le point calme d'un tel Maelström. L'excellente qualité du document fait que rien n'est résolu dans ce sens. La tribalité joue à plusieurs niveaux : moment extrêmement violent et fort où les trois enfants, deux garçons et une fille, font un incessant barrage entre leur Père et leur Mère, dans tout un rapport égaré au Bon et au Mauvais objet, bons et mauvais objets qui justement, depuis 100 ans par exemple aux États-Unis, n'ont pas manqué d'être constamment triés, répertoriés, jetés. L'Après Société de Consommation se fait lire là. Société qui traverse son Parc de la Punition, et bien entendu le fond battant en est Biblique. Lorsque Gena Rowlands procède à son rituel initiateur (qu'il faut avoir entendu, vu), on sait qu'elle va trier encore entre Bon et Mauvais objet, que le rapport au Père (dans son cas Mère gommée) va repasser scéniquement, violemment. Aussi Peter Falk a-t-il comme posture, n'a-t-il d'autre possibilité de posture que de tenir le Serpent au bout de son doigt dressé. Un nouveau réalisme cinématographique américain se développe remarquablement, ouvrant l'opération chirurgicale, plaçant sans ménagement ses pinces autour de la plaie à débrider. L'Histoire du clivage n'est autre simultanément que L'Histoire des esclavages, les rapports Nord-Sud (Guerre de Sécession) se retrouvant dans la torsion, dans la bande de Moebius et sur cette bande ce qui est à l'envers dit un autre endroit, les objets (bons, mauvais) subissant un ébranlement profond, physique, symbolique, dans leur distribution. Peter Falk tourne dans une fosse où sifflent les serpents, les morceaux détachés du surgissement infantile dans la représentation que vit Gena Rowlands. Tout au contraire, très loin de tout « état d'âme » occidental européen, sans histoire, sans politique, sans sexualité, le vécu dans les objets menace constamment quelque part, luit dangereusement; ce vécu vient du Père cependant (un Père pourtant bien « tranquille », bien conventionnel) et toute la pulsion haineuse de Gena Rowlands tente, aussi, de contourner cela, son propre Nord/Sud, sa propre guerre de Sécession contre son Père, mais en même temps elle y est déjà, dans une telle Sécession. Ici, Bon et Mauvais vont subir un ébranlement volcanique, une coulée de lave ; elle est sa propre méchanceté, sa propre trahison (lorsqu'elle fait venir un homme chez elle en l'absence de son mari), mais cette trahison d'un soir dit en fait l'envers sur lequel elle se trouve, ce versant du volcan et c'est pourquoi la question n'est pas de la lire « à l'endroit », dans un endroit toujours conventionnel ; elle est à lire dans le sifflement de l'envers clivant, du clivage, de l'histoire clivée de tous les esclavages et leurs hiéroglyphes. Il est bon que le texte biblique, les données bibliques, à ce prix, reviennent, éclatent comme un volcan... Depuis ce Paradis, cet Enfer qu'est une rue lorsqu'on attend ses enfants devant revenir de l'école en car, depuis toutes ces données tribales, les arrachements, comment Gena Rowlands insulte salutairement ces femmes dans la rue en leur demandant l'heure – depuis cela toute une somme volcanique, ne va pas manquer de se lever, configurant, ou reconfigurant tout ce que nous croyons savoir, ce que nous avons mal vu, pas vu, oublié, passé sous silence, détruit, menti, déchiqueté, pensé – nous ne savons rien, nous plaçons un degré d'arasement plus bas, toujours plus bas ; je ne veux pas manquer d'évoquer pour finir James Dean dans À l'est d'Eden face à sa mère à la croisée des chemins, avec son étrange chapeau noir en forme de cornes.
Pierre Rottenberg
_________________________________________
HOMMES ADMIRABLES D'HARALI, COUCHÉS SÉPIA
visages révélés – sels d'argent, de palladium, de platine? – visés, tirés – V. agrandisseur, cache et... dégradateur – traits apparus en chambre noire, après que le point fut fait. À la distance focale, qui sépare les foyers d'une ellipse ou d'une hyperbole, rideau.
À l'intersection cubique des nombres, clic-clac vertical, le petit oiseau tombe et l'image s'inverse au fond de la rétine, comme, disait-on, sur la cornée disséquée en cours de sciences naturelles. Elle gardait jusqu'à putréfaction l'empreinte – cul par-dessus tête – de ce que le bœuf, dans un dernier coup d'œil, avait vu. Et dans l'œil du bœuf abattu, j'ai souvent, en vain, cherché le portrait du boucher.
L'autre jour, à La Hune, les spectres bougeaient encore, et des corps sont venus soutenir les têtes accrochées, les livres étalés. Cimetière des vivants célèbres, catalogue ouvert, pour combien de temps ? Au carrefour du marché et de la vision, ça bavardait gaiement, ça réconfortait comme chatoiements dans les lunettes d'Harali, yeux écarquillés sous l'obturateur des paupières.
Les ombres bistres trouvaient un refuge précaire à l'abri des machines, orbites trouées de solitude, rassemblées à l'usage du public : on exposait et on vendait, dans une librairie, des photos de peintres et d'écrivains.
Sur les cimaises, on donne à voir des personnages. Au-dehors, les meutes aveugles claquent des dents.
Jacques Bertoin
_________________________________________
DENIS ROCHE/MATIÈRE PREMIÈRE
suivi de
WILLIAM BLAKE/POUR LES SEXES :
LES GRILLES DU PARADIS
Couverture de Gérard Titus-Carmel
William Blake : un poète bien joliment bâillonné, une hostie dans la bouche, au milieu d'une victoire d'élans trembloteurs et renifleurs pour achever la scène. Denis Roche, romancier autobiographe, arrogant et désinvolte, les poches pleines de photographies. Lorsque Denis roche parle de Blake, ce n'est plus pour reprendre la démonstration passée sur la fin de la poésie (les entendez-vous ?) mais pour mettre dans son jardin, au milieu des menhirs, celui qui, tout nu mais casqué, recevait là ses amis, en compagnie de sa femme entreprenante et drôle. Lorsque Denis Roche parle de Blake, c'est pour dire ce qui se passait cette année-là, et qu'il s'agissait de 1793, ce qui n'est pas secondaire. Ce temps où l'on rencontre, au milieu d'un renouvellement de paysages aléatoires, des figures discrètes aux noms vieillots : Lacan, Fourier, Sade, Artaud, Bataille, quelques autres encore.
Les Grilles du Paradis, et non pas les portes. Attention aux métaphores. Et avant ce titre: Pour les Sexes. Car il s'agit d'abord d'un pamphlet portatif de libération sexuelle, vous oublierez alors la figure acariâtre et pompeuse des traductions usuelles. Ce que fait Denis Roche dans Matière première, c'est montrer d'un doigt péremptoire où cela se passe. Pour rompre avec l'ennui quotidien, la lassitude scolastique, au moins un livre énervant.
Nicolas de Selves
_________________________________________
Denis Roche, Matière première, suivi de William Blake, Pour les Sexes : Les Grilles du Paradis, L’Énergumène, 1976.
_________________________________________
PALAM
La pelle c'est en latin pala. La pala c'est ce qui met la terre palam : devant les yeux, ouverte. Dehors. La pelle est ce qui retourne la terre. Pelle ou bêche elles l'ouvrent et referment. D'un même mouvement, cèlent et découvrent. À la fois elles fouissent et enfouissent. La pelle creuse la tombe et enterre le mort.
Mais non seule (où expose le dehors) la mort : mais aussi les couleurs de la terre. La terre remuée par la pelle longtemps fut dite la terre paletée. On date du début du XVIIe siècle l'emploi que firent les peintres du terme de palette. La langue parla pour eux : d'un mot qui provenait de la petite poêle (la petite écuelle d'étain où l'on broyait les couleurs de la terre) ils firent usage à l'instar d'une petite pelle. Aussi dit-il d'entrée de jeu : « Quatre pieds de terre trouée dont les couleurs déteignent sur l'ébauche, mordent sur la main… »
Ce même mouvement, ainsi, est double. La motte que la bêche ramène sur son fer a deux faces : terre et monde.
Taire et dire.
L'introduction de la pelle dans la terre retourne la terre. (Il dit : « Mais il y a la terre... ») La parole d'Alain Veinstein est de celles qui ne parlent pas pour la parole : au fond d'un incessant et si profond silence atteste le silence et le vestige même avant que ce mouvement soit double, soit le double, avant que parole et silence soient dissociés, avant que terre et monde se scindent, s'assemblent et s'opposent : au ras même de la terre, alyrique, prolétaire, à la pointe obscure de l'outil le plus vieux.
Atterrement : c'est renverser par terre.
À plusieurs reprises, dans la Rhétorique, quand Aristote veut faire sentir l'irrésistibilité où entraîne la parole que l'auditeur soudain fait sienne, la clarté comme irrémissible qui s'abat sur son corps et tout entier l'échange à ce corps de la voix, il fait image de cette parole comme « ce qui renverse et jette à genoux sur la terre ».
Atterrer.
C'est le plus silencieux et atterrant des livres. Pauvre à l'extrême misère de la terre. Brusque comme la voix du malheureux se casse. Elle s'effondre dans le malheur, elle « retourne » sa mort. Pages, de toutes les pages d'Alain Veinstein, les plus laconiques en tant que dessaisies à l'indigence sans voix du dehors, de part en part soumises à l'extrême rareté, dénuement du corps arc-bouté-nu (mais il dit : « Non, ce n'est pas un corps... »), entière disette du sens, désert des voix, gueuserie des discours.
D'une même racine (de même paganus, non l'homme : le paysan, le journalier, dont le soin, comme on disait jadis, est le journal de la terre) procèdent pala et pagina : la pelle et la treille, devenue colonne d'écriture.
Face à pala : palla, la mantille de femme. D'où pail, le drap mortuaire. Pallier c'est couvrir d'un manteau. Ainsi, à l'angle que fait la bêche sur la terre qu'elle rompt, pour une fois le monde ne pallie pas la terre, pour une fois la voix ne pallie le silence. La voix atterrée, silencieuse du plus humble, elle retourne la terre.
Pascal Quignard
_________________________________________
Alain Veinstein/Lars Fredrikson, L'introduction de la pelle, Orange Export Ltd, 1975.
_________________________________________
Retour à la liste des bulletins